- Guide des plantes
Orties (Urtica dioica, Urtica urens) : propriétés et bienfaits
L’Ortie : une plante aux multiples bienfaits pour la santé naturelle, reconnue pour ses propriétés dépuratives, anti-inflammatoires, reminéralisantes et son action ciblée sur les sphères génitale, ostéo-articulaire, métabolique et cutanée.

Ce qu’il faut retenir…
Dans le cadre d’une phytothérapie clinique intégrée dans une réflexion endobiogénique, les Orties se présentent comme une plante prioritairement active :
–au niveau pharmacologique direct : sphères génitale et cutanée (racines) ; sphères ostéoarticulaire et métabolique (feuilles) ;
–au niveau du drainage : rénal, hépatobiliaire, cutané et génital ;
–au niveau neurovégétatif : léger parasympathicomimétique ;
–au niveau endocrinien : axes gonadotrope et somatotrope (racines).
A. Usages traditionnels de l’ortie
Consommée depuis la Préhistoire, l’ortie est réputée nutritive, revitalisante et dépurative. Elle a longtemps été utilisée dans les cures de printemps pour fortifier l’organisme, stimuler l’appétit et combattre la fatigue.
Feuilles et suc frais : hémostatiques (hémorragies, plaies), diurétiques, anti-inflammatoires, antirhumatismales, galactogènes. L’urtication (frictions avec l’ortie) soulageait rhumatismes, lumbagos et sciatiques.
Racine : dépurative, astringente, antihypertensive et diurétique. Reconnue en Europe pour le traitement des troubles urinaires (mictions difficiles, calculs, infections) et le soulagement de l’hyperplasie bénigne de la prostate.
Graines : utilisées comme antidiarrhéique, galactogène, cholagogue et aphrodisiaque.
En usage externe, l’ortie soigne divers problèmes cutanés (acné, eczéma, herpès), tonifie le cuir chevelu et apaise inflammations de gorge et ulcères.
Elle figure aussi dans la médecine ayurvédique (régimes Kapha) et en médecine vétérinaire (digestion, lactation).
B. Données expérimentales et cliniques issues directement de la pharmacologie
Tropismes principaux : sphères métabolique, ostéo-articulaire, génitale, rénale et cutanée.
Tropismes secondaires : sphères digestive, cardiovasculaire et immunitaire.
1. Sphère métabolique
Action reconstituante/« fortifiante »
De par sa richesse en minéraux — fer et calcium notamment —, en vitamines et acides aminés, la plante se révèle intéressante du point de vue nutritif, aide l’organisme à reconstituer son stock minéral et vitaminique et permet de lutter contre l’anémie en stimulant l’hématopoïèse.
L’Ortie, très commune, est consommée cuite ou crue comme aliment et utilisée lors des cures réparatrices et dépuratives de printemps, en lien notamment avec ses propriétés tonifiantes, antiasthéniques et diurétiques.
Action sur le diabète
Action anti-hyperglycémiante
La feuille d’Urtica dioica L. est traditionnellement utilisée comme anti-hyperglycémiante dans le traitement du diabète sucré en lien avec diverses propriétés.
- Stimulation de la sécrétion d’insuline : on observe une augmentation marquée de la sécrétion d’insuline in vitro après application de fractions isolées d’extraits aqueux de feuilles d’Urtica dioica L. sur des îlots de Langerhans et, in vivo chez le rat diabétique, après administration intra-péritonéale d’un extrait aqueux avec diminution de la glycémie. Un effet hypoglycémiant et protecteur des cellules β de Langerhans est également constaté chez te rat après administration intra-péritonéale quotidienne pendant 5 jours de 100 mg/kg d’un extrait hydro-alcoolique de feuilles avant induction du diabète par streptozocine.
- Réduction de l’absorption intestinale du glucose : un extrait aqueux d’Urtica dioica L. administré à raison de 250 mg/kg, 30 minutes avant une charge en glucose, produit un puissant effet anti-hyperglycémiant, avec une diminution de la glycémie d’environ un tiers comparé au contrôle à une heure post-charge. Cet effet, persistant pendant 3 heures, est en partie dû à la réduction de l’absorption intestinale du glucose.
- Augmentation de la captation intracellulaire du glucose : un ou plusieurs peptides cycliques, isolés d’Urtica dioica L. et structurellement apparentés joueraient un rôle dans l’activité hypoglycémiante, en formant des pores membranaires exclusivement perméables au glucose qui faciliteraient la captation de ce dernier par les cellules.
- Inhibition de l’alpha-amylase pancréatique : une stratégie de traitement du diabète est L’inhibition de l’alpha-amylase pancréatique, enzyme digestive de type glycosidase, nécessaire au catabolisme des glucides à longue chaine, Une telle inhibition peut être obtenue in vitro avec des extraits aqueux de feuilles d’Urtica dioica L. de manière temps et concentration-dépendante.
- Régénération pancréatique : divers extraits de feuilles d’Urtica dioica L. sont susceptibles d’induire une régénération des tissus pancréatiques chez le rat diabétique.
- Amélioration du contrôle glycémique chez l’homme : une étude randomisée en double aveugle versus placebo chez 46 patients diabétiques de type 2 nécessitant de l’insuline révèle que l’absorption de 500 mg de feuilles d’Ortie toutes les 8 heures pendant 3 mois, en association avec le traitement oral habituel, diminue la glycémie à jeun, la glycémie postprandiale et HbA1c, sans effet sur la créatinine, les enzymes hépatiques ou la pression sanguine.
- Propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes chez le diabétique : une étude clinique incluant 50 patients diabétiques de type 2, traités par 100 mg/kg d’extrait hydro-alcoolique d’Urtica dioica L. en 3 prises quotidiennes pendant 8 semaines, révèle une diminution significative d’indicateurs de l’inflammation comme IL-6 et hs-CRP. On constate également une augmentation de la capacité antioxydante totale, des taux de superoxyde dismutase (SOD) et une baisse significative du stress oxydatif.
Effet sur les complications liées au diabète
- Diminution des troubles cognitifs liés au diabète : un traitement chronique par Urtica dioica L. améliore significativement les déficits cognitifs liés au diabète chez la souris, en atténuant les altérations du système cholinergique muscarinique en lien avec le stress oxydatif observées dans l’hippocampe (stimulation de l’expression protéique de l’acétylcholinestérase). Après induction du diabète chez la souris, un traitement oral de 8 semaines par extraits de feuilles d’Urtica dioica L. (50 mg/kg) versus rosiglitazone (5 mg/kg) réduit significativement l’expression du récepteur muscarinique à l’acétylcholine de l’hippocampe et de la choline acétyltransférase. Aucun effet n’est obtenu sur le symptôme d’hypolocomotion observé par ailleurs chez les animaux diabétiques et lié à une stimulation de l’expression du récepteur 4 muscarinique à l’acétylcholine dans le striatum. Parmi les altérations cérébrales associées au diabète, on retrouve l’expression hypothalamique anormale de neuropeptides et l’augmentation des astrocytes (astrogliose) au niveau de L’hippocampe. L’administration intra-péritonéale d’un extrait hydro-alcoolique d’Urtica dioica L. à 100 mg/kg/j pendant 4 semaines chez 21 rats diabétiques conduit à une augmentation moindre de la densité de ces astrocytes, avec potentiellement une amélioration des troubles cognitifs associés. Chez la souris diabétique, des extraits similaires de feuilles d’Urtica dioica (50 et 100 mg/kg, per os) réduisent l’hyperglycémie induite par un glucocorticoïde, la dexaméthasone, ainsi que les complications associées, à type de dépression et troubles cognitifs : diminution de la glycémie, de la corticostérone plasmatique, du stress oxydatif, atténuation du comportement dépressif, stimulation des capacités de mémoire associative et de l’expression hippocampale de l’ARNm de la protéine transporteur de glucose GLUT4 comparable à la rosiglitazone (5 mg/kg, per os). On obtient également une amélioration de la mémoire spatiale et une augmentation de l’insuline sérique.
- Diminution des neuropathies : les neuropathies diabétiques impliqueraient à la fois des troubles du système nerveux périphérique et du système nerveux central. Sur un modèle de diabète induit par streptozotocine chez la souris, un extrait d’Urtica dioica L. (50 mg/kg) administré par voie orale pendant 8 semaines, agit de façon comparable à la rosiglitazone (5 mg/kg, per os), avec une régression des complications liées au diabète comme les dysfonctionnements neuronaux d’origine centrale ou périphérique : réduction significative des douleurs neuropathiques, de la glycémie et de la polydipsie, amélioration du poids corporel, du taux d’insuline et des capacités cognitives. Des extraits hydro-alcooliques d’Urtica dioica L. administrés avant induction du diabète chez le rat mâle révèlent également un rôle protecteur vis-à-vis des altérations observées au niveau des tubes séminifères.
Activité hépato-protectrice et hépato-régénératrice (graines d’Ortie)
- Hépatectomie : après un prétraitement oral d’une semaine par des huiles extraites de graines d’Urtica dioica L. (2 mL/kg/jour), débuté 3 jours avant une hépatectomie partielle chez le rat, on observe sur des tissus hépatiques prélevés 7 jours après résection un effet régénératif du traitement par Ortie sur te foie, avec diminution de la hausse des niveaux de M DA (malone-dialdéhyde) et augmentation de l’activité réductrice de la SOD et des taux de GSH tissulaires.
- Obstruction des voies biliaires : un traitement quotidien de 2 semaines par des huiles de graines d’Urtica dioica L. administré chez le rat par voie intra-péritonéale, débuté 3 jours avant ligature des voies biliaires, atténue les altérations histologiques au niveau hépatique dues à la cholestase, la prolifération des canaux biliaires ainsi que la fibrose.
- Toxicité des anticancéreux : l’administration quotidienne chez la souris d’extraits méthanoliques d’Urtica dioica L. à raison de 50 à 400 mg/kg pendant 6 jours, après injection d’une dose unique de cisplatine, prévient la néphro- et l’hépatotoxicité induites par l’anticancéreux, vraisemblablement par potentialisation des systèmes de défense antioxydants.
- Intoxication au NaF : dans des hépatocytes de la lignée HepG2 soumis à du fluorure de sodium, des extraits aqueux et éthanoliques de semences d’Ortie diminue a synthèse de produits pro-inflammatoires (diminution de l’activité 15-LOX), l’induction de l’apoptose, la nécrose et la synthèse mitochondriale d’anions superoxydes.
Propriétés antioxydantes
Un extrait éthanolique de feuilles d’Urtica dioica L., administré oralement à 50 ou 100 mg/kg chez la souris pendant 2 semaines, provoque une induction des activités antioxydantes des enzymes du cytochrome b5 (cyt b5), de la NADH-cytochrome b5 réductase (cyt b5 R), de la glutathion-S-transférase (GST), de la DT-diaphorase (DTD), de la glutathion peroxydase (GPx), de la glutathion réductase (GR), de la SOD et de la catalase (CM) au niveau hépatique, et pour certaines au niveau de l’estomac et des poumons. L’extrait diminue en revanche l’activité des enzymes oxydantes du cytochrome P450 (cyt P450), de La lactate déshydrogénase (LDH), de la NADPH-cytochrome P450 réductase (cyt P450 R) et des résidus sulfhydryles.
Une étude des marqueurs du stress oxydatif, de l’inflammation et des facteurs neurotrophiques au niveau cérébral chez le rat montre qu’une supplémentation phytothérapeutique avec 1 % de feuilles sèches d’Ortie pendant 8 semaines est susceptible d’exercer un effet antioxydant et probablement anti-apoptosique, avec diminution des taux de radicaux libres dans le cérébellum et te lobe frontal. En plus de cette supplémentation, l’exercice physique permet d’obtenir une augmentation de l’activité de liaison à l’ADN du facteur NE-KB et de la protéine activatrice AP-1.
On mesure une grande capacité antioxydante totale d’extraits hydro-alcooliques de diverses parties d’Urtica dioica L. (fleurs, racines, graines, feuilles) avec un piégeage important des radicaux libres anions superoxydes. L’activité de piégeage des radicaux libres obtenue avec des feuilles d’Urtica urens L. est comparable à celle de l’acide ascorbique. Certains vitamines et minéraux ainsi que les composés phénoliques, comme les flavonoïdes et les anthocyanes, sont en partie à l’origine des propriétés antioxydantes et anti-radicalaires de la plante.
Un puissant effet antioxydant est observé in vitro avec des extraits aqueux d’Urtica dioica L. à 50, 100 et 250 µg/mL, qui induisent respectivement 39, 66 et 98 % d’inhibition de la peroxydation d’une émulsion d’acide linoléique, contre 30 % avec 60 µg/mL d’α-tocophérol. L’extrait possède également une capacité réductrice avec piégeage des radicaux libres, de l’anion superoxyde, du peroxyde d’hydrogène, ainsi qu’une activité chélatrice des métaux.
Des extraits hydro-alcooliques d’Urtica dioica L, administrés en intra-péritonéal chez le rat mâle pendant 28 jours en association avec de la nicotine, inhibent les effets indésirables causés par la nicotine (stress oxydatif et dommages de l’ADN) sur des paramètres comme le nombre et la mobilité des spermatozoïdes, leur morphologie, le taux de testostérone.
Au niveau musculaire, les effets du stress oxydatif, généré chez le rat par l’application d’un « garrot tourniquet », peuvent également être prévenus par l’administration intranasale d’extraits de feuilles d’Urtica dioica L.
Dommages de l’ischémie/reperfusion : le potentiel antioxydant de la plante est également démontré sur du tissu musculaire ischémique chez un modèle in vivo de rat soumis à ischémie/reperfusion, où un traitement à base d’Ortie prévient te stress oxydatif et diminue les taux de MDA. Un prétraitement par Urtica dioica L. (2 mL/kg/jour) protège le rein ou le foie contre les dommages causés par l’ischémie/reperfusion par sa capacité à inhiber l’induction de ces dommages, l’apoptose et la prolifération cellulaire.
Prévention du cancer : des extraits aqueux de feuilles d’Urtica dioica L. montrent un effet antioxydant et antiprolifératif dose-dépendant in vitro sur des cellules de cancer du sein avec une augmentation de l’apoptose et de certains marqueurs protéiques (caspases, Bax, Bcl-2). Le potentiel chémoprotecteur de l’Ortie permet de diminuer l’activation de carcinogènes environnementaux par la modulation des enzymes de biotransformation du cytochrome CYP1A notamment (réduction des niveaux d’expression et de l’activité de CYP1A1 et CYP1A2). Un effet protecteur significatif d’infusions d’Urtica dioica L. contre les dommages oxydatifs induit par un carcinogène chimique, l’acide trichloracétique, a été démontré chez le rat. Une fraction protéique des parties aériennes de la plante possède également in vitro des propriétés anti-mutagènes contre le 2-aminoanthracène (peut-être par inhibition des iso-enzymes CYP450 impliquées dans la bio-activation des mutagènes) et anti-radicalaires pouvant contribuer à cet effet anti-mutagène.
2. Sphère ostéo-articulaire
Urtica dioica L. est utilisée traditionnellement en Europe et dans le nord de l’Amérique pour traiter des pathologies inflammatoires, de la sphère ostéo-articulaire en particulier.
Activité anti-inflammatoire
Propriétés anti-inflammatoires in vitro
Les propriétés anti-inflammatoires et analgésiques de l’Ortie ont été démontrées sur divers modèles animaux. L’œdème de la patte induit par carraghénates chez le rat est atténué par des extraits hydro-alcooliques ou hexaniques de feuilles d’Urtica dioica L.,qui révèlent une activité anti-inflammatoire comparable à celle de l’indométacine. Le mécanisme d’action implique une interférence avec la synthèse ou la libération d’histamine et de prostaglandines. Un extrait éthanolique des parties aériennes d’Urtica urens L. a également montré son efficacité, en partie du fait de la présence d’acide chlorogénique.
Un extrait éthanolique de feuilles d’Urtica dioica L. et son constituant phénolique principal, l’acide caféique malique, inhibent la biosynthèse des enzymes de la cascade arachidonique avec des effets partiels sur la synthèse de la 5-lipooxygénase et du leucotriène B4, ainsi qu’une forte inhibition dose-dépendante de la synthèse des prostaglandines dérivée de la cyclooxygénase (PGD2 et PDF2a). Le même extrait réduit significativement et de manière dose-dépendante la libération induite par le LPS du TNFα et de l’IL-4β, deux cytokines pro-inflammatoires.
Chez des rats souffrant de pancréatite aiguë induite par céruléine, l’administration d’extraits d’Urtica dioica L. atténue les dommages tissulaires et l’apoptose des cellules pancréatiques.
L’étude de divers extraits d’Ortie obtenus à partir de racines, tiges ou feuilles révèle une activité L anti-inflammatoire supérieure avec des extraits lipophiles comparés aux teintures classiquement utilisées (à base d’eau, méthanol, éthanol). Ces propriétés observées in vitro peuvent en partie expliquer les effets pharmacologiques et cliniques d’extraits d’Ortie dans les pathologies rhumatismales.
Des extraits de feuilles d’Ortie utilisés comme anti-inflammatoire dans l’arthrite rhumatoïde suppriment la production de cytokines, inhibent l’activation du facteur de transcription NF-κB, donc l’expression de gènes pro-inflammatoires, en empêchant la dégradation de sa sous-unité inhibitrice IκBα. Une étude du mode d’action anti-inflammatoire et anabolique d’extraits de feuilles d’Urtica dioica L. sur un modèle in vitro d’inflammation de chondrocytes articulaires montre en effet une suppression de l’activation du NF-KB induit par IL-1β par inhibition de la phosphorylation IκBα, dégradation d’IκBα, phosphorylation de p65 et translocation nucléaire p65, corrélant avec une régulation négative des cibles de NF-κB, dont COX-2 et certaines métalloprotéases matricielles (MMP). L’extrait inverse également la régulation négative de la synthèse du colla-cène induite par IL-1β, CSPG, β1-intégrine, et l’expression protéique du facteur de transcription cartilage-spécifique SOX-9.
Études in vivo dans l’ostéoarthrite
Plusieurs études précliniques démontrent le potentiel anti-inflammatoire de l’Ortie dans le traitement de pathologies arthritiques comme l’ostéoarthrite et suggèrent un mécanisme d’action impliquant l’inhibition des cellules dendritiques myéloïdes ou des cibles de la voie NF-κB. Sur dix études cliniques, on obtient cependant une efficacité variable dans le traitement de cette pathologie.
- Cinq études de cohorte comprenant plusieurs milliers de patients souffrant de pathologies arthritiques ou rhumatismales révèlent l’efficacité d’un extrait sec de feuilles dans le soulagement des symptômes douloureux au repos ou lors de la mobilisation, administré oralement à la posologie de 2 gélules de 335 mg 2 fois par jour (9,6 g de feuilles sèches par jour) pendant 3 semaines. Associé à des AINS, l’extrait d’Ortie potentialise l’effet analgésique, ce qui permet chez certains patients de diminuer (64 % des cas) ou d’arrêter les prises d’AINS (26 % des patients). L’efficacité à long terme de l’extrait de feuilles a été démontrée chez des patients où l’administration pendant un an de 2 gélules d’extrait2 fois par jour soulage la douleur chez 73 % des patients, diminue la rigidité et améliore le fonctionnement articulaire chez 63 %
Un extrait dosé à 145 mg d’extrait sec de feuilles, administré à raison de 3 gélules par jour pendant 3 mois à des patients arthrosiques, montre des résultats similaires avec une diminution de la douleur (42 %) et une amélioration de la rigidité et des fonctions articulaires (32 %).
Un traitement de douleurs articulaires ou musculaires par application externe de feuilles fraîches d’Ortie se révèle également efficace. Outre son action symptomatique, l’extrait de feuilles, en réduisant la formation de cytokines impliquées dans la pathogenèse de l’arthrose (IL-1β et TNFα), contribue à enrayer la progression de la maladie et à exercer un effet protecteur sur le cartilage.
- Études contrôlées. L’administration per os d’une association de 50 mg de diclofénac et de 50 g d’une purée d’Ortie (à partir de parties aériennes cuites à la vapeur) soulage les symptômes de poussées aiguës d’arthrite chez 40 patients avec une intensité équivalente à un traitement par 200 mg de diclofénac, posologie usuelle dans te traitement des douleurs rhumatismales. L’utilisation de l’Ortie permet donc de potentialiser l’activité de l’AINS et d’en limiter les doses. Chez 27 patients souffrant d’ostéoarthrite au niveau du pouce ou de l’index, une semaine d’application locale quotidienne pendant 30 secondes des faces inférieures de feuilles d’Urtica dioica L. sur les zones douloureuses montre une réduction significative des symptômes comparée au placebo. L’irritation causée par le traitement se révèle supportable. L’Ortie apparaît donc comme un traitement efficace dans les troubles articulaires mineurs, notamment grâce à l’action sur certaines cytokines impliquées dans la pathogenèse de l’arthrose. La plante possède, de plus, l’avantage de potentialiser l’action des AINS et donc de pouvoir en diminuer les doses et, par là-même, les effets indésirables.
3. Sphère génitale
Effet antiprolifératif prostatique
L’action de l’Ortie à plusieurs niveaux – inhibition de différents facteurs de croissance, de leurs récepteurs ainsi que d’enzymes impliquées dans la pathogenèse de l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) – peut constituer une approche thérapeutique intéressante de la pathologie prostatique.
Blocage de la fixation des facteurs de croissance EGF et bFGF sur leur récepteur
Un extrait méthanolique de racine d’Ortie à 20 ou certaines de ses fractions enrichies en polysaccharides sont les plus actifs sur l’inhibition de la croissance de cellules prostatiques hyperplasiques humaines issues de biopsies correspondant à divers stades de la pathologie. Les concentrations de récepteurs à EGF (epidermal growth factor) sont réduites avec certaines fractions. À faible concentration, t’extrait méthanolique réduit la prolifération cellulaire de cellules épithéliales et fibroblastes sans influencer l’activité microsomale de la 5a-réductase, suggérant un mécanisme androgènes-indépendant.
L’effet inhibiteur de l’extrait est corrélé à sa teneur en lectines, l’agglutinine ou UDA en particulier, et en polysaccharides. La lectine UDA de racine d’Urtica dioica L. inhibe de manière dose-dépendante la liaison de l’EGF aux membranes de cellules cancéreuses épithéliales humaines. La lectine UDA inhibe la liaison de EGF/bFGF (basic fibroblastgrowth factor) aux cellules HeLa, la liaison de EGF à des cellules cancéreuses épithéliales et l’activité tyrosine kinase des récepteurs EGF. La fraction 1T de la lectine UDA inhibe de 53 % la liaison de l’EGF à ses récepteurs dans des cultures in vitro de cellules prostatiques humaines.
Chez le chien souffrant d’HBP, une administration de 90 mg/kg d’extrait de racine méthanolique 20 % pendant 100 jours diminue de 30 % le volume de la prostate et le taux de testostérone sérique. Le même extrait n’a pas d’effet sur la croissance de la prostate stimulée par testostérone ou dihydrotestostérone (DFIT) chez le rat castré.
Au niveau histologique, l’administration quotidienne de 1200 mg d’un extrait sec de racine d’Ortie pendant 20 semaines chez 31 patients âgés de 58 à 62 ans induit un changement dans la morphologie des cellules d’adénome prostatique, potentiellement Lié à l’inhibition compétitive de la capacité de liaison de la SHBG (sex hormon binding globulin) par l’extrait. Un traitement similaire pendant 6 mois chez des patients souffrant d’HBP entraîne une diminution des granules homogènes dans les cellules hyperplasiques, indiquant une baisse de l’activité biologique de ces cellules. La présence de composés de racine d’Ortie ou de leurs métabolites est retrouvée dans les tissus prostatiques des patients traités par l’Ortie, ainsi qu’une fluorescence granulaire et un changement dans l’ultrastructure des cellules prostatiques musculaires lisses et épithéliales.
Effet sur les hormones sexuelles et la capacité de liaison de la SHBG
Avec l’âge, l’équilibre androgènes/œstrogènes est modifié et le taux de SHBG, protéine de transport plasmatique des androgènes et des œstrogènes, augmente. Ceci peut conduire à une hyperplasie prostatique compensatoire à la baisse des hormones circulantes. Divers extraits, fractions ou composés isolés de racine diminuent in vitro la capacité de liaison de la DHT à la SHBG. Si l’agglutinine seule est inactive, un mélange d’acides octadécanoïques, la plupart des lignanes et de leurs métabolites intestinaux présentent une affinité pour la SBHG humaine.
Inhibition de la liaison de la SHBG à son récepteur sur les membranes prostatiques
Par ailleurs, des extraits aqueux ou éthanoliques de racines d’Ortie inhibent de façon dose-dépendante la liaison de la SHBG aux récepteurs solubles dans des tissus prostatiques humains. On constate également lors d’études cliniques avec des extraits secs de la plante une diminution des taux de SHBG, les taux de PSA et de testostérone restant inchangés après 6 mois de traitement.
Inhibition de l’aromatase
Divers extraits de racine d’Ortie (méthanoliques, éthanoliques) inhibent de manière dose-dépendante l’enzyme aromatase impliquée dans la transformation de la testostérone en œstradiol, dont le rôle potentiel dans le développement de l’HBP est démontré chez l’animal. L’action serait due à des composés lipophiles (acides gras, acide 9-hydroxy-10,12-octadécadiénoique dérivé de l’acide linoléique) qui s’accumuleraient dans les tissus graisseux où a lieu l’aromatisation des androgènes. La racine d’Ortie inhiberait non seulement l’activité enzymatique mais également l’expression génique de l’aromatase.
Interaction avec la 5-α-réductase et liaison au récepteur des androgènes
De fortes concentrations d’extraits méthanoliques de racine inhibent l’activité de la 5-α-réductase, enzyme convertissant la testostérone en DHT, dont l’augmentation plasmatique est associée au développement de l’HBP. Au niveau de la prostate, la liaison de la DHT aux récepteurs cytosoliques aux androgènes est faiblement inhibée.
Inhibition de l’ATPase Na+/K+ dépendante et de la croissance tissulaire
Dans des tissus humains de patients atteints d’HBP, des extraits organiques de racine d’Urtica dioica L. inhibent l’activité de l’ATPase Na+/K+ dépendante de la membrane plasmatique, et donc la liaison des androgènes au niveau du récepteur aux stéroïdes des cellules cibles prostatiques. Certains constituants hydrophobes de la racine comme les composés stéroïdiques (stigmast-4- en-3-one, stigmastérol, campéstérol) inhibent l’activité de l’enzyme, enrayant ainsi le métabolisme et la croissance des cellules prostatiques.
Inhibition de l’activité adénosine désaminase
Un des mécanismes pouvant expliquer l’effet bénéfique de l’Ortie dans le traitement du cancer de la prostate est son effet inhibiteur sur l’activité de l’adénosine désaminase, démontrée in vitro sur tissus prostatiques de patients atteints de cancer avec un extrait aqueux de feuilles d’Urtica dioica L.
In vivo, chez L’animal
Des études randomisées sur des modèles animaux d’HBP induite par testostérone démontrent l’intérêt d’extraits d’Ortie administrés seuls ou en association par voie orale dans la prévention ou l’atténuation des symptômes urinaires liés à la compression de l’urètre.
Propriétés anti-inflammatoires et immuno-modulatrices
L’HBP est souvent associée à une inflammation chronique de la prostate ou prostatite, qui peut être un facteur causal dans l’apparition de la pathologie. Par ailleurs, l’analyse des tissus prostatiques normaux et hyperplasiques révèle des différences quantitatives et qualitatives marquées au niveau des sous-populations lymphocytaires. La libération de cytokines par les leucocytes induit une inflammation et une prolifération cellulaire. Les propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices de l’Ortie apparaissent donc intéressantes dans le traitement de l’HBP.
Activité anti-inflammatoire
Un extrait aqueux brut de racine ou une fraction isolée riche en polysaccharidiques possèdent après administration intra-gastrique un effet anti-inflammatoire prolongé comparable à celui de l’indométacine dans le modèle d’œdème de la patte induit par carraghénates chez le rat.
L’activité anti-inflammatoire d’un extrait éthanolique de racine peut également se traduire par l’inhibition de l’enzyme élastase leucocytaire humaine (HLE), considérée comme un marqueur biochimique de l’inflammation prostatique.
On observe également une suppression de la production d’oxyde nitrique induite par LPS dans des macrophages marins péritonéaux soumis à un extrait aqueux d’Urtica dioica L., sans changement de la viabilité cellulaire.
Immunostimulant in vitro
L’effet immuno-modulateur s’observe in vitro avec divers extraits d’Ortie ou certains constituants isolés comme les lectines ou des polysaccharides (rhamnogalacturanes, arabinogalactanes), qui stimulent in vitro la production de lymphocytes T et influent sur les voies d’activation du complément.
L’UDA est une lectine particulière différant des autres lectines végétales par sa structure moléculaire et son activité très faible d’agglutination. L’UDA est un mitogène des cellules T capable de discriminer une population particulière de lymphocytes CD4+ et CD8+ et de conduire à un profil d’induction particulier de l’activation des cellules T et de la production de cytokines comme l’interféron γ. Au vu de son mécanisme d’action, on peut l’assimiler à la famille des superantigènes avec laquelle elle partage la capacité d’activer les sous-unités des lymphocytes T.
L’UDA peut agir comme un antigène et se lier à de nombreuses glycoprotéines membranaires impliquées dans le complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) et entraîner l’activation des lymphocytes T.
Une activité immunostimulante surles polynucléaires neutrophiles a également été démontrée avec une fraction flavonoïde et ses principaux composés (quercétine-3-0-rutinoside, kaempférol-3-0-rutinoside et isorhamnétine-3-0-glucoside), isolés d’un extrait méthanolique des parties aériennes d’Urtica diorca L.
Immuno-modulation in vivo
Une complémentation diététique à base d’Urtica dioica pendant 1 à 4 mois chez des poissons ou des mammifères marins améliore certains paramètres biochimiques (diminution cortisol plasmatique, triglycérides et cholestérol, glucose, augmentation protéines totales et albumine), hématologiques (augmentation taux d’hématies, Leucocytes, hématocrite, hémoglobine, neutrophiles) et immunologiques avec une augmentation des immunoglobulines sériques, de l’activité du lysozyme, du « burst oxydatif ». Une incorporation d’Orties dans la diète permet également d’augmenter la résistance aux agressions et le pourcentage de survie face à une infection bactérienne.
Chez la souris, l’UDA est susceptible de prévenir le développement de pathologies du type lupus érythémateux disséminé.
Activité décongestionnante pelvienne
Chez la femme, la congestion pelvienne résulte d’une dilatation anormale des veines responsable d’une stase veineuse au niveau du petit bassin, secondaire à une altération du retour veineux pelvien. En lien avec sa teneur en tanins qui lui confèrent des propriétés astringentes et vasoconstrictrices favorisant la tonicité des veines, la plante présente une activité décongestionnante pelvienne. En partie grâce à ses effets anti-inflammatoires, elle peut soulager chez l’homme le syndrome des douleurs pelviennes chroniques causées par des spasmes musculaires au niveau du plancher pelvien, et liées au stress ainsi qu’à l’anxiété et accompagnées de signes d’inflammation des tissus de la zone urogénitale, et d’un taux anormal de cytokines dans les sécrétions prostatiques.
Données des observations cliniques
Études à court terme
Dans quelques études à court terme, chez des patients atteints d’HBP aux stades 1 ou 2, une dose quotidienne de 600 mg d’extrait sec pendant plusieurs semaines entraîne une différence significative au niveau de paramètres objectifs : amélioration significative du score IPSS (international prostate symptom score), augmentation du débit urinaire maximum (Qmax), du volume miction-net, diminution du résidu post-mictionnel (-40 % versus -8 %), diminution du taux plasmatique de SHBG, sans toutefois de différences notoires au niveau des symptômes subjectifs.
Études à Long terme
Dans plusieurs études cliniques sur des patients atteints d’HBP, la racine d’Ortie présente une efficacité supérieure dans la réduction des symptômes (score IPSS, PSA sérique, taille de la prostate, amélioration de la qualité de vie) comparée au placebo. Une réduction des symptômes cliniques est ainsi observée chez 100 patients âgés de 40 à 80 ans atteints d’HBP après administration de deux gélules de 300 mg, 2 fois par jour pendant 8 semaines. Une étude contrôlée en double aveugle versus placebo chez plus de 600 patients montre que 6 mois de traitement avec 120 mg d’extrait fluide de racine d’Urtica diorca L., administrés 3 fois par jour, entraînent une amélioration significative des symptômes subjectifs et des paramètres objectifs : atténuation des symptômes des voies urinaires basses chez 81 % contre 16 % dans le groupe placebo ; amélioration du score IPSS, du Qmax et du débit urinaire supérieure avec le traitement par Ortie ; diminution du volume résiduel, légère diminution de la taille de la prostate ; taux de testostérone et de PSA inchangés. Après les 6 premiers mois d’étude et la levée du double aveugle, les sujets ont choisi de poursuivre le traitement par Urtica dioica L. pendant 18 mois. À l’issue de cette période supplémentaire, 75 % des patients du groupe placebo initial ont opté pour la phytothérapie au regard des résultats satisfaisants obtenus (équivalent à ceux qui avaient reçu le traitement par Ortie dès le début) et des effets bénéfiques de la racine d’Ortie dans le traitement symptomatique de l’HBP.
4. Autres propriétés
Propriétés diurétiques et hypotensives
Un extrait aqueux des parties aériennes d’Urtica dioica L., administré par perfusion intraveineuse à la dose de 4 mg/kg/h chez le rat, agit sur la fonction rénale par un effet diurétique et natriurétique.
Un extrait méthanolique des parties aériennes d’Urtica dioica L. – contenant acides protocatéchique, salicylique, chlorogénique, lutéoline, gossypétine, rutine, hétérosides du kaempférol -montre une activité a anti-urolithiasique » sur des calculs rénaux d’oxalate de calcium (lithiase) induits chez le rat. On observe une diminution des concentrations urinaires de calcium, d’oxalate et de créatinine, ainsi que des dépôts de cristaux au niveau rénal.
Propriétés anti-ulcéreuses
On observe l’activité protectrice anti-sécrétoire gastrique et anti-ulcéreuse d’extraits de feuilles chez l’animal sur divers modèles d’ulcères induits par l’acide salicylique, l’histamine, la prednisolone, le stress ou encore la ligature du pylore.
Propriétés anti-allergiques
Les propriétés antihistaminiques de l’Ortie par voie orale pourraient provenir d’un processus d’inhibition autacoïde ou par feedback sur l’histamine et les composés apparentés (sérotonine, acétylcholine), eux-mêmes contenus dans les poils urticants de la plante et fortement impliqués dans les symptômes allergiques.
Un extrait d’Urtica dioica L inhibe in vitro des processus inflammatoires clefs impliqués dans les symptômes des allergies saisonnières comme la rhinite. La plante possède une activité antagoniste et agoniste négative contre les récepteurs H1 à l’histamine et empêche la libération de tryptase par les mastocytes, prévenant la dégranulation et la libération d’autres médiateurs pro-inflammatoires. La synthèse des prostaglandines est inhibée via l’inhibition des enzymes centrales des vies pro-inflammatoires comme les COX-1 et COX2 et la prostaglandine D2 synthase (PGDS). Les effets anti-inflammatoires de la plante, par inhibition de l’activation du NF-κB et de la transcription de gènes pro-inflammatoires (IL-1, 2, 6 et 8, TNFα, adhésives, CMH I, iNOS, COX-2), jouent également un rôle dans l’atténuation des symptômes allergiques.
Dans le traitement de la rhinite allergique, une étude randomisée en double aveugle versus placebo permet de mettre en évidence chez 57 % des patients traités l’intérêt d’un lyophilisat d’Urtica dioica L. dans le soulagement des symptômes, 48 % déclarant un effet équivalent ou supérieur aux traitements conventionnels précédemment administrés.
Propriétés eutrophiques conjonctives et hémostatiques
L’Ortie montre également des effets eutrophiques, en particulier sur le tissu conjonctif. Ainsi, sur 40 rats traités pour brûlures du deuxième degré par des applications locales quotidiennes de sulfadiazine argentique, vaseline ou d’extraits d’Ortie, on observe avec ces derniers une cicatrisation significativement meilleure à dix jours. Ces propriétés pourraient être liées à la présence de silicium dans la plante qui accélère le processus cicatriciel et joue un rôle important dans la restructuration des fibres d’élastine et de collagène. Par ailleurs, la forte teneur en tanins confère à l’Ortie des propriétés astringentes et hémostatiques cutanéo-muqueuses.
Propriétés cardiovasculaires
Propriétés hypotensives : la réponse hypotensive traduit un effet direct de la plante sur le système cardiovasculaire. L’effet diurétique et hypotenseur des feuilles est confirmé par une étude clinique ouverte chez 32 patients souffrant d’insuffisance cardiaque ou veineuse chronique, traités pendant 2 semaines par absorption quotidienne de 3 fois 15 mL de jus de parties aériennes. Ce traitement induit une augmentation significative globale du volume urinaire journalier tout au long du traitement, atteignant au deuxième jour 9,2 % chez les insuffisants cardiaques et 23,9 % chez les insuffisants veineux. On obtient parallèlement une légère diminution du poids corporel et de la pression sanguine systolique. La plante agirait au niveau de l’endothélium vasculaire, des extrait aqueux de racines ainsi que des fractions purifiées montrant une action vasodilatatrice in vitro seulement sur des préparations aortiques possédant une couche endothéliale fonctionnelle. L’effet se confirme in vivo où Urtica dioica L. induit une réponse hypotensive, via un effet vasorelaxant médié par la libération d’oxyde nitrique (NO) au niveau de l’endothélium vasculaire et une ouverture des canaux potassiques, ainsi que par une action inotrope négative.
Hypocholestérolémiant : plusieurs études in vivo chez l’animal montrent que des extraits de feuilles d’Urtica dioica L., administrés à raison de 100 à 300 mg/kg/j pendant 30 jours à des rats soumis à un régime alimentaire normal ou riche en graisses, améliorent le profil lipidique sanguin de l’animal. On note une diminution significative du cholestérol total, du LDL-cholestérol, du ratio LDL/HDL-cholestérol et de l’apoB plasmatique totale. L’activité inchangée des enzymaties hépatiques GOT, GPT (AST, ALT) et LDH et l’absence de stéatose ou d’inflammation hépatique montent que le foie n’a pas subi de dommages.
Inhibition plaquettaire : divers extraits de la plante possèdent un effet inhibiteur sur l’agrégation plaquettaire in vitro, impliquant principalement les flavonoïdes, et potentiellement utile dans la prévention des troubles cardiovasculaires.
Propriétés antimicrobiennes
Bactéries : des extraits hydro-alcooliques d’Urtica dioica L. montrent un effet antibactérien significatif in vitro par inhibition de la croissance de bactéries Gram+ ou Gram- comme Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli ou Vibrio parahaemolyticus. Pour certaines bactéries telles que E. faecalis, E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, Staphylococcus aureus, S. flexneri et S. typhi, l’activité antibactérienne se révèle comparable à celle de la gentamycine. La plante est également active sur des souches de bactéries résistantes comme le staphylocoque doré résistant à la méthicilline isolé d’infections de peau ou de plaies.
Mycobactéries
Des extraits d’Ortie se montrent actifs sur des souches multirésistantes de Mycobacterium tuberculosis, vraisemblablement du fait de la présence de terpénoïdes.
Virus
La lectine monomérique UDA, qui se lie spécifiquement à la N-acétylglucosamine, possède in vitro une activité sur les virus de l’ordre des Nidovirales. UDA inhibe la réplication de diverses souches du coronarovirus SARS-CoV de manière dose-dépendante et peut réduire la charge virale jusqu’à 90 % dans les cellules Vero 76 in vitro, vraisemblablement par action sur les stades précoces du cycle de réplication, comme l’absorption ou la pénétration. La lectine se lierait aux résidus N-acétylglucosamine-like présents sur l’enveloppe glycosylée des glycoprotéines, empêchant ainsi l’arrimage du virus à la cellule. Sur un modèle de souris léthalement infectée par le virus, un traitement par la lectine UDA à 5 mg/kg révèle un effet thérapeutique certain qui protège l’animal contre la perte de poids et la mort.
Propriétés anxiolytiques
Des extraits méthanoliques de Petite ortie Urtica urens L, traditionnellement utilisée comme tranquillisant au Maroc, et administrés per os à la dose de 100 à 400 mg/kg chez la souris soumise à divers tests révèlent des propriétés anxiolytiques comparables à celles du diazépam (1 mg/kg en intrapéritonéal), mais sans effets indésirables sur la locomotion.
C. Principales formes galéniques utilisées et posologie
Les formes galéniques principales sont conditionnées par l’action thérapeutique recherchée. Les formes apportant le totum de la plante comme les SIPF (soluté intégral de plante fraiche) ou la poudre micronisée seront recherchées pour un effet reminéralisant. Les autres formes galéniques comme l’extrait de plante standardisé (EPS), la teinture mère (TM), l’extrait fluide (EF), les extraits secs et les tisanes seront plus généralement sélectionnées dans les autres indications.
1. Voie interne
pour les feuilles ou parties aériennes d’Ortie
Formes liquides
Soluté intégral de plante fraiche : 2 cuillères à café le matin, à diluer dans de l’eau.
Extrait de plante standardisé : 2 cuillères à café/jour.
Teinture mère (obtenue à partir de la plante entière fleurie fraîche) : 20 à 50 gouttes, 2 à 3 fois/jour.
Extrait fluide : 2 à 4 cuillères à café/jour.
Infusion de plante sèche : 50 g pour 1 litre d’eau, laisser infuser 10 minutes, boire 3 à 6 tasses/jour.
Extrait fluide glycériné miellé : 1 cuillère à café dans un grand verre d’eau, 3 fois/jour.
Formes solides
Gélules de poudre micronisée d’Ortie, dosées de 200 à 400 mg : 2 à 4 gélules/jour, mais possibilité de doses plus élevées.
Microsphères Se : 1 à 2 doses/jour (avec une équivalence de 100 gouttes de TM annoncée pour une Josette de 0,20 g).
pour la racine d’Ortie
Formes liquides
Extrait de plante standardisé : 1 à 2 cuillères à café/jour.
Teinture mère (obtenue à partir de la plante entière fleurie fraiche) : 20 à 50 gouttes, 2 à 3 fois/jour.
Extrait fluide : 1 à 3 cuillères à café/jour.
Décoction de racine sèche : 30 à 50 g pour 1 litre d’eau, porter à ébullition 3 minutes, puis infusion de 10 minutes, boire 2 à 3 tasses/jour.
Formes solides
Gélules de poudre micronisée de racine, dosées à 200 à 300 mg : 2 à 3 gélules/jour.
Gélules d’extrait sec dosées à 100 à 200 mg : 1 à 3 gélules/jour.
2. Voie externe
Suc frais de feuilles d’Ortie en application locale, sur les articulations notamment (cataplasmes, lotions)
D. Effets secondaires, contre- indications, toxicité
1. Pharmacologiquement
Toxicité : aucune toxicité aiguë ou chronique connue aux doses thérapeutiques. La DL50 a été calculée pour plusieurs types d’extraits :
DL50 = 3,625 g/kg, pour un extrait aqueux de plante entière administré par voie intra-péritonéale chez la souris.
DL50> 30 g/kg pour un extrait de racine administré par voie orale chez le rat.
DL50 = 1929 mg/kg pour une infusion de racines administrée par voie intraveineuse.
2. Effets secondaires et contre-indications selon l’approche clinique intégrative
Effets secondaires
La plante est bien tolérée et l’incidence des effets indésirables faible.
Aucun effet secondaire conséquent. De rares troubles gastro-intestinaux légers (nausées, diarrhées, météorisme) ont été décrits avec la racine. D’autre part, de rares réactions allergiques cutanées (prurit, rash, urticaire) peuvent survenir avec les feuilles.
Contre-indications
- Œdème lié à une insuffisance cardiaque ou rénale (feuilles).
- Hypersensibilité à l’Ortie.
E. Précautions d’emploi
Précautions d’emploi en cas d’énurésie. Potentialisation en cas d’association avec d’autres diurétiques.
Par manque de données, l’EMEA ne recommande pas l’utilisation de cette plante chez l’enfant de moins de 12 ans, durant la grossesse et l’allaitement.
Interactions : aux doses thérapeutiques recommandées pour l’Ortie (dose maximale journalière de 15 g), l’apport de vitamine K1 par la plante (26 à 96µg) représente moins de 1 % de la dose de vitamine k1thérapeutique préconisée (10 à 20 mg/jour), d’où pas d’interaction en cas de traitement anticoagulant.
F. Propriétés cliniques issues d’une analyse physiologique intégrative
Tropisme principal : sphères métabolique, ostéo-articulaire, génitale, endocrinienne (axe hypophyso-gonadique).
Tropisme secondaire : sphères rénale, cutanée et vasculaire.
1. Au niveau symptomatique
Voie interne
Sphère métabolique : reminéralisant, reconstituant ; anti-anémique (hématopoïèse) ; anti-hyperglycémiant ; hépatoprotecteur ; antioxydant.
Sphère ostéo-articulaire : trophique ostéo-articulaire ; anti-inflammatoire, antalgique antirhumatismal.
Sphère génitale (racine d’Ortie) : antiprolifératif prostatique ; anti-inflammatoire ; immuno-modulant.
Sphère gastro-intestinale : eupeptique ; anti-gastritique ; anti-ulcéreux ; hypolipémiant.
Sphère vasculaire : inotrope négatif ; antihypertenseur léger ; antihémorragique (suc frais).
Sphère cutanée : trophique : restauration des tissus de soutien ; stimulation de la pousse des phanères ; anti-inflammatoire (Zn).
Autres : anti-allergique.
Voie externe
Cutanéo-muqueuse : astringent ; hémostatique ; anti-inflammatoire.
2. Au niveau du drainage
- Rénal : diurétique volumétrique, uricosurique et chlorurique.
- Hépatobiliaire cholagogue léger.
- Cutané : dépuratif.
- Génital : décongestionnant pelvien (racine d’Ortie).
3. Au niveau de la régulation neuroendocrinienne
Propriétés neurovégétatives
- Parasympathomimétique, avec les feuilles : pΣ+.
Propriétés endocriniennes
- Axe gonadotrope (racine) : augmentation des androgènes libres ; blocage de l’action des SHBG.
- Axe somatotrope (racine) : inhibition des facteurs de croissance prostatiques locaux ; insuline+.
G. Indications en phytothérapie clinique intégrative
En phytothérapie clinique intégrative, le choix de la plante médicinale doit toujours répondre d’un raisonnement endobiogénique intégrant à la fois :
- la fonctionnalité endocrinienne de l’individu considéré dans son ensemble ;
- l’enchaînement dynamique des axes hormonaux dans leur chronologie et leur relativité respectives
- les raisons de la désadaptation de la réponse physiologique face aux nécessités métaboliques.
En phytothérapie clinique intégrative, les indications de l’Ortie sont essentiellement les pathologies :
– pour la racine : sphères génitale et cutanée ;
– pour les feuilles : sphères ostéo-articulaire et métabolique.
1. Indications principales, per os
Racine
- Sphère génito-urinaire :
- hypertrophie bénigne de la prostate, adénome prostatique ;
- troubles de la miction d’origine prostatique : nycturie, pollakiurie, résidu mictionnel ;
- inflammation des voies urinaires basses avec congestion pelvienne : prostatite, cystalgie, cystite à « urines claires », en complément dans certaines cystites ou vaginites ;
- en complément dans certains fibromes.
- Sphère cutanée :
- alopécie androgénique ;
- acné avec hyper-androgénie chez le jeune adolescent.
Feuilles
- Sphère ostéo-articulaire, pour toutes les pathologies nécessitant une mobilisation minérale :
troubles de la trophicité ostéo-articulaire ;
troubles de la minéralisation osseuse (ostéoporose, retard de consolidation de fracture) ;
articulations ou rhumatismes douloureux : action de drainage (en plus de ses propriétés anti-inflammatoire et antalgique) ;
rhumatismes inflammatoires, arthrites ; – troubles de croissance du cartilage : ostéochondrites juvéniles ;
arthrose.
- Sphère métabolique :
asthénie essentielle ou réactionnelle, inappétence de la convalescence, asthénie post-infectieuse ou postopératoire ;
comme draineur hépatique et rénal chez certains asthéniques ;
comme adjuvant dans certaines cirrhoses hépatiques ;
en prévention d’une protection vasculaire (propriétés trophiques) pour les personnes légèrement hypertendues et/ou prédiabétiques.
- Sphère cutanée :
- acné simple, peau séborrhéique ;
- chute de cheveux, ongles cassants ;
- vergetures (prévention).
2. Indications secondaires, feuilles
Per os
Sphère rénale : maladies inflammatoires des voies urinaires ; drainage préventif des lithiases urinaires.
Sphère cutanée : acné simple, peau grasse dévitalisée ; chute de cheveux, ongles cassants ; vergetures (prévention).
En externe
- Gingivite.
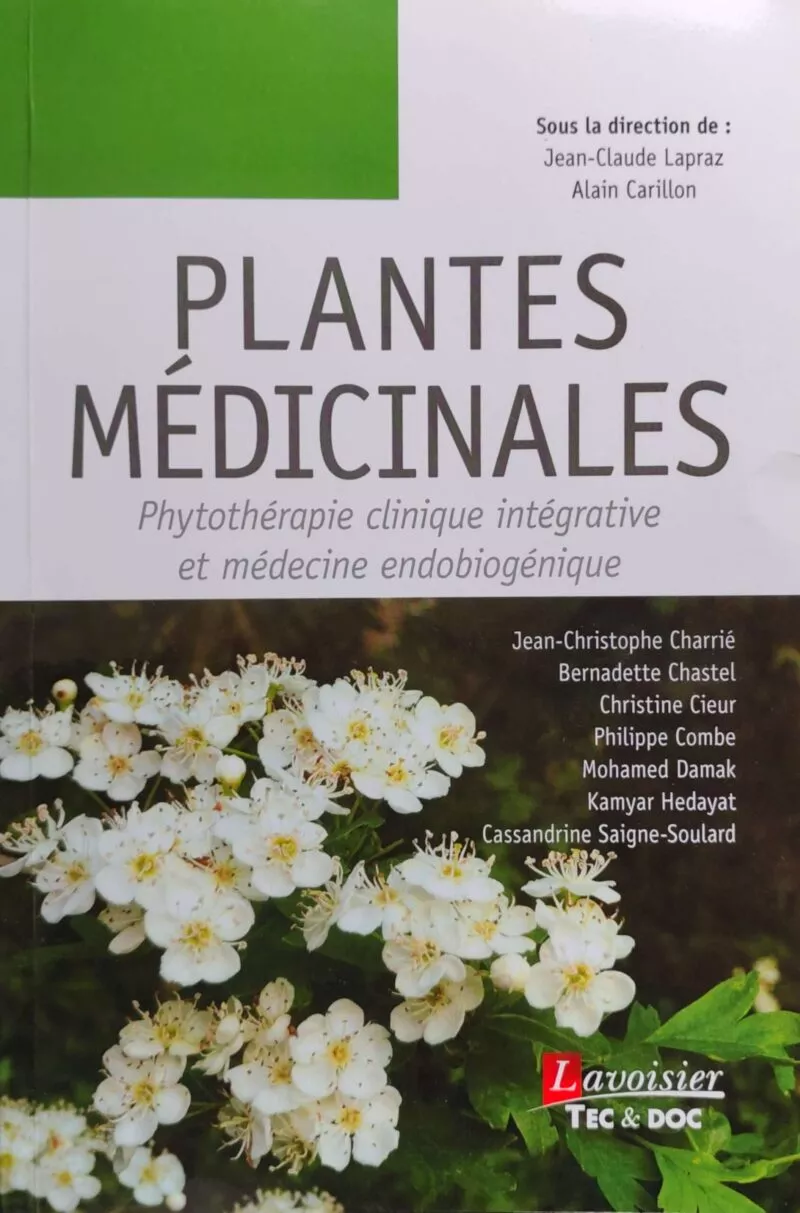
Pour en savoir +
Pour accéder à des informations plus détaillées et aux références bibliographiques qui permettent d’étayer les éléments présentées dans cet article, consultez le livre « Plantes médicinales », édité par Lavoisier TEC&DOC.
Plusieurs formateurs de l’Institut d’endobiogénie ont contribué à sa rédaction.



