- Guide des plantes
Myrtille (Vaccinium myrtillus) : propriétés et bienfaits
La Myrtille : une baie aux vertus thérapeutiques reconnues, agissant sur les sphères métabolique, vasculaire, digestive et ophtalmique, grâce à ses propriétés antioxydantes, hypoglycémiantes, anti-inflammatoires et protectrices de la microcirculation.

Ce qu’il faut retenir…
Dans le cadre d’une phytothérapie clinique intégrée dans une réflexion endobiogénique, la Myrtille se présente comme une plante prioritairement active :
– au niveau pharmacologique direct : sur la sphère métabolique, vasculaire, ophtalmique, digestive, immunitaire et génito-urinaire ;
– au niveau du drainage : rénal et intestinal ;
– au niveau endocrinien : sur l’axe somatotrope.
A. Usage traditionnel de la Myrtille
Depuis l’Antiquité, la myrtille est reconnue pour ses vertus médicinales, bien que les témoignages anciens soient rares. Dioscoride la recommandait contre la dysenterie, et au Moyen Âge Hildegarde de Bingen lui attribuait des effets sur le sang et les menstruations.
En médecine populaire européenne, les baies étaient utilisées pour leurs propriétés astringentes, antiseptiques et toniques, principalement contre la diarrhée, la dysenterie, les inflammations gastro-intestinales, les hémorroïdes, les affections buccales et urinaires. Elles aidaient aussi à réguler le transit et à réduire les gaz. Leur pigment, riche en anthocyanes, a montré un effet protecteur sur la circulation veineuse et la vision nocturne — popularisé notamment par les pilotes britanniques durant la Seconde Guerre mondiale.
Les feuilles, quant à elles, étaient réputées pour leurs effets hypoglycémiants, utilisées comme une « insuline végétale » contre le diabète, et contre les infections urinaires. En usage local, les décoctions servaient en gargarismes (maux de gorge, affections buccales), en collyres (inflammations oculaires) et sur la peau (infections, brûlures).
Au-delà des soins, la myrtille reste un fruit apprécié en cuisine, tandis que l’industrie pharmaceutique et alimentaire l’exploite dans des compléments, médicaments et comme colorant naturel (E163).
B. Données expérimentales et cliniques issues directement de la pharmacologie
1. Sphère métabolique
Activité hypoglycémiante
Parmi toutes les substances antidiabétiques répertoriées avant la découverte de l’insuline, la Myrtille apparaît en bonne place et elle est retrouvée dans de nombreuses préparations antidiabétiques commerciales du XXe siècle. Les feuilles sont la partie de la plante la plus utilisée. L’activité antidiabétique est largement attribuée à la présence de polyphénols, dont les anthocyanosides. Dans de nombreuses études, l’action de la Myrtille résulte d’une augmentation de la sécrétion d’insuline, de la réduction de la résistance à l’insuline et de la régénération des cellules bêta dont la taille est significativement augmentée. L’ingestion d’un extrait concentré de Myrtille (contenant 36 % d’anthocyanosides) chez des patients diabétiques contrôlés par un régime alimentaire et un mode de vie adapté réduit la glycémie postprandiale, et le taux d’absorption et de métabolisme des hydrates de carbone. L’action du cyanidin-3-0-glucoside a été comparée à celle de l’acarbose.
Effet hypo-triglycéridémiant
Chez le rat présentant un syndrome métabolique après induction de diabète par streptozocine, un extrait hydro-alcoolique de feuilles de Myrtille administré per os permet de diminuer le niveau de glucose plasmatique d’environ 26 % et celui de triglycérides plasmatiques de 39 %. L’extrait de Myrtille exerce ainsi une activité hypolipémiante dose-dépendante en stimulant le catabolisme des lipoprotéines riches en triglycérides. Les propriétés hypolipémiantes du cyanidin-3-0-glucoside sont comparables à celles du ciprofibrate.
Propriétés hypocholestérolémiantes
Chez le rat rendu diabétique par alloxane, dans une étude comprenant un lot traité par glibenclamide, un autre par de la poudre de Myrtille (2 g/ jour) et un lot témoin, les résultats indiquent que la supplémentation en Myrtille permet une augmentation du taux d’insuline, une réduction du cholestérol total, du LDL cholestérol, et du VLDL cholestérol, alors que le HDL maintient son niveau, mais sans augmentation.
2. Sphère vasculaire
Activité vasoprotectrice
Comme pour les flavonoïdes, les tests biologiques entrepris sur l’animal ont montré que les anthocyanosides diminuent la perméabilité des capillaires, augmentent leur résistance et exercent un effet anti-œdémateux, participant ainsi à la prévention des accidents cardiovasculaires. L’apport alimentaire en anthocyanosides est largement tributaire de la consommation de fruits rouges. En ce qui concerne la Myrtille, les trois actions précitées ont été étudiées aussi bien in vitro qu’in vivo. Les tanins sont également connus pour exercer sur la paroi vasculaire ces mêmes propriétés.
Une préparation d’anthocyanosides de V. myrtillus (équivalente à 25 % d’anthocyanosides) administrée per os ou par voie intra-péritonéale chez le lapin, montre une réduction de la perméabilité capillaire de la peau préalablement stimulée par le chloroforme, l’histamine ou la bradykinine. Cette réduction augmente dans le temps. Chez le rat, une étude comparative de l’activité angioprotectrice des anthocyanosides extraits de Vitis vinifera L., V. myrtillus L., et Pinus pinaster Aiton établit l’ordre décroissant suivant : anthocyanosides de Vitis vinifera > anthocyanosides de V. myrtillus > proanthocyanosides de Pinus pinaster. Les auteurs soulignent que les anthocyanosides exercent une activité anti-protéase (in vitro) et des activités inhibitrices vis-à-vis d’enzymes protéolytiques telles que l’élastase intervenant dans la dégradation du tissu conjonctif. Cette activité anti-protéase se traduit par une inhibition de la libération des peptides vasoactifs (histamine, 5-hydroxytryptamine, kinines). Les extraits étudiés présentent également une activité anti-trypsique et antichymotrypsique (protéases digestives). Il est aussi noté que les anthocyanosides restent longtemps dans les tissus de la peau, riches en collagène et en mucopolysaccharides. Dans une autre étude d’ischémie-reperfusion (au cours de laquelle on observe classiquement une augmentation du nombre de leucocytes adhérant aux veinules, une diminution du nombre de capillaires perfusés et une augmentation de la perméabilité capillaire) l’administration d’un extrait de Myrtille permet de réduire le nombre de leucocytes adhérant à la paroi des veinules et de préserver la perfusion capillaire.
Les anthocyanosides de V. myrtilles administrés par voie intra-péritonéale à des rats préalablement alimentés pendant 4 semaines avec une alimentation déficitaire en facteur P conduisant à une fragilité capillaire, permet une élévation remarquable de la résistance capillaire de la peau. Cette activité est maximale 4 heures après le traitement et reste invariable après 6 heures. Pour la même action, il faut utiliser 200 mg/kg de rutine, alors qu’à 100 mg/kg, celle-ci n’est presque plus efficace. Par ailleurs, cette activité « vitamine P » est corrélée à une augmentation du taux de vitamine C intracellulaire.
Dans l’étude précédente, les auteurs ont montré que l’administration d’anthocyanosides de Myrtille par voie orale ou par voie intraveineuse, respectivement 15 et 60 min précédant l’injection de carragénine, permet de diminuer l’œdème de la patte chez le rat de façon dose-dépendante, la dose de 200 mg/kg étant plus efficace que celle de 50 mg/kg, et entraînant une réduction de l’œdème de 45 %.
Plus récemment, une étude de Mauray a démontré l’intérêt d’une supplémentation alimentaire en extrait de Myrtille pour limiter la progression des lésions athérosclérotiques dans un modèle de souris déficitaire en apolipoprotéine E. Cette action inhibitrice du développement de la plaque athéromateuse est indépendante du statut antioxydant de la Myrtille, suggérant l’implication d’autres mécanismes d’action. De plus les extraits utilisés se montrent plus actifs s’ils sont fermentés, les anthocyanosides se condensant au cours de la fermentation avec d’autres composés présents dans le fruit.
En clinique, les anthocyanosides de V. myrtillus (480 mg per os pendant 30 jours) ont montré leur capacité à diminuer les symptômes subjectifs (douleurs, paresthésies…) et objectifs (œdème des membres inférieurs, phénomènes dyschromiques de la peau) de patients atteints du syndrome variqueux des membres inférieurs (MI), ainsi que des patients souffrant de fragilité capillaire et pour lesquels une administration orale d’anthocyanosides de Myrtille (160-800 mg/jour) réduit les symptômes cliniques dus à une résistance capillaire diminuée (pétéchies, contusion, sang fécal occulte). L’efficacité du même extrait de Myrtille a été démontrée sur des patients diabétiques, dyslipidémiques, souffrant de maladies secondaires à une stase des membres inférieurs telles que syndrome pré-variqueux, varices essentielles, syndrome post-phlébitique, maladies vasculaires athérosclérotiques. Une étude en double aveugle portant sur 47 patients a démontré L’efficacité de l’extrait de Myrtille (Myrtocyan 480 mg) dans la réduction de la douleur, des paresthésies, de l’œdème, de la mobilisation des extrémités des doigts chez les patients avec syndrome de Raynaud. Une autre étude, incluant 568 patients souffrant d’insuffisance veineuse des MI, a montré la capacité de l’extrait à améliorer la microcirculation et te drainage lymphatique. L’utilisation d’un extrait de Myrtille (320 mg/jour) pendant 60 à 90 jours a été efficace pour réduire chez la femme enceinte les symptômes résultant de phlébites secondaires à la stase veineuse. Enfin, chez les patients asthmatiques atteints de bronchite chronique un extrait de Myrtille (480 mg/jour) administré pendant 10 à 30 jours permet de réduire les modifications microcirculatoires induites par la corticothérapie.
Activité anti-inflammatoire
En plus de leur action anti-œdémateuse vue précédemment, certains anthocyanes de la Myrtille ont montré une capacité à inhiber l’expression de la COX-2, en particulier le delphinidol et Le cyanidol. In vitro, l’extrait total de Myrtille inhibe de façon significative et dose-dépendante l’expression des marqueurs pro-inflammatoires TN Fa et IP-10 dans des cultures de cellules épithéliales de côlon humain. Plusieurs études ont ainsi démontré l’action positive des extraits de Myrtille dans les maladies inflammatoires du tube digestif, que ce soit des colites aiguës ou chroniques ou des inflammations gingivales, les anthocyanosides se comportant comme des modulateurs d’inflammation. De ce fait, la Myrtille prévient également la progression de l’augmentation de la pression artérielle systolique chez la souris rendue obèse.
Effet antiagrégant plaquettaire
C’est Botecchia en 1987 qui initia les études des extraits de Myrtille sur l’agrégation plaquettaire. In vitro, on observe une inhibition de 50% de l’agrégation des plaquettes à une concentration de 75 µg/mL de l’extrait, et cette inhibition est dose-dépendante. Pour les auteurs, il semble que l’extrait de Myrtille stimule la libération de prostacyctine (PGI2), ce qui a pour conséquence une augmentation de concentration intracellulaire d’AMPc ou une réduction du taux de thromboxane A2 dans les plaquettes. Plus tard, Morazzoni a étudié l’activité d’un complexe d’anthocyanosides de V. myrtillus (Myrtocyan, contenant environ 38 % d’anthocyanosides) sur l’activité plaquettaire, en comparaison avec l’acide acétylsalicylique, le dipyridamole et la ticlopidine. In vitro, sur plasma de lapin, l’inhibition de l’agrégation plaquettaire est concentration-dépendante ; elle est comparable à celle du dipyridamole, mais inférieure à celle de l’acide acétylsalicylique, et elle perdure après certaines manipulations chimiques et physiques. In vivo, l’administration orale du complexe d’anthocyanosides de Myrtille chez le rat (5 à 400 mg/kg) montre une augmentation du temps de saignement, qui perdure là aussi pendant 24 heures, pour retrouver des valeurs normales 48 heures après. Per os, l’administration du même complexe à des souris (400 mg/kg) conduit à une action similaire à la ticlopidine (100 mg/kg). De plus, une étude clinique incluant 30 patients en bonne santé a prouvé la forte inhibition de l’agrégation plaquettaire du Myrtocyan (480 mg/jour pendant 30 et 60 jours, administré seul ou avec l’acide ascorbique).
Effet vasodilatateur et relaxant des artères coronaires
Les anthocyanosides de la Myrtille, administrés per os à la dose de 100 mg/kg, possèdent également La propriété de réduire la réponse contractile du muscle lisse vasculaire, comme il a été démontré par Bettini dans les années 1980. Pour celui-ci, in vitro, l’effet relaxant peut être relié à la stimulation, par les anthocyanosides, de la synthèse des prostaglandines vasodilatatrices par le tissu vasculaire (substance PGI2-like). Les anthocyanosides de Myrtille s’opposent à la contraction de plusieurs types de muscles lisses en réponse à des agents variés tels qu’angiotensine II, sérotonine, baryum, histamine ou acétylcholine. Le Myrtocyan, administré à une concentration de 50 à 200 µg/mL, réduit la réponse contractile des artères coronaires à l’acétytcholine, d’autant plus qu’on ajoute de l’acide ascorbique (100-300 µg/ mL) ; en revanche, cet effet est diminué en présence d’indométacine ou d’acétylsalicylate de lysine, qui sont des inhibiteurs classiques de la cyclooxygénase, en particulier à fortes concentrations. En présence de bleu de méthylène, bien connu pour bloquer la libération du facteur relaxant dérivé de l’endothélium (EDRF), et dont le pouvoir d’augmentation du tonus vasculaire est concentration-dépendant, les anthocyanosides de la Myrtille maintiennent un effet vasorelaxant, signifiant ainsi que la capacité à libérer L’ERDF serait un mécanisme d’action envisageable.
Inhibition de l’enzyme de conversion de l’angiotensine
In vitro, une étude a rapporté la capacité d’un extrait de Myrtille à chélater les ions métaux comme le Zn2+ ou le Fe2+. Or, l’enzyme de conversion de l’angiotensine contient un atome de Zn2+ et les IEC (inhibiteurs de l’enzyme de conversion) sont capables de se lier à cet atome. Cette inhibition est d’autant plus forte que les anthocyanosides sont combinés, ce qui suppose l’implication d’autres substances dans cette activité. Encore une fois, la notion de totum prend toute son importance.
Action sur l’angiogenèse
L’angiogenèse, processus indispensable dans de nombreux phénomènes physiologiques ou pathologiques, est régulée par plusieurs facteurs inducteurs ou inhibiteurs dont le facteur de croissance de l’endothélium vasculaire (VEGF). In vitro, une étude a montré l’action inhibitrice de la Myrtille, à une concentration de 1 à 30 µg/mL, sur la formation des tubules vasculaires, la longueur, l’enchevêtrement des tubules et le nombre de réseaux formés. L’extrait de Myrtille inhibe également la prolifération et la migration des cellules induites par VEGF-A, de manière dose-dépendante. Pour les auteurs, cet effet est lié à la capacité de la Myrtille à inhiber l’augmentation de certaines protéines kinases. Chez la souris, une autre étude a permis de mettre en évidence l’effet inhibiteur d’un extrait de Myrtille sur la formation de réseaux néovasculaires dans la rétinopathie provoquée par l’oxygène.
3. Sphère gastro-intestinale
Activité anti-gastritique
Certaines études ont démontré l’action significative de la Myrtille aussi bien dans la prévention que dans le traitement des ulcères gastriques, en particulier dans les ulcères induits par ligature du pylore, par la réserpine, la phénylbutazone ou le stress. Les tanins et les anthocyanosides de la Myrtille exercent un effet asti-ulcère en partie par une augmentation du mucus protecteur dans la paroi de l’estomac en influençant la biosynthèse des mucopolysaccharides. Une anthocyanidine (cyanidine) a été étudiée chez le rat sur l’ulcère aigu et chronique avec comme résultats une réduction de l’ulcère gastrique (induit par ligature du pylore) non dose-dépendante, une inhibition de l’ulcère de stress, une réduction de la sévérité de l’ulcère induit par la phénylbutazone, dose-dépendante, ainsi qu’une inhibition dose-dépendante de l’ulcère induit par histamine. Cette activité combine plusieurs mécanismes : augmentation de la sécrétion de mucus, stimulation de la régénération cellulaire, amélioration de la microcirculation de la muqueuse gastrique, propriétés antioxydantes, inhibition de l’AMPc-phosphodiestérase. Sur les modèles animaux, on note également une absence de toxicité et une excellente tolérance. Par ailleurs, nous verrons plus loin l’action inhibitrice de la baie de Myrtille sur Helicobacter pylori.
Effet antidiarrhéique
Bien qu’aucune étude n’ait été réalisée de manière spécifique sur la Myrtille, l’action antidiarrhéique du fruit séché est avérée compte tenu de la présence de tanins dans la plante. Ceux-ci développent des propriétés astringentes caractéristiques dont un des effets majeurs, par voie interne, est l’effet antidiarrhéique relayé par les indications traditionnelles de cette plante. Notons que c’est principalement le fruit qui est employé dans cette indication. D’autre part, grâce à l’affinité des tanins pour les molécules protéiques (par complexion), ils assurent un effet antiseptique clairement démontré qui confère à la Myrtille un intérêt double en cas de diarrhée infectieuse.
4. Action anti-infectieuse
Activité antibactérienne
Devant la résistance croissante des germes pathogènes aux antibiotiques et la formation de biofilms par les bactéries, les pharmacologues ont fait face à ce problème majeur en étudiant de nouvelles alternatives naturelles. C’est ainsi que des extraits de feuilles de Myrtille ont démontré leur activité antibactérienne sur les staphylocoques (CMI 50 0,75-1,5 %) sans générer de toxicité sur les cellules de mammifères. L’analyse phytochimique des extraits a mis en évidence l’implication des composés phénoliques de la Myrtille, en particulier des acides hydoxycinnamiques dans cette activité.
De plus, les résultats montrent que la présence d’extraits de feuilles de Myrtille augmente l’activité bactéricide de la vincomycine sur S. aureus, Laissant présumer de l’activité synergique de la Myrtille avec des antibiotiques classiques. Une autre étude souligne l’action antibactérienne de plusieurs baies nordiques, en particulier celle de Myrtille, et de façon dose-dépendante, sur Salmonella, mais aucune action sur Listeria et Lactobacillus. Dans ce cas, il semble que ce soit surtout les acides organiques, plus que les polyphénols, qui soient à l’origine de cette action.
Dans la lutte contre Helicobacter pylori, la résistance aux antibiotiques classiques a conduit là encore à l’utilisation de baies de Myrtille, à la fois pour leur action inhibitrice sur la croissance de Helicobacter pylori, de manière dose-dépendante, et pour leur activité anti-infectieuse synergique avec la clarithromycine. Dans les diarrhées infectieuses enfin, comme précédemment évoqué, la Myrtille assure, de par sa composition chimique variée (composés phénoliques, arbutoside, même à l’état de traces, acides organiques) une activité antiseptique non négligeable, tout en respectant la flore saprophyte (Lactobacillus).
Action prébiotique
Conjointement à l’action antiseptique intestinale, la richesse en fibres de la Myrtille, environ 5 %, assure naturellement un effet prébiotique, même si celui-ci n’a pas été encore étudié par les pharmacologues. Ceci explique l’importance de la plante dans les affections intestinales, en particulier le dysmicrobisme intestinal et toutes les pathologies qui en découlent.
5. Autres propriétés
Importantes propriétés antioxydantes
En raison de la présence des anthocyanosides, la Myrtille possède un fort potentiel antioxydant largement étudié au cours des dernières années. Pour Talavera (2006), les anthocyanosides de Myrtille consommés quotidiennement ont un effet positif sur la capacité antioxydante du plasma. La valeur ORAC (mesure standardisée du pouvoir antiradicalaire) de la Myrtille, valeur exprimée par rapport à celle du Trolox (équivalent hydrosoluble de la vitamine E et molécule de référence) est plus élevée que celle d’autres baies. Ce pouvoir s’exerce vis-à-vis des espèces réactives azotées (oxyde nitrique [NO] et peroxynitrite). Les glycosides de delphinidine ont la plus grande réactivité, comme démontré par Ichiyanagi, en particulier vis-à-vis de la peroxydation lipidique, la Myrtille étant capable de ralentir la production de lipoperoxydes et de malondialdéhyde, de façon dose-dépendante, en étant plus efficace que la vitamine C (d’après Laplaud), et avec une IC50 de 50,28 µg/mL.
Il résulte de ce potentiel antioxydant des effets cytoprotecteurs multiples. Sur un modèle de stéatose hépatique, une étude démontre l’effet positif des anthocyanes de Myrtille sur le foie ainsi qu’une amélioration des fonctions mitochondriales. Sur un dommage hépatique induit par le stress, un extrait de Myrtille (200 mg/kg/jour) peut supprimer et renverser le niveau de malondialdéhyde hépatique et plasmatique, de façon identique à une dose de 200 mg/kg/jour de vitamine C. Concernant le stress oxydant émotionnel (au cours duquel les radicaux libres peuvent modifier les protéines intracellulaires et mener à la dégénérescence neuronale, avec altération des niveaux de dopamine) on observe que la Myrtille supprime la modification de ces dernières. Elle prévient aussi la formation des plaques amyloïdes. Les déficits cognitifs liés à l’âge qui impliquent du stress oxydant sont améliorés par une supplémentation à long terme avec un extrait de Myrtille, prévenant ainsi les déficits de mémoire et d’apprentissage. En cas d’exposition solaire, la fraction phénolique de Myrtille, en pré- et post-traitement aux irradiations, diminue l’apoptose induite par les UVA, les marqueurs de l’inflammation, et prévient la formation des radicaux libres. Sur le stress oxydant oculaire, un extrait de poudre de baies de Myrtille incubé avec des cellules rétiniennes humaines a un effet cytoprotecteur après 24 heures d’incubation et restaure la viabilité cellulaire. Dans les maladies oculaires liées à l’âge, l’inhibition, par des extraits de Myrtille, de la production de radicaux libres et de l’activation des protéines pro-apoptotiques, assure une prévention des lésions des photorécepteurs rétiniens exposés à la lumière bleue.
Effets sur la vision
Si les extraits de Myrtille sont utilisés depuis 1964 dans les affections ophtalmiques et dans les désordres de la microcirculation, l’hypothèse d’un effet de la plante sur la vision est très controversée. Chez les sujets à vision normale, de nombreuses études anciennes ont postulé l’hypothèse que les anthocyanosides de la baie de Myrtille, associés ou non à la vitamine E ou au 13-carotène, facilitaient la régénération de la rhodopsine, ce qui expliquerait l’amélioration de la vision en lumière atténuée, l’adaptation à l’obscurité chez les contrôleurs aériens, les pilotes d’avion.
À l’opposé, d’autres auteurs ne prêtent à la Myrtille aucune propriété sur la vision, même avec des extraits administrés à hautes doses et pendant une durée significative. Une méta-analyse de 2004 (Canter et al.) regroupe tous les résultats se référant à la vision dans des conditions de lumière réduite. Les résultats négatifs découlent d’études qui font preuve d’une plus grande rigueur dans la méthodologie. Les résultats positifs sont souvent associés à l’utilisation d’extraits de baies provenant d’Italie ou de France, la qualité des extraits étant liée au stade de mûrissement des fruits (plus le fruit est mûr, plus le taux d’anthocyanosides augmente). Chez les sujets myopes, en revanche, une association d’anthocyanosides de Myrtille, de vitamine E et de 13-carotène (100 mg/jour d’un extrait à 85 % d’oligomères anthocyanosides, pendant 4 semaines) améliore le champ visuel et la sensibilité de la rétine. Chez les patients atteints de rétinopathie diabétique, l’administration de 480 mg/jour d’anthocyanosides de Myrtille pendant 180 jours permet la réduction, voire la disparition des hémorragies rétiniennes, et une amélioration significative des examens ophtalmoscopiques et angiographiques chez 77 à 92 % des patients étudiés. D’autres études mentionnent l’impact positif des anthocyanosides de Myrtille en cas de cataracte, avec ralentissement de la progression des symptômes, ou de glaucome. Enfin, des extraits de Myrtille et les anthocyanosides ont la capacité de promouvoir la division et la prolifération des cellules épithéliales cornéennes, et à augmenter la quantité totale de GAG (glycosaminoglycanes) jouant un rôle important dans la cicatrisation cornéenne.
Rôle dans la prévention du cancer
L’activité anticarcinogénique des anthocyanosides et des extraits riches en anthocyanosides de Myrtille ont été mis en évidence aussi bien in vitro qu’in vivo ; celle-ci est liée à l’activité antioxydante de la structure phénolique des composés induisant une augmentation de la valeur ORAC des cellules. L’induction de l’apoptose a été étudiée sur différentes souches de cellules cancéreuses, et les anthocyanosides sont considérés responsables de cet effet, plus particulièrement les glycosides de delphinidine et de malvidine. D’autres mécanismes d’action ont été rapportés : stimulation de l’expression de la phase II de la détoxification enzymatique, diminution de la formation des sous-produits de l’ADN, inhibition de la mutagenèse induite par les carcinogènes, inhibition des récepteurs à activité tyrosine-kinase.
C. Principales formes galéniques utilisées et posologies
1. Voie interne
Parmi les formes galéniques les plus utilisées, citons : teinture-mère, extrait fluide, bourgeons macérat glycériné, extrait sec.
Doses indicatives des formes liquides
Teinture mère réalisée à partir des fruits frais : 50 à 100 gouttes/jour, de préférence avant les repas.
Extrait fluide réalisé à partir de la baie séchée : 1 à 2 g/jour, soit 50 à 100 gouttes/jour.
Bourgeons macérat glycériné 1D : 50 à 150 gouttes/jour.
Décoction de fruits séchés : 5 à 10 g de fruits desséchés pour environ 150 mL d’eau ; décoction de 10 min ; boire 4 à 6 tasses/jour (antidiarrhéique).
Infusion de feuilles : 1 à 2,5 g de feuilles pour 150 mL d’eau, en infusion de 5 à 10 min ; boire 2 à 3 tasses/jour.
Jus de Myrtille : 1 verre/jour, en cure de 10 jours/mois(dysmicrobisme).
Extrait fluide glycériné miellé : 1 cuillère à café dans un grand verre d’eau, 3 fois/jour.
Doses indicatives des formes solides
Gélules d’extrait sec (baies) : 100 à 200 mg, 2 à 3 fois/jour.
Gélules d’extrait sec (feuilles) : 50 à 100 mg, 2 à 3 fois/jour.
Gélules de poudre (baies) : dosées à 300 mg, 3 à 6/jour.
Microsphères SD (baies) : 1 dose de 200 mg équivalent à peu près à 100 gouttes de TM, 1 à 3 fois/jour.
Baies séchées : 20 à 60 g/jour. En ce qui concerne le fruit frais, les quantités ingérées sont plus importantes ; 50 à 100 g, 1 à 3 fois par jour.
2. Voie externe
- Décoction de fruits de Myrtille, réalisée à 10%, utilisée en gargarisme.
D. Effets secondaires, contre-indications, toxicité
1. Pharmacologiquement
Toxicité : à doses thérapeutiques, aucune toxicité aiguë ou chronique n’est connue. La baie ne présente aucune toxicité. Pour la feuille, à fortes doses, une toxicité chronique a été décrite, avec anémie, cachexie, ictère, état d’excitation aiguë (pour des doses de 1,5 g/kg/jour).
2. Effets secondaires et contre-indications selon l’approche clinique intégrative
Effets secondaires
Aucun effet secondaire n’est connu aux doses thérapeutiques préconisées.
Contre-indications
Certaines constipations.
E. Précautions d’emploi
L’absorption d’une trop grande quantité de fruits frais peut engendrer un effet laxatif.
Rappelons la vigilance à observer lors de la consommation de Myrtilles crues issues de cueillettes sauvages, suite au risque d’échinococcose.
Interactions aucune interaction connue, mais nous conseillons dans une approche clinique une surveillance tors d’association avec les médicaments antiagrégants ou anticoagulants,
F. Propriétés cliniques issues d’une analyse physiologique intégrative
Tropisme principal : sphère métabolique, vasculaire, gastro-intestinale et génito-urinaire.
Tropisme secondaire : ophtalmique.
1. Au niveau symptomatique
Propriétés par voie interne
- Sphère métabolique : hypoglycémiant ; hypo-triglycéridémiant ; hypocholestérolémiant.
- Sphère cardiovasculaire : tropisme capillaire ; vasoprotecteur : tonique veineux et capillaire (action vitaminique P) ; antiagrégant plaquettaire ; coronaro-dilatateur ; antioxydant ; anti-artérioscléreux et anti-athéromateux ; freine l’angiogenèse.
- Sphère digestive : anti-gastritique et anti-ulcéreux ; antidiarrhéique ; antiseptique intestinal ; rééquilibrant de la flore intestinale.
- Sphère immunitaire (intestinale et urinaire) : antiseptique, bactéricide, anti-dysentérique (baies) ; anti-colibacillaire intestinal et urinaire (feuilles) ; antifongique ; anti-inflammatoire ; fébrifuge.
- Sphère ophtalmique : augmente l’acuité visuelle ; antihémorragique rétinien ; cicatrisant.
Propriétés par voie externe
- Sphère cutanéo-muqueuse : astringent ; cicatrisant.
2. Au niveau du drainage
- Rénal : diurétique volumétrique et azoturique.
- Intestinal : régulateur intestinal et antidiarrhéique.
3. Au niveau de la régulation neuroendocrinienne
- Axe somatotrope : hypoglycémiant indirect.
G. Indications en phytothérapie clinique intégrative
Les indications thérapeutiques proposées de la Myrtille, selon la partie de plante utilisée, dans la Note explicative de l’Agence du médicament (1998), sont :
le fruit (frais ou sec) et la feuille par voie orale ou en usage local : « traditionnellement utilisé dans les manifestations subjectives de l’insuffisance veineuse telles que jambes lourdes et dans la symptomatologie hémorroïdaire » ;
- le fruit (frais ou sec) par voie orale : traditionnellement utilisé comme traitement adjuvant de la composante douloureuse des troubles fonctionnels digestifs ;
- le fruit frais, par voie orale ou usage local : traitement symptomatique des troubles fonctionnels de la fragilité capillaire tels que ecchymoses, pétéchies ;
- la feuille et le fruit sec, par voie orale : traitement symptomatique des diarrhées légères. La Commission E allemande précise dans la monographie (1987) que le fruit de Myrtille est également utilisé pour le traitement des diarrhées aiguës et pour l’inflammation locale modérée des muqueuses de la cavité buccale. Le fruit séché est utilisé à la dose de 20 à 60 g/jour en décoction par voie orale pour le traitement de la diarrhée chez l’adulte. En gemmothérapie, la Myrtille est indiquée pour la protection de l’organisme au niveau vasculaire ou digestif, ainsi que du pancréas.
En phytothérapie clinique intégrative, le choix de la plante médicinale doit toujours répondre d’un raisonnement endobiogénique intégrant à la fois :
- la fonctionnalité endocrinienne de l’individu considéré dans son ensemble ;
- l’enchaînement dynamique des axes hormonaux dans leur chronologie et leur relativité respectives ;
- les raisons de la désadaptation de la réponse physiologique face aux nécessités métaboliques.
En phytothérapie clinique intégrative, les indications de la Myrtille sont :
– en principal : les pathologies nécessitant une régulation du pancréas endocrine et touchant les sphères digestives, génito-urinaires, vasculaires ou métaboliques ;
– en secondaire : dans certaines affections ophtalmiques, en préventif ou en curatif.
1. Indications principales
Sphère gastro-intestinale
- Toutes les colites infectieuses et/ou inflammatoires (maladies de Crohn, rectocolite hémorragique) et/ou spasmodiques, notamment celles nécessitant une régulation du pancréas endocrine.
- Toutes les gastrites, colites à composante hémorragique.
- Dysmicrobisme intestinal à composante diarrhéique.
- Troubles colitiques post-antibiothérapie.
- En traitement associé des :
- infections des organes de voisinages : cystites, vaginites, leucorrhées, prostatites ;
- ulcères gastroduodénaux, gastrites hyper-sécrétantes et inflammatoires, œsophagites avec troubles intestinaux ;
- métaplasies gastriques ou œsophagiennes.
Sphère métabolique
Concerne particulièrement tous les états impliquant une dysrégulation insulinique et une dyslipidémie chez des sujets ayant volontiers des troubles intestinaux et/ou infections génito-urinaires associés.
- États pré-diabétiques, ou en traitement associé en cas de diabète avéré avec troubles de la microcirculation.
- Perturbations du métabolisme lipidique.
- Certains syndromes métaboliques.
- Certaines obésités.
Sphère vasculaire
Principalement toutes les pathologies dues à des troubles de la perméabilité capillaire et/ou insuffisance veineuse, de la microcirculation cérébrale et rétinienne.
- Toutes les pathologies athéromateuses et athéroscléreuses impliquant un dysmétabolisme glucido-lipidique :
- artérite des membres inférieurs ;
- en adjuvant dans coronarites, angor, suite d’infarctus ;
- certaines hypertensions à risque athéromateux ;
- certaines insuffisances veineuses, phlébites ;
- micro-accidents vasculaires cérébraux.
- Toutes les affections visuelles impliquant des troubles de la microcirculation à composante hémorragique et/ou proliférative.
- Les rétinopathies diverses : DMLA à forme « humide », rétinite diabétique, néovascularisation du glaucome.
- Toutes les sénescences vasculaires touchant la microcirculation.
- Troubles de la vision nocturne.
Infections
- Infections à colibacilles nécessitant un soutien du pancréas endocrine (colites, cystites…).
- Action sur le bacille d’Eberth (teinture-mère de Myrtille).
- Infections intestinales à composante diarrhéique.
Sphère cutanéo-muqueuse
- En bains de bouche et/ou gargarisme : toutes les inflammations et/ou congestions de la cavité buccale (aphtes, glossites, etc.).
- Ulcères de jambe, artérites des membres inférieurs,
2. Indications secondaires
- Varicosités.
- Certaines hémorroïdes avec troubles intestinaux associés.
- Certaines cirrhoses, notamment celles avec troubles métaboliques et circulatoires.
- Menace de sénescence accélérée, spontanée ou provoquée par des maladies à forte composante circulatoire.
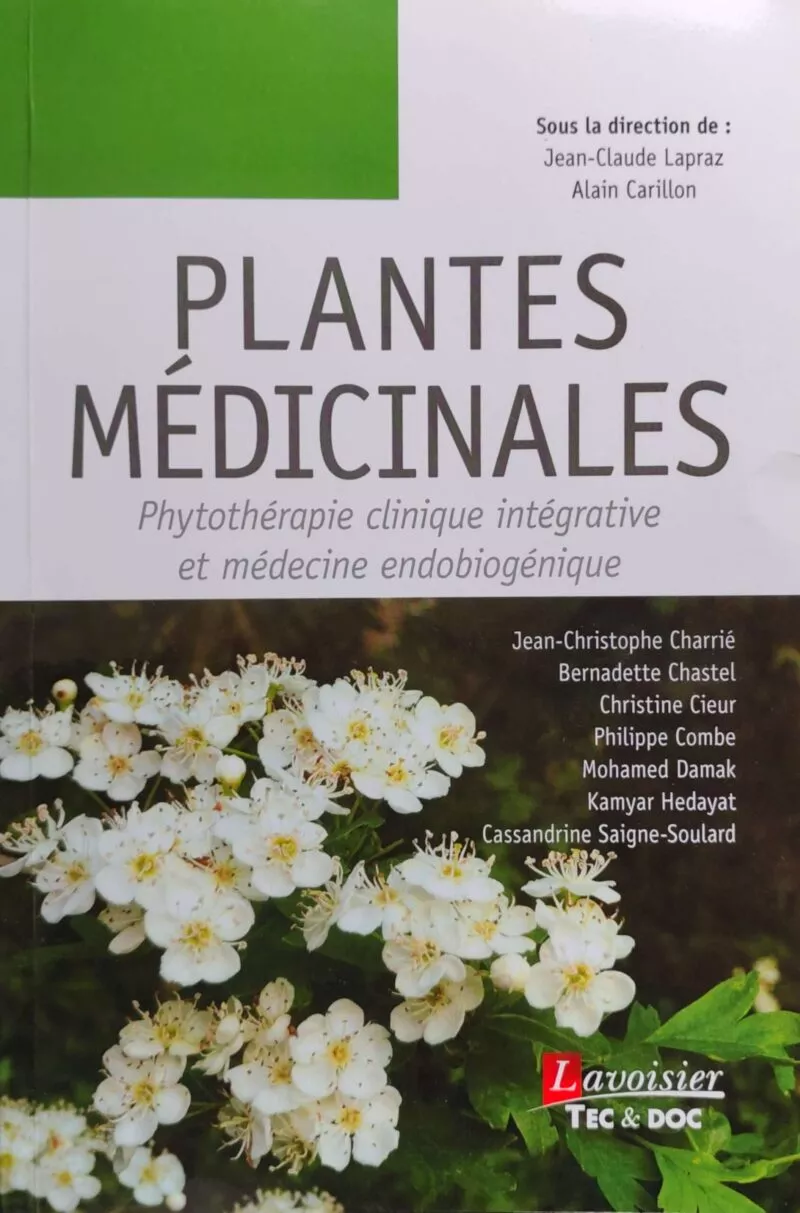
Pour en savoir +
Pour accéder à des informations plus détaillées et aux références bibliographiques qui permettent d’étayer les éléments présentées dans cet article, consultez le livre « Plantes médicinales », édité par Lavoisier TEC&DOC.
Plusieurs formateurs de l’Institut d’endobiogénie ont contribué à sa rédaction.



