- Guide des plantes
Gingembre (Zingiber officinale ) : propriétés et bienfaits
Le Gingembre : une plante aux multiples vertus thérapeutiques, reconnue pour son action digestive, anti-nauséeuse, anti-inflammatoire, antioxydante et son soutien des sphères métabolique, cardiovasculaire et endocrinienne.

Ce qu’il faut retenir…
Dans le cadre d’une phytothérapie clinique intégrée dans une réflexion endobiogénique, le Gingembre se présente comme une plante prioritairement active :
– au niveau pharmacologique direct : sur la sphère digestive et métabolique ;
– au niveau du drainage : hépatobiliaire, intestinal, pancréatique et pulmonaire ;
– au niveau endocrinien : sur les axes thyréotrope et gonadotrope, et secondairement corticotrope.
A. Usage traditionnel du gingembre
Le gingembre est utilisé depuis l’Antiquité en Inde, en Chine et dans le monde arabe pour ses propriétés médicinales et culinaires. En médecine ayurvédique, il est réputé carminatif, digestif, anti-dyspepsique, aphrodisiaque et utile contre diverses affections (rhume, grippe, dermatoses, obésité, hémorroïdes). En médecine traditionnelle chinoise, le rhizome frais ou sec est classé comme « remède chaud », agissant sur la transpiration, la digestion, la toux et les excès de mucosités. Introduit en Méditerranée, puis en Europe, il est apprécié comme épice précieuse et pour ses vertus carminatives, digestives et aphrodisiaques, évoquées par Dioscoride, Pline et Hildegarde de Bingen. Au Moyen Âge, il devient l’épice la plus connue après le poivre. Peu à peu, il s’impose en phytothérapie contre les troubles digestifs, les catarrhes, les rhumatismes, les nausées et vomissements, tout en étant utilisé localement comme analgésique, anti-inflammatoire et stimulant externe.
B. Données expérimentales et cliniques issues directement de la pharmacologie
Le Gingembre fait l’objet de nombreuses publications scientifiques. Cette plante, d’une composition exceptionnelle, révèle en effet de grandes propriétés. Toutefois, force est de constater des résultats parfois contradictoires lors des expérimentations in vitro ou in vivo. Plusieurs explications à cela : la grande variabilité de la composition chimique de la drogue (dépendante de l’origine de celle-ci), la nature fraiche ou sèche du rhizome, la nature des extraits utilisés, la durée et les doses administrées. La qualité de la drogue et une certaine standardisation des extraits semblent être un gage de validation des propriétés énoncées.
1. Sphère gastro-intestinale
► Propriétés digestives
Eupeptique, tonique digestif : lorsque le Gingembre est absorbé par voie orale, l’huile essentielle et l’oléorésine présentes dans La drogue stimulent, grâce à leur saveur aromatique et piquante, les sécrétions salivaires, gastriques et le péristaltisme intestinal, ce qui se traduit globalement par un effet stimulant sur la digestion. Chez l’animal, leur administration prolongée (plusieurs semaines) entraine une augmentation de l’activité de plusieurs types d’enzymes digestives : lipases, maltases, saccharases, trypsines et chymotrypsines intestinales.
Carminatif : la réduction des ballonnements et des flatulences est en partie liée aux propriétés digestives du Gingembre. En effet, grâce à la stimulation des sécrétions digestives des différents organes digestifs et d’autre part à l’augmentation de la production stomacale d’acides, la désinfection du bol alimentaire et la bonne dégradation des aliments sont améliorées, ce qui contribue à limiter les fermentations intestinales. De plus, les constituants de l’huile essentielle, lipophiles et de faible poids moléculaire, sont capables de s’intégrer de manière réversible aux membranes des cellules musculaires lisses, en particulier au niveau du cardia et de la muqueuse intestinale. Ils influencent négativement la perméabilité de certains canaux ioniques, diminuant ainsi la contractilité. Ceci limite l’aérophagie et supprime les spasmes intestinaux.
Antispasmodique : certains composants de l’huile essentielle et de l’oléorésine du Gingembre sont connus pour leurs propriétés antispasmodiques. In vitro, gingérols, shogaols, le β-pinène et le phellandrène interagissent avec les récepteurs 5-HT3 à la sérotonine de l’iléum isolé de cobaye ou de rat, induisant l’effet spasmolytique.
Il est intéressant de constater que le mode d’administration de la drogue influence les résultats de La motricité intestinale. Ainsi, le [6]- gingérol et le [6]- shogaol, administrés par voie intraveineuse, inhibent la motricité intestinale, tandis que celle-ci est accentuée avec une administration per os. D’autre part, in vitro, sur un modèle murin, un extrait hydro-alcoolique de Gingembre a induit une broncho-dilatation des voies aériennes supérieures, la relaxation des cellules musculaires lisses s’effectuant par le biais du blocage des canaux calcium.
Stimulant de la cholérèse : chez le rat, l’administration intra-duodénale d’un extrait acétonique (riche en composés aromatiques) augmente la sécrétion biliaire durant 3 heures tandis que l’extrait aqueux n’est pas actif. L’activité est attribuée aux [6]- et [10]- gingérols. Le [6]- gingérol provoque le doublement de la sécrétion à la dose de 100 mg/kg et est considéré comme un constituant cholérétique parmi les plus puissants.
► Propriétés antiémétiques
Ces propriétés ont été démontrées aussi bien in vitro qu’in vivo chez l’animal et confirmées chez l’homme au cours de très nombreuses études ou essais cliniques.
Mode d’action
Les propriétés antiémétiques du Gingembre, imputées, la plupart du temps, aux gingérols et shogaols, ne seraient pas d’origine centrale. L’étude du nystagmus consécutif à une stimulation vestibulaire et optocinétique traduit un mécanisme différent de celui qui caractérise les principales substances habituellement utilisées. Pour nombre d’auteurs, elle serait consécutive à une action sur le système digestif, par opération synergique de plusieurs effets, ce qui est compréhensible puisque les nausées et vomissements sont des réponses complexes engageant des voies à la fois motrices et neurologiques. On observe :
- une action périphérique antagoniste de la sérotonine au niveau des récepteurs 5HT3 (comme vu précédemment) ;
- un effet gastro-procinétique. Chez la souris, la stimulation de la motilité gastro-intestinale par l’extrait acétonique (75 mg/kg), le [6]- shogaol (2,5 mg/kg) ou les gingérols est comparable à celle du métoclopramide (10 mg/kg) et de la dompéridone. D’autres auteurs ont cependant relevé l’absence d’effet, sur des volontaires sains, de la poudre de Gingembre sur la vitesse de vidange gastrique ;
- la suppression des contractions gastriques, par inhibition de récepteurs muscariniques présynaptiques ;
- enfin, l’action cholagogue du Gingembre participant à la stimulation du péristaltisme est également à prendre en compte.
Évaluation clinique
La majorité des essais montrent une activité supérieure du Gingembre à celle d’un placebo en cas de mal de transports, de nausées postopératoires ou chimio-induites ainsi que lors d’états nauséeux liés à la grossesse, même si certains auteurs qualifient cette contribution de modeste.
- Études en laboratoire : l’utilisation de la technique de la chaise rotative a conduit à des résultats contradictoires (des sujets en rotation rapide doivent exécuter des mouvements de tête jusqu’à atteindre un état déterminé de malaise). Pourtant, la comparaison de l’effet du Gingembre (940 mg de poudre), du diménhydrinate (100 mg) et d’un placebo avec trois groupes de six volontaires a montré que le temps passé en rotation (v = 4 à 7 tours/min) avant l’apparition de nausées ou de vomissements est augmenté par le Gingembre administré 20 à 25 minutes avant l’expérience.
- Mal des transports, mal de mer ; plusieurs études ont permis d’établir l’intérêt du Gingembre dans la prévention du mal des transports. Dans 5 études, le Gingembre s’avère plus efficace que le placébo ou tout aussi efficient que les agents communément employés, notamment cinnarizine + dompéridone, diménhydrinate + caféine, méclozine + caféine ou encore cyclizine, scopolamine en patch. Les résultats ne montrent aucune différence significative entre les groupes, ni sur la fréquence et l’intensité des symptômes ni sur la proportion d’effets indésirables (à l’exception de la scopolamine qui était moins efficace et qui a entraîné des troubles visuels). Un essai comparatif en double insu, versus placebo, conduit chez 80 élèves-officiers naviguant par mauvais temps, a évalué d’heure en heure pendant 4 heures l’effet de la prise de 1g de poudre de Gingembre par voie orale. La proportion de sujets n’ayant ressenti aucun symptôme a été la même dans les deux groupes. Le Gingembre a semblé plus efficace que le placebo sur les symptômes vertigineux et les nausées mais la différence observée n’a pas été qualifiée de significative. En revanche, l’essai a mis en évidence une diminution statistiquement significative des vomissements et des sueurs froides.
- Nausées induites par la chimiothérapie : trois études ont montré un impact positif de l’administration de poudre de Gingembre en plus d’une thérapie antiémétique classique.
- Nausées postopératoires : sur un total de 8 études randomisées présentant l’action de la poudre de Gingembre sur les nausées et vomissements postopératoires (PONV), 4 études démontrent un effet positif. La plupart des études utilisaient une dose unique de 1g administrée oralement une heure avant l’anesthésie. De plus, une méta-analyse confirme l’efficacité du Gingembre dans les PONV.
- Nausées de la femme enceinte : la revue Obstetrics and Gynecotogy a analysé en 2005 6 études cliniques menées contre placebo ou contre substance de référence sur un échantillon total de 675 femmes enceintes souffrant de nausées, à le dose de 1,5 g 1 g de poudre de Gingembre par jour. Elle a conclu à la supériorité du Gingembre par rapport au placebo et à la sécurité du Gingembre tant pour la mère que pour le feus et le nouveau-né. La même année, l’OMS a confirmé cette conclusion, de même, plus récemment, l’Université de Liège.
Propriétés antiulcéreuses : cet effet est mis en évidence chez le rat avec un extrait sec aqueux qui protège l’estomac des effets ulcérogènes d’une solution éthanolique d’acide chlorhydrique, d’indométacine ou d’acide acétylsalicylique. Le [6]-gingérol, le [6]-shogaol et le zingibérène sont impliqués dans cette action.
Hépatoprotection : chez le rat, in vitro, le [8]-gingérol, [7] et le [8)-shogaol protègent les hépatocytes intoxiqués par le tétrachlorure de carbone. Cette propriété est à rapprocher de l’activité antioxydante du rhizome de Gingembre (voir ci-après),
2. Sphère métabolique
Propriétés anti-lipémiantes : Les taux sériques de cholestérol, triglycérides, lipoprotéines et phospholipides chutent Largement chez le lapin soumis à un régime riche en graisses (extrait éthanolique de Gingembre à 200 mg/kg, per os) et une diminution des lésions d’athérosclérose aortique est également enregistrée. Chez des souris mutantes incapables de synthétiser des apolipoprotéines E, traitées avec un extrait per os sur 10 semaines, on constate des réductions de 44 % de la superficie de la plaque d’athérome des artères, de 27 % du taux plasmatique de triglycérides et de 29 % de celui du cholestérol. Le taux de biosynthèse de cholestérol par les macrophages péritonéaux est réduit de 76% et la capacité a oxyder les LDL de 60 %. De même, chez le rat sain, un extrait aqueux de rhizome de Gingembre réduit le cholestérol sérique, le LDL et le VLDL-cholestérol, les triglycérides tout en augmentant le taux de Hill-cholestérol.
Enfin, une récente étude portant sur l’administration à des rats (étude randomisée) d’une combinaison atorvastatine-Gingembre montre la possibilité de diminuer la dose de l’hypocholestérolémiant, ainsi que la capacité du Gingembre el réduire les lésions hépatiques induites par l’atorvastatine. Si le mécanisme d’action semble incertain, il pourrait toutefois être en relation avec d’une part, une up-régulation au niveau de l’expression du récepteur hépatique LDL (en lien avec l’augmentation de l’élimination du cholestérol) et, d’autre part, une down-régulation de l’expression de la 3-hydroxy-3-méthylglutaryl-coenzyme A (en lien avec la diminution de la synthèse du cholestérol), chez le rat soumis à un régime riche en graisses.
Effet hypoglycémiant : chez le rat rendu diabétique par streptozotocine. l’administration de jus de rhizome de Gingembre entraine une chute du glucose sérique et une augmentation de l’insulinémie.
Même résultat chez le rat sain soumis à une hyperglycémie par 5-hydroxytryptamine.
L’huile essentielle montre aussi une activité hypoglycémiante à La fois chez le tapin et le rat sains ainsi que sur des modèles de rats rendus diabétiques (ST7 et alloxane). Le mécanisme d’action n’est pas connu. Mais cet effet est partiellement médié par les [6]-gingérol et [6]-shogaol.
Action sur la thermogenèse : gingérols et shogaols manifestent des propriétés thermogéniques. In vitro, chez le rat, la perfusion des poumons avec des extraits frais ou secs de Gingembre conduit à une augmentation de La consommation d’oxygène, en partie associée avec une vasoconstriction. En revanche, in vivo, seule une petite étude (réalisée sur 8 volontaires sains) a investigué cet effet sans que l’on puisse appuyer cette conclusion.
3. Sphère cardiovasculaire
Freination de l’agrégation plaquettaire et activité anti-thrombotique : in vitro, plusieurs investigations montrent qu’un extrait aqueux de Gingembre est capable d’inhiber la formation de thromboxane B2 ainsi que l’agrégation plaquettaire préalablement induite par divers agents. L’effet s’expliquerait par L’inhibition de l’enzyme COX1. Les gingérols, et en particulier le [8]-gingérol et le [8J-paradol, en seraient les principes les plus actifs.
In vivo, chez l’homme, la freination de l’agrégation plaquettaire ne s’observe que suite à la consommation d’une forte dose de Gingembre (10 g de poudre en une seule prise !).
Propriété cardiaque inotrope positive ? Cette activité avait été retenue par la Commission européenne, mais il semble que cela ne suit plus mentionné actuellement. Pourtant, certains composants du rhizome présentent une activité cardiotonique reconnue relayée par l’usage traditionnel.
Chez le rat anesthésié, l’administration par voie intraveineuse d’un extrait méthanolique de Gingembre frais induit un effondrement dose-dépendant de la pression artérielle (0,3-3 mg/kg). In vitro, le même extrait provoque une inhibition de la contraction de l’oreillette isolée de cobaye similaire au vérapamil (antagoniste calcique) ainsi qu’une vasodilatation sur l’aorte isolée de rat et de lapin. Gingérols et shogaols seraient à l’origine de cet effet.
Toutefois, chez le rat, une autre étude démontre qu’il n’y a pas d’action significative sur la pression systolique lorsqu’un extrait de Gingembre est administré par voie orale (50 à 100 mg/kg). Il en résulte que l’on ne peut, selon l’EMA, affirmer pour le rhizome de Gingembre ni une action cardiotonique ni une action hypotensive.
4. Sphère ostéo-articulaire
Propriétés anti-inflammatoires et antiœdémateuses
De nombreuses investigations réalisées aussi bien in vitro qu’in vivo ont prouvé l’action anti-inflammatoire du Gingembre, que celui-d soit employé frais ou sous forme d’extraits.
l’administration orale d’extrait de Gingembre (50 mg/kg) réduit l’œdème de la patte chez le rat, avec une activité comparable celle de l’acide acétylsalicylique.
Même résultat dans l’œdème induit par albumine, cette fois-d par voie IP avec un extrait hydro-alcoolique de rhizome de Gingembre en dose unique de 50 à 800 mg/kg.
D’autres modèles utilisant la voie intra-péritonéale décrivent également l’activité anti-inflammatoire du Gingembre, au niveau trachéal (rat) où les taux de PGE2 et TXA2 (thromboxane) sont diminués et au niveau pulmonaire (rat et souris) où la baisse du taux de cytokines pro-inflammatoires s’accompagne d’une diminution du recrutement des éosinophiles.
De même, sur un modèle de polyarthrite rhumatoïde chez le rat, l’injection IP d’un extrait éthanolique de Gingembre (100 mg/kg/jour pendant 25 jours) permet une diminution de l’incidence de l’arthrite objectivée cliniquement et histologiquement avec chute des cytokines pro-inflammatoires.
D’autre part, une étude indique qu’après 6 semaines de traitement par un extrait concentré de Gingembre, 63 % des 247 patients souffrant d’arthrite ont vu une atténuation de leurs symptômes, tandis que dans le groupe traité par anti-inflammatoire de synthèse, l’amélioration n’a été ressentie que par la moitié du groupe. Cette supériorité peut être corrélée avec l’innocuité du Gingembre pour la muqueuse gastrique, là où les anti-inflammatoires chimiques peuvent provoquer des ulcères.
Mode d’action : le mode d’action du Gingembre dépend en partie de son intervention au niveau de la cascade arachidonique. In vitro, la diminution de la synthèse des prostaglandines PGE2 liée à l’inhibition de la lipopolysaccharide (LPS) est décrite à la fois pour des extraits de Gingembre et pour de nombreux gingérols et shogaols. Ces composés inhibent aussi la cyclooxygénase COX-2 (avec diminution de la synthèse des prostaglandines PGE2 et des thromboxanes) ainsi que les lipooxygénases (avec diminution des leucotriènes).
Toutefois, une action directe inhibitrice sur les gènes encodant es substances pro-inflammatoires synthétisées et sécrétées sur les sites inflammatoires (cytokines et chimiokines) semble aussi jouer un rôle.
Parmi les composés de l’huile essentielle de Gingembre, les sesquiterpènes et les monoterpènes ont des propriétés anti-inflammatoires avérées. Le zingibérène et le curcumène diminuent la migration des leucocytes, les empêchant d’entretenir l’inflammation, tandis que le limonène et la gingerdione inhibent la COX 2 et l’oxyde nitrique synthétase.
Propriétés analgésiques
Chez la souris, un extrait éthanolique de rhizome sec de Gingembre administré par voie intra-péritonéale (50 à 800 mg/kg) permet de différer la réaction de retrait dans le test de la plaque chauffante et inhibe la douleur induite par l’acide acétique, ce qui suggère un mécanisme analgésique aussi bien central que périphérique.
Ici aussi, gingérols et shogaols sont considérés comme responsables de cette activité, en particulier car ils sont des agonistes des récepteurs vanilloïdesTRPV1 (action sur les thermorécepteurs conduisant à l’effet antalgique).
L’huile essentielle de Gingembre est également un savant mélange de molécules anti-inflammatoires (zingibérène, limonène…) et antalgiques (camphène, myrcène).
Sur le plan clinique, quelques études révèlent que le Gingembre administré per os ou par voie externe permet une amélioration des troubles rhumatismaux (inflammation, douleur).
D’autre part, le Gingembre développe une influence bénéfique sur l’analgésie morphinique et semble un complément efficace pour la gestion de la douleur. En effet, la prise concomitante de Gingembre à la dose de 50-100 mg/ kg diminuerait l’accoutumance et la dépendance à la morphine.
5. Autres propriétés
Activité androgénique
Un extrait aqueux de Gingembre testé sur rats mâles Wistar entraîne une augmentation du poids des testicules, du taux de testostérone et de cholestérol testiculaire ainsi que celle de l’a-glucosidase épididymaire (enzyme reflétant l’activité de l’épididyme). En revanche, une autre expérimentation dans laquelle le Gingembre était administré sous forme de poudre issue du rhizome sec (100 mg/kg/jour) n’a notifié aucune modification morphologique testiculaire ; toutefois, le niveau de testostérone sérique était augmenté. Une étude plus récente confirme l’action androgénique d’un extrait aqueux de Gingembre objectivé par un effet honorable sur la spermatogenèse.
Propriétés antioxydantes
Le Gingembre piège les radicaux libres et est doté d’une forte capacité antioxydante. Par exemple, des expérimentations chez l’animal ont montré qu’un extrait hydro-alcoolique administré en dose unique ou durant plusieurs jours, protège contre :
- la néphrotoxicité de la doxorubicine et du cisplatine ;
- l’hépatotoxicité de l’acétominophène et du bromobenzène ;
- la toxicité testiculaire du cis-platine. Chez le rat, l’ajout de Gingembre (1 %) dans la diète, diminue la peroxydation lipidique et augmente significativement le taux sanguin de glutathion. Enfin, de nombreuses études, confirment, in vitro et in vivo, la potentialisation du Gingembre sur le système de défense antioxydant de l’organisme.
Le [6]-gingérol et le [6]-shogaol seraient les composés les plus antioxydants du Gingembre grâce à la stimulation des multiples enzymes ; antioxydantes, comme la superoxyde dismutase, la glutathion peroxydase, etc.
Propriétés anti-infectieuses
In vitro, l’huile essentielle, des extraits secs ou aqueux de rhizome de Gingembre manifestent des propriétés antibactériennes contre les Gram+ et Gram- (Escherichia coli, Staphylococcus, Pseudomonas, Proteus, Porphyromonas) et également sur plusieurs souches d’Helicobacter pylori.
L’huile essentielle et l’oléorésine exhibent une inhibition de la croissance des germes comparable à la streptomycine et au chloramphénicol, probablement due à la synergie développée par les composés entre eux (eugénol, zingérone, aldéhydes, monoterpénols, gingérols, shogaols…). De plus, le Gingembre potentialise l’effet antibactérien de plusieurs antibiotiques communément employés.
En revanche, comparativement au jus d’Oignon, le jus frais de Gingembre n’est pas actif contre les bactéries multirésistantes.
L’huile essentielle freine la réplication du rhinovirus et agit également contre le virus d’herpès simplex type 1.
Une activité antifongique est également décrite. Il est intéressant de constater que sur 3 plantes testées (Gingembre, Oignon, Ail), un extrait éthanolique de Gingembre a été le plus actif dans l’inhibition de la croissance fongique. Enfin, le Gingembre possèderait des propriétés antihelminthiques. Une étude plus récente réalisée in vivo chez le rat albinos conclut au potentiel thérapeutique d’un extrait méthanolique de Gingembre contre Giardia lamblia.
In vitro, l’huile essentielle et les extraits secs ou aqueux de Gingembre présentent des propriétés antibactériennes contre les Gram+ et les Gram – (Escherichia coli, Staphylococcus, Pseudornonos, Proteus, Porphyromonas), ainsi que sur plusieurs souches d’Helicobacter pylori.
L’huile essentielle semble la plus performante et manifeste une inhibition de croissance sur les germes comparable à la streptomycine et le chloramphénicol, probablement due à la synergie d’action de ses constituants. En revanche, en comparant l’action du jus d’Oignon avec celle du jus de rhizome du Gingembre, ce dernier n’a pas révélé d’efficacité vis-à-vis des bactéries multirésistantes.
Toutefois, le Gingembre est capable d’optimiser l’activité antibactérienne de plusieurs antibiotiques communément employés.
Activité anti-tumorale
De nombreuses études ont été réalisées aussi bien in vitro (sur cellules humaines en culture) qu’in vivo (sur modèles de tumeurs induites chez l’animal : hépatique, cutanée, ovarienne, gastro-intestinale, pulmonaire, etc.) afin de démontrer le potentiel anti-tumoral du Gingembre.
Au sein des cancers gastro-intestinaux, le Gingembre manifeste une efficacité envers le cancer gastrique, du foie, colorectal ainsi que le cholangiocarcinome ; en revanche, son effet sur le cancer duodénal, œsophagien, anal ou celui des cellules des îlots pancréatiques n’a pas encore été établi.
L’action du Gingembre se caractérise à la fois par un effet préventif et par des actions anti mutagènes et anti-cancérigènes, mis en évidence en particulier pour les [6]-gingérol, [6]-shogaol, [6]-paradol ou l’huile essentielle. On observe une freination de la promotion et de la croissance tumorale grâce à la capacité de moduler plusieurs molécules de signalisation comme TNFα, NF-κB, STAT3, MAPK, PI3K, ERK1/2, COX-2, MMP-9, la survivine, dAP1, XIAP, Bcl-2, les caspases et autres protéines de régulation de la croissance cellulaire. Préventivement, rappelons que le Gingembre gagne à être ajouté dans la cuisine. En effet, si le [6]-shogaol est quasiment absent du Gingembre frais, son taux devient nettement plus élevé après cuisson à la vapeur, ce qui permet de bénéficier de son avantage sur la santé.
Propriétés antiasthmatiques
Les effets du Gingembre ont été étudiés au cours d’une étude randomisée contre placebo incluant 92 patients souffrant d’asthme depuis au moins 1 an. Le groupe traité par l’extrait hydroalcoolique (150 mg, 3 fois/jour durant 2 mois) a bénéficié d’une amélioration significative des signes cliniques : diminution de la dyspnée, de la constriction bronchique, de la toux nocturne ainsi que de l’usage d’un spray antiasthmatique. En revanche, aucune différence dans les deux groupes concernant les paramètres expiratoires (FEV1, FVC).
Dans une autre étude, des patients atteints de détresse respiratoire sont également améliorés par le Gingembre.
C. Principales formes galéniques utilisées et posologies
1. Voie interne
Les dosages préconisés traditionnellement en phytothérapie symptomatique diffèrent suivant l’indication thérapeutique. Sauf disposition contraire, la posologie s’étend de 1 à 4 g/jour de drogue (ou équivalent en poids sec de drogue), soit :
- Action anti-nauséeuse :
- 0,5 à 2 g de drogue (ou équivalent du poids sec) par jour, parfois jusqu’à 3 g/jour ou 100 à 300 mg/jour d’un extrait standardisé à 10 % de gingérols ;
- nausées de la grossesse : le plus souvent 1 g/jour (drogue sèche) ou 100 mg/jour d’un extrait standardisé à 10 % de gingérols. Cette dose correspond à environ 10 g de Gingembre frais (une tranche de 6 à 7 mm d’épaisseur)
- nausées postopératoires ou chimio-induites : de 0,5 à 1 g, à prendre 1 heure avant l’intervention, à renouveler si nécessaire.
- Mal de transport : le mode d’emploi habituel est de prendre une dose 30 minutes ou 1 heure avant le début du voyage, à renouveler facultativement toutes les 4 heures.
- Autres usages : 0,25 à 3 g de drogue par jour.
Principales formes galéniques
Extrait sec et extrait fluide (exacte correspondance avec la drogue sèche) puis la teinture mère et l’huile essentielle.
Doses indicatives des formes liquides
- Teinture mère préparée à partir de la partie souterraine séchée (titre alcoolique de 65°) 50 à 100 gouttes de 1 à 3 fois/jour, de préférence avant les repas.
- Extrait fluide : 0,25 à 1 mL (soit 15 à 50 gouttes), de 1 à 3 fois/jour.
- Huile essentielle : 25 à 30 mg, 1 à 3 fois/jour.
- Infusion ou décoction : une tranche de rhizome frais ou 0,5 à 1 g de rhizome séché pour une tasse d’eau bouillante, à renouveler 2 à fois par jour.
Dans le cas de nausées de la grossesse, 250 mg de rhizome séché par tasse, en infusion, jusqu’à 4 fois/jour.
- Extrait fluide glycériné miellé : 1 à 3 cuillères à café/jour, dans un peu d’eau.
Doses indicatives des formes solides
- Gélules d’extrait sec : 300 à 400 mg/jour.
- Gélules de poudre micronisée : se reporter aux mentions d-dessus (dosage variable suivant les indications thérapeutiques).
- Microsphères : 100 à 200 mg/jour (1 cuillère doseuse 200 mg équivaut à 100 gouttes de TM),
- Microsphères LE : 1 à 2 doses, de 1 à 3 fois/ jour (parfois davantage) (1 cuillère doseuse 200 mg équivaut à 25 gouttes de TM).
2. Voie externe
En voie locale, le Gingembre est employé sous forme de teinture ou d’huile essentielle pour effectuer des frictions ou massages (rhumatismes, symptômes musculo-tendino-ligamentaires). L’huile essentielle de Gingembre est très puissante et s’emploie en concentration de 3 à 10%, diluée dans un excipient adapté (huile ou gel).
La teinture s’emploie directement sur la zone douloureuse, en compresses ou frictions.
Le Gingembre entre dans la composition de l’alcoolat de Fioraventi (en friction externe pour les douleurs rhumatismales).
D. Effets secondaires, contre-indications, toxicité
1. Pharmacologiquement
Toxicité : aucune toxicité aiguë ou chronique connue. Le Gingembre est reconnu comme GRAS (generally recognized as safe) par la Food and Drug Administration.
La DL50 d’un extrait hydro-alcoolique de rhizome de Gingembre administrée chez la souris, à dose graduelle par voie intra-péritonéale, s’échelonne de 1551 ± 75 mg/kg.
Chez le rat, les résultats démontrent qu’une administration orale jusqu’à 2000 mg/kg de poudre de Gingembre n’est associée à aucune mortalité ou anormalité du comportement, de la croissance ou alimentaire.
Les données sur la mutagénicité du Gingembre sont complexes, l’extrait renfermant à la fois des substances antimutagènes et mutagènes. Le gavage de rates gestantes avec de fortes doses d’extrait de Gingembre (jusqu’à 1 g/kg) n’a provoqué aucune manifestation toxique, ni chez les mères ni chez les fœtus.
2. Effets secondaires et contre-indications selon l’approche clinique intégrative
Effets secondaires
Les effets indésirables ne surviennent que lors d’un surdosage ou doses élevées (supérieures à 4-6 g). Seulement 3,3 % des patients impliqués dans 15 études cliniques ont ressenti des effets indésirables digestifs d’intensité légère à modérée : reflux, risque de brûlure ou d’irritation stomacale, crampes de l’estomac et de l’intestin, nausées, éructations, dyspepsies ou diarrhées.
Chez les personnes sensibles, il peut y avoir allergie de contact ou simplement une irritation cutanée, essentiellement observable avec l’huile essentielle employée pure sur la peau, et plus rarement avec la teinture mère.
Contre-indications
- Sphère hormonale : hyperthyroïdies frustes ou avérées, Basedow.
- Sphère cardiovasculaire : certaines hypertensions.
- Cancer : ne pas utiliser dans les cancers androgéno-dépendants chez l’homme.
E. Précautions d’emploi
Le Gingembre est déconseillé en cas d’obstruction des voies biliaires, du fait de son action cholagogue. Grossesse : l’OMS admet l’usage du Gingembre dans le traitement des nausées de la grossesse. Mais, en dépit des 2 études cliniques qui fondent ces recommandations et malgré l’apport d’études englobant un total de 1902 femmes enceintes (dont 1002 au cours du 1er trimestre), la Commission européenne allemande, l’EMA et l’ESCOP contre-indiquent l’usage du Gingembre pendant la grossesse. Il est clair que, là aussi, tout dépend de la dose. Et rappelons que cette plante est largement utilisée en médecine traditionnelle chinoise sans aucune contre-indication vis-à-vis de la grossesse.
Allaitement : aucune donnée disponible.
Enfant : l’usage du Gingembre est déconseillé chez les moins de 6 ans. Passé cet âge, une étude a montré l’intérêt du Gingembre pour réduire les nausées liées à un excès de corps cétoniques dans le sang (cas des enfants qui s’alimentent insuffisamment suite à un problème de santé).
Cancer : ne pas oublier que l’extrait renferme à la fois des substances antimutagènes et mutagènes. Ainsi, une fois encore, l’exemple du Gingembre montre bien la nécessité d’intégrer toutes les propriétés d’une plante avant d’en faire un usage thérapeutique, et ne pas seulement se reposer sur des effets cliniques symptomatiques. De nombreuses publications « grand public » mettent en avant l’intérêt du Gingembre dans le cancer, en ne se basant que sur ses effets symptomatiques, sans notifier ses effets hormonaux androgéniques et thyroïdiens qui peuvent être négatifs dans certains cancers. Dans le cadre de cette pathologie, seul un médecin peut conseiller ou non son usage. Il est important d’éduquer sur ces risques la population qui s’automédique en fonction des magazines ; si, en prévention, l’usage du Gingembre dans la cuisine est fortement recommandé, en phase active de cancer son usage, en thérapeutique comme en aliment répétitif ne devrait être décidé que par un médecin.
Interactions :
- avec les médicaments fluidifiant le sang : le Gingembre pourrait en théorie augmenter le risque de saignement. Il peut, en effet, inhiber la thromboxane synthétase et avoir un effet agoniste de la prostacycline, mais ceci n’est observable qu’à une dose au moins 20 fois supérieure à la dose usuelle ! De plus, une étude randomisée auprès de volontaires sains n’a révélé aucune interaction entre le rhizome de Gingembre et la warfarine. Néanmoins la prudence imposera, le cas échéant, un contrôle régulier du temps de coagulation ;
- de la même manière, on devra tenir compte de l’association avec des plantes dotées de propriétés anticoagulantes (Ail, Curcuma, Ginkgo, Ginseng, Éleuthérocoque, etc.).
F. Propriétés cliniques issues d’une analyse physiologique intégrative
Tropisme principal : on retrouve la sphère digestive, mais aussi endocrinienne comme stimulant thyroïdien, cortico-surrénalien et androgénique testiculaire.
Tropisme secondaire : cutané en externe.
1. Au niveau symptomatique
Propriétés par voie interne
- Sphère digestive : eupeptique, apéritif ; stimulant des sécrétions salivaires et gastriques ; anti-nauséeux ; anti-inflammatoire et anti-œdémateux ; antiulcéreux.
- Sphère cardiovasculaire : tonicardiaque ; antioxydant.
- Sphère métabolique : hypolipémiant (cholestérol, triglycérides, lipoprotéines) ; hépato-protecteur ; anti-athéroscléreux.
- Antimicrobien, nématocide, molluscicide, anti-schistosomial.
- Tonique sexuel androgénique.
Par voie externe
Effet antalgique, analgésique (HE).
2. Au niveau du drainage
Hépatobiliaire : cholagogue.
Intestinal : augmentation de péristaltisme intestinal (légèrement laxatif).
Pancréatique : augmentation de l’activité enzymatique : lipases, saccharases, trypsines (avec un usage prolongé).
Respiratoire : balsamique, expectorant.
3. Au niveau de la régulation neuroendocrinienne
Propriétés neurovégétatives : aucune propriété directe relevée ; néanmoins il a une activité indirecte stimulante de l’alpha-sympathique :+.
Propriétés endocriniennes :
axe corticotrope : stimulant cortico-surrénalien (glycocorticoïdes) ;
axe gonadotrope : stimulant des androgènes testiculaires ;
axe thyréotrope : stimulant de T4.
G. Indications en phytothérapie clinique intégrative
En France, les Cahiers de l’Agence 1998 stipulent que le Gingembre (rhizome) peut revendiquer l’indication : «traditionnellement utilisé dans le mal des transports». En Allemagne, la Commission E du ministère de la santé reconnaît au Gingembre l’usage dans « le traitement des troubles digestifs et la prévention du mal des transports ».
L’OMS reconnaît comme « cliniquement justifié » l’emploi du Gingembre dans « la prévention des nausées et des vomissements dus au mal des transports et au mal de mer, ainsi que ceux liés à une intervention chirurgicale ou à la grossesse ». Elle reconnaît comme « traditionnel » son usage dans le traitement « des troubles digestifs, du rhume et de la grippe, de la perte d’appétit et comme anti-inflammatoire dans les migraines et les douleurs musculaires ou articulaires ».
En phytothérapie clinique intégrative, le choix de la plante médicinale doit toujours répondre d’un raisonnement endobiogénique intégrant à la fois :
– la fonctionnalité endocrinienne de l’individu considéré dans son ensemble ;
– l’enchaînement dynamique des axes hormonaux dans leur chronologie et leur relativité respectives ;
– les raisons de la désadaptation de la réponse physiologique face aux nécessités métaboliques.
En phytothérapie clinique intégrative les indications du Gingembre sont les suivantes :
1. Indications principales
Sphère thyroïdienne
Dans le cas du Gingembre, l’hypo-fonction thyroïdienne sera d’autant plus facilement corrigée que l’axe gonadique initiateur de la demande métabolique aura été traité, ce qui soulagera d’autant la demande thyroïdienne secondaire. Les pathologies concernées sont les suivantes :
- Hypothyroïdie, notamment péri- et post-ménopausique.
- En sevrage progressif des hypothyroïdies, en traitements substitutifs, et en association à un traitement endobiogénique régulateur de l’axe gonadique initiateur de la demande métabolique.
- Soutien thyroïdien, chez certaines femmes lors de la grossesse ou en post-partum.
- Thyroïdites du post-partum.
- Thyroïdites auto-immune (contre-indiqué en cas de Basedow).
- En soutien ponctuel chez le sujet euthyroïdien avec nodules thyroïdiens et en association avec une régulation hypophysaire.
- En soutien postopératoire, après lobectomie pour nodules thyroïdiens.
Sphère génitale
- Andropause.
- Hypofertilité masculine.
- Libido.
2. Indications secondaires
- En soutien cortico-surrénalien et thyroïdien ponctuel en période automnale ou en fin d’hiver rigoureux.
- Comme adaptogène endobiogénique lors des jet-tags (décalages horaires).
- Comme régulateur digestif, notamment chez le sujet à tendance hypothyroïdienne.
- Comme régulateur métabolique chez le sujet en surpoids (ménopause, andropause).
- Gastrites atrophiques hyposécrétantes, notamment du sujet âgé.
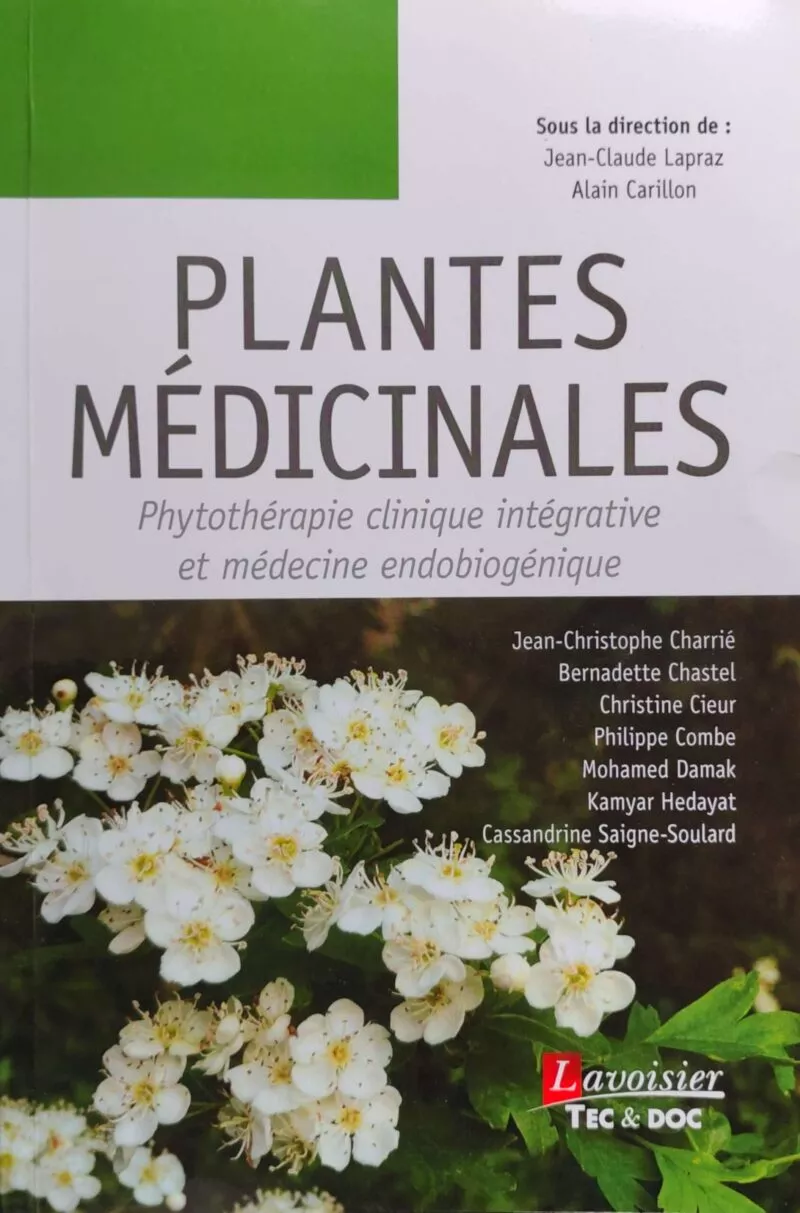
Pour en savoir +
Pour accéder à des informations plus détaillées et aux références bibliographiques qui permettent d’étayer les éléments présentées dans cet article, consultez le livre « Plantes médicinales », édité par Lavoisier TEC&DOC. Plusieurs formateurs de l’Institut d’endobiogénie ont contribué à sa rédaction.



