- Guide des plantes
Cassis (Ribes nigrum) : propriétés et bienfaits
Le Cassis : une plante reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, cortico-stimulantes et adaptogènes, utilisée traditionnellement et cliniquement pour soutenir l’axe surrénalien, améliorer la circulation, soulager les troubles articulaires, urinaires et allergiques, ainsi que pour ses effets protecteurs sur les tissus et le système immunitaire.

Ce qu’il faut retenir…
Dans le cadre d’une phytothérapie clinique intégrée dans une réflexion endobiogénique, le Cassis se présente comme une plante prioritairement active :
au niveau pharmacologique direct : sur les sphères locomotrice, cardiovasculaire, respiratoire, urinaire et digestive ;
au niveau du drainage : urinaire et circulatoire ;
au niveau neurovégétatif : αΣ+ et βΣ+ modéré ;
au niveau endocrinien : axe corticotrope+++ (bourgeons).
A. Usages traditionnels du Cassis
Le Cassis (Ribes nigrum), longtemps ignoré dans l’Antiquité, a progressivement révélé ses vertus médicinales en Europe à partir du XVIe siècle. D’abord valorisé pour ses qualités gustatives, il a été mentionné pour la première fois dans un contexte thérapeutique par Jacques du Fouilloux dans La Vénérie (Poitou), puis par le médecin Peter Forestus en 1614, qui soulignait son action diurétique. Hildegarde de Bingen, bien avant eux, l’avait déjà associé au traitement de la goutte sous le nom de Gichtbaum, décrivant ses propriétés réchauffantes et bénéfiques pour les artères.
Au XVIIIe siècle, l’abbé Pierre Bailly de Montaran publia Les Propriétés admirables du cassis, un traité mettant en avant ses vertus fortifiantes, toniques, apéritives, diurétiques (notamment contre les calculs rénaux), et même antivenimeuses, le présentant comme un antidote efficace. Ce texte, réédité à plusieurs reprises, contribua à populariser le Cassis, y compris dans des recettes de boissons. À la même époque, les feuilles étaient utilisées contre la rage, tandis que les baies, réputées pour favoriser la longévité, servaient à lutter contre le scorbut, la fatigue, les diarrhées, et les inflammations de la gorge.
Au XIXe siècle, des médecins comme F.R.-G. Fiayne (Allemagne) et l’abbé Kneipp l’employaient pour traiter les affections urinaires, les rhumatismes, la dysenterie, ou encore les angines. Les feuilles, reconnues pour leurs propriétés astringentes et sudorifiques, étaient aussi appliquées en cataplasmes sur les plaies, ulcères, ou teignes, tandis que les baies entraient dans la composition de liqueurs, dont la célèbre Cassis-Liqueur de Dijon, popularisée au XXe siècle par le chanoine Kir.
Ainsi, le Cassis s’est imposé tant en médecine traditionnelle — pour ses effets diurétiques, anti-inflammatoires, et toniques — qu’en usage local, tout en devenant un symbole gastronomique et culturel, notamment en Bourgogne.
B. Données expérimentales et cliniques issues directement de la pharmacologie
1. Activité anti-inflammatoire et anti-dégénérative cartilagineuse (feuilles, bourgeons)
Résultats expérimentaux, in vivo
De nombreuses études rapportent l’action anti-inflammatoire du Cassis établie à l’aide de différents tests :
- ainsi, un extrait hydro-alcoolique (14 % d’éthanol) de feuilles de Cassis réduit, chez le rat, l’œdème de la patte induit par carragénine. L’action anti-inflammatoire de l’extrait, à 10 mL/kg, s’est avérée comparable en usage chronique à l’indométacine (1,66 mg/kg) et à l’acide niflumique (12,5 mg/kg). De plus, contrairement à ces anti-inflammatoires de référence, le Cassis n’entraîne pas d’effet ulcérogène sur la muqueuse gastrique ;
- un lyophilisat de feuilles (obtenu par macération dans l’alcool à 15 %) manifeste également une activité anti-inflammatoire, en aigu, dans le même test (après 3 heures, réduction de l’œdème à 70 % pour le Cassis à 100 mg/kg comparativement à 77 % pour l’indométacine à 5-10 mg/kg) et en chronique dans le test de l’arthrite induite par l’adjuvant de Freund chez le rat.
D’autres expérimentations démontrent plus particulièrement le rôle de certains groupes de principes actifs, à savoir les prodelphinidines du croupe des pro-anthocyanidines (PAC) ainsi que les flavonoïdes.
Certains auteurs soulignent que l’activité anti-inflammatoire du Cassis est supérieure avec les bourgeons, sous la forme de macérat glycériné, par rapport aux feuilles. De plus, elle atteindrait le tiers de celle manifestée par la cortisone.
Tous les résultats indiquent que l’activité anti-inflammatoire du Cassis, imputée aux prodelphinidines et flavonoïdes, est dose-dépendante et s’explique par l’effet combiné de plusieurs actions étudiées in vitro et/ou in vivo (dont un effet glucocorticoïde mentionné plus loin).
Interférence sur la voie de l’acide arachidonique
Une récente étude a démontré in vitro que plusieurs extraits méthanoliques de Ribes nigrum, riches en composés polyphénoliques, inhibaient la phospholipase A2a, enzyme clé (rappelons-le, puisqu’elle permet la libération de l’acide arachidonique à partir des phospholipides membranaires) dans les processus inflammatoires observés dans les troubles tels que l’asthme, les réactions allergiques, l’arthrite et les maladies neuronales.
In vitro, un modèle expérimental de cultures de chondrocytes humains a permis d’étudier l’activité de différentes prodelphinidines sur l’activité des COX. On observe une sélectivité d’inhibition de la COX-2 par rapport à celle de la COX-1 et une diminution significative de la synthèse des prostaglandines E2 (PG12), en particulier par le dimère (le gallocatéchine (6C-GC), le dimère gallocatéchine-épigallocatéchine (GC-FGC) et le trimère de gallocatéchine (6C-GC-6C) pour des concentrations de 10 et de 100 µg/mL.
Les flavonoïdes totaux extraits de la feuille de Cassis inhibent également, ex vivo, sur cœur isolé de lapin, d’une part la biosynthèse des prostaglandines et d’autre part le relargage de celles-ci. L’effet enregistré est plus important qu’avec la cutine ou l’isoquercétine.
Diminution de la concentration des cytokines pro-inflammatoires TNFα (facteur de nécrose tumorale) et IL-1β (cytokines pro-inflammatoires) mais avec inhibition de la libération du NO
Une étude chez le rat Wistar, réalisée par Garbacki et al., a mis en évidence les propriétés anti-inflammatoires des PAC extraits des feuilles de Cassis sur deux tests inflammatoires, œdème de la patte et pleurésie. Pour ce dernier, le prétraitement des rats par PAC (à doses différentes croissantes) réduit l’atteinte pulmonaire, la formation d’exsudat pleural et l’infiltration de cellules polynucléaires. Dans l’exsudat, la teneur en cytokines n’est plus la même. On observe une diminution des concentrations en TNFα, IL1β (interleukine 1β), sans changement sur celles des IL-6 et IL-10. Une diminution de la concentration en nitrites/nitrates (N0x) est également enregistrée. Dans le groupe des rats traités par indométacine, le volume de l’exsudat pleural était faible mais avec une différence dans les concentrations en cytokines : les concentrations en leucocytes, TNFα, IL-β , IL-6 et IL-10 diminuaient mais, en revanche, pas celle des NOx. Ces résultats suggèrent un mécanisme d’action des PAC différent de celui de l’indométacine, et que le mécanisme principal de l’activité anti-inflammatoire des PAC est étroitement lié à la migration des leucocytes en induisant, in vivo, une diminution des NOx.
Inhibition de l’infiltration des leucocytes et régulation à la baisse des molécules d’adhésion endothéliales
In vivo, chez le rat, les travaux de Garbacki et al. montrent également que les PAC extraits des feuilles du Cassis régulent les molécules d’adhérence intercellulaire exprimées à la surface des cellules endothéliales, ICAM-I et VCAM-I.
In vitro, ces mimes travaux soulignent que l’activité anti-inflammatoire des PAC, liée à une inhibition d’infiltration des leucocytes, s’explique en partie par unediminution des molécules d’adhérence intercellulaire exprimée à la surface des cellules endothéliales ICAM-I et VCAM-I tout en étant capables de moduler le INFα induit par transcription du VEGF, à une concentration minimale de 10 µg/ml.
Activité inhibitrice des enzymes de dégradation
Les pro-anthocyanidines sont connues pour leur action inhibitrice enzymatique vis-à-vis des enzymes protéolytiques de dégradation du collagène (élastase, collagénase). Les flavonoïdes ne sont pas en reste ils inhibent, in vitro, l’histidinedécarboxylase, l’élastase, la hyaluronidase, en participant ainsi à la conservation de l’intégrité de la substance fondamentale des tissus. L’inhibition de l’aldolase-réductase est également mentionnée (rappelons que celle-ci est impliquée dans la pathogénie de la cataracte). Ces effets sont sans aucun doute en lien avec les propriétés antioxydantes de ces composés.
Promotion de la production de protéoglycanes et de collagène
Au cours de la même expérimentation de cultures de chondrocytes humains par Garbacki et al., les pro-anthocyanidines purifiées à 95 % manifestent un effet positif sur la production de protéoglycanes (PG) et de collagène de type II (composants essentiels de la matrice cartilagineuse) pour des concentrations allant de 1 à 100 µg/mL. La plus haute stimulation est enregistrée pour le trimère de gallocatéchine. D’autre part, ces composés sont capables de stimuler la proline-hydroxydase et ainsi favoriser l’établissement de pontages entre les fibres de collagène, renforçant leur solidité et leur stabilité tout en s’opposant à leur dénaturation. Les pro-anthocyanidines présentent l’avantage de produire une activité anti-inflammatoire sans contrepartie délétère sur la synthèse de cartilage.
Activité antioxydante
In vitro, différents extraits de feuille de Ribes nigrum assurent une activité antioxydante comme on peut le voir au cours des expérimentations déjà citées ci-dessus. Il semble que le potentiel antioxydant des baies de Cassis soit significatif en comparaison d’autres baies de fruits et soit corrélé au totum des composés phénoliques et la vitamine C.
Les effets antioxydants s’expriment par divers mécanismes dépendants les uns des autres :
- augmentation de l’activité de la glutathion-peroxydase ;
- piégeage des radicaux libres ;
- protection de la dégradation du collagène d’origine enzymatique (collagénase, élastase…) ;
- anti-lipoperoxydation (vis-à-vis, par exempte, des lipides membranaires…) étudiée sur de-, extraits méthanoliques provenant des fruit, feuilles et bourgeons de Ribes nigrum et objectivée par la mesure de la quantité de malone dialdéhyde libérée.
Une étude beaucoup plus récente a permis de mettre en évidence d’autres effets sur les membranes érythrocytaires. Des extraits de Cassis (feuilles et fruits) riches en composés polyphénoliques protègent ces membranes des attaques radicalaires induites par rayonnements UV en, inhibant l’hémolyse des érythrocytes (par action sur la résistance osmotique) et parallèlement en renforçant la membrane. En effet, les composés contenus dans les extraits ne pénètrent pas dans la région hydrophobe de la membrane, mais se lient en surface au niveau de la zone polaire en empêchant l’attaque radicalaire. Ainsi, il est suggéré que le potentiel antioxydant lipophile et bas tandis que le potentiel antioxydant hydrophile est haut.
La grande capacité antioxydante de Ribes nigrum induit, par conséquent, des effets protecteurs multiples qui s’exprimeront particulièrement au niveau du foie, et permettront de réduire les conséquences néfastes du stress oxydant émotionnel, de limiter le risque de maladies neurodégénératives liées au vieillissement, de diminuer les dommages induits par les UVB, de retarder la survenue des maladies oculaires liées à l’âge, de corriger les désordres microcirculatoires et d’aider à la prévention globale des maladies cardiovasculaires et cancéreuses.
Activité analgésique (feuille)
Une étude réalisée in vivo chez la souris, avec Ln extrait macéré de Cassis (15 % éthanol) administré par voie intra-péritonéale, décrit une activité analgésique d’origine périphérique, non opiacée, obtenu dans le test du Worthing à l’acide acétique. Dans ce test, la réponse thérapeutique est meilleure qu’avec le paracétamol (facteur 5).
En revanche, vis-à-vis du test de la plaque chauffante, ce mème extrait n’est pas actif en comparaison de la morphine.
2. Sphère hormonale (bourgeons) : tropisme surrénalien
Malgré le manque de données sur le plan pharmacologique, les propriétés endocriniennes du Cassis ont clairement été expérimentées et établies cliniquement par l’étude et les prescriptions de nombreux médecins. Seule la forme galénique à partir des « bourgeons » est mise en avant pour ces propriétés :
- activité glucocorticoïde : stimulation de la production de cortisol parles glandes surrénales ;
- activité hypophyso-cortico-surrénalienne : le Cassis bourgeons relance, régularise et renforce le syndrome général d’adaptation. La résistance globale de l’organisme est augmentée comme, par exemple, la résistance au froid ;
- action immunitaire : le Cassis bourgeons active les cellules macrophagiques en promouvant la maturation globale de la réponse immunitaire, en particulier dans la prévention des pathologies chroniques. À ce titre, le Cassis bourgeons estparfois qualifié d’immunorégulateur.
Ainsi, du fait de son action cortico-stimulante et immuno-stimulante, le bourgeon de Cassis peut être classé parmi les plantes « adaptogènes ».
3. Sphère rénale (feuilles, bourgeons)
Diurétique volumétrique, salidiurétique
L’activité diurétique des feuilles de Cassis a été expérimentée chez le rat sous plusieurs formes galéniques (extrait fluide, infusion, décoction et macérat), en comparaison au furosémide, diurétique de référence. Chaque forme galénique, administrée par voie orale, manifeste des propriétés diurétiques, en particulier à la dose de 1500 mg/ kg, avec des indices diurétiques respectivement de 1,28 pour le macérat, 1,31 pour l’infusion, 1,12 pour la décoction, 1,56 pour l’extrait fluide (1 : 1), contre 1,52 pour le furosémide administré à la dose de 50 mg/kg. Ces résultats sont intéressants à plusieurs titres. Tout d’abord c’est l’extrait fluide qui montre un effet diurétique le plus proche de celui du furosémide, ensuite on constate que l’infusion est plus performante que la décoction, à dose égale.
l’étude souligne de plus l’activité salidiurétique des feuilles en évaluant l’élimination urinaire du sodium et du potassium. Les résultats montrent que les deux minéraux sont éliminés dans les mêmes proportions relatives qu’avec le furosémide, mais en quantité deux fois moindre pour une même activité diurétique (dont deux fois moins de fuite minérale).
Rappelons que potassium et sodium font partiede la composition chimique des feuilles de Cassis. Le ratio K/Na s’élève à 128/1 dans les feuilles et à 242/1 dans la tisane. La valeur de ces ratios est généralement considérée comme une contribution à l’activité diurétique de cette plante.
Propriétés anti-lithiasiques
Une petite étude clinique réalisée chez l’homme suggère que la consommation régulière de baies de Cassis réduit le risque de survenue de calculs rénaux grâce à une hausse du pH urinaire et de l’élimination des acides citrique et oxalique.
4. Sphère vasculaire
Propriétés hypotensives et antihypertensives (feuilles, bourgeons)
Ces propriétés ont été expérimentalement démontrées chez l’animal :
- chez le chat, l’action d’un extrait fluide de feuilles de Ribes nigrum (1 : 1) a été comparée à l’activité de deux substances de référence (tolazoline et vincadifformine). Aux doses de 100, 200 et 400 mg/kg, l’extrait a montré une forte activité hypotensive, comparable ou inférieure aux substances de référence, suivant les doses. Mais dans tous les cas, l’effet observé dure plus longtemps :15-20 minutes pour le Cassis, contre 5 minutes pour la tolazoline ;
- chez le rat normotendu, anesthésié, un infusé à 20 g/L. administré à la dose de 360 mg/kg, par voie IV, diminue jusqu’à 45 % la pression artérielle initiale, et de 30 % au bout de 30 minutes. Cette activité est reliée aux flavonoïdes, probablement par inhibition de l’angiotensine et de la biosynthèse des prostaglandines.
Protection de la paroi capillaire (fruits, feuilles, bourgeons)
Ces propriétés angioprotectrices sont évidemment à rapprocher de la présence, dans la composition chimique du Cassis, des flavonoïdes et des anthocyanes qui ont été largement étudiées dans leur rôle de protection des parois vasculaires, grâce notamment à :
- l’activité vitaminique P des anthocyanosides objectivée par une diminution de la perméabilité et une augmentation de la résistance capillaire ;
- l’action synergique des flavonoïdes, en particulier par leurs propriétés antioxydantes ;
- l’activité hémodynamique conjuguée de ces deux croupes moléculaires avec, d’une part, une diminution de l’agrégabilité érythrocytaire et de la viscosité plasmatique pour un meilleur flux érythrocytaire (anthocyanes) et, d’autre part, un pouvoir anti-thrombogène physiologique (flavonoïdes).
De plus, l’évaluation in vitro d’un extrait de feuille de Cassis riche en proanthocyanidines (60 % de la teneur en polyphénols totaux) sur des cellules endothéliales de veine ombilicale humaine a conclu que Ribes nigrum (à dose physiologique faible) peut améliorer la viabilité des cellules endothéliales sans affecter l’action antiplaquettaire de l’endothélium.
Augmentation du flux sanguin périphérique (fruits, feuilles)
Plusieurs expérimentations cliniques réalisées sur de petites cohortes d’individus ont permis d’étudier l’action des anthocyanines de Ribes nigrum sur la circulation périphérique :
- un test avec plongée de la main dans l’eau froide et observation des frissons induits avec suivi de la température corporelle ;
- tests d’observation de la circulation périphérique sur des individus en bonne santé au repos ou pendant un travail de dactylographie avec suivi de la raideur d’épaule (causée par une circulation sanguine locale faible).
Les résultats indiquent qu’après ingestion d’anthocyanines de Cassis, la circulation du sang augmente de manière significative. Dans le premier test, la température du corps retrouve sa valeur normale au bout de 10 minutes seulement, ce qui était beaucoup plus rapide que pour les personnes non supplémentées.
Dans les autres tests, la circulation du sang de l’avant-bras mis au repos augmente 2 heures après l’ingestion des anthocyanines (17 mg/kg/ PC) et poursuit son augmentation jusqu’à 3 heures après l’ingestion, mais sans qu’il y ait de différence dans la consommation d’oxygène du muscle par rapport au groupe recevant le placebo. Cela traduit l’augmentation de la circulation périphérique sans qu’il y ait changement sur la captation de l’oxygène, contrairement à l’exercice de dactylographie. En ce qui concerne ce dernier, la prise d’anthocyanines (7,7 mg/kg/PC) empêche la chute de l’hémoglobine oxydée (oxy-Hb) et de l’hémoglobine totale, tout en réduisant la fatigue musculaire.
Prévention vis-à-vis des maladies cardiovasculaires (fruits, feuilles)
De nombreuses publications et études épidémiologiques révèlent que l’augmentation de la consommation d’anthocyanes est corrélée à une diminution du risque cardiovasculaire. Les travaux in vitro et in vivo, résumés dans la publication de Wallace, suggèrent que cette protection est le résultat de l’activité antioxydante des anthocyanines couplée à leur action de régulation de diverses voies métaboliques : amélioration de la pression artérielle, des lipides sanguins, ainsi que des biomarqueurs comme l’oxyde nitrique (NO), ceux de l’inflammation vasculaire et de la fonction endothéliale. Par exemple, dans deux essais cliniques réalisés sur des individus dotés de taux élevés de cholestérol sanguin, la supplémentation en anthocyanines a amélioré la vasodilatation endothélium-dépendante (avec activation de la voie métabolique de l’oxyde nitrique guanosine monophosphate cyclique) ainsi que le profil lipidique et une diminution de l’inflammation.
D’autre part, une étude clinique, réalisée sur 48 patients présentant des maladies artérielles périphériques, évalue les effets de jus de cassis et d’orange sur les marqueurs de l’inflammation vasculaire, la protéine C réactive et le fibrinogène. L’ingestion quotidienne de 250 mL de chaque jus permet de constater, par rapport au groupe placebo (recevant une boisson sucrée), une baisse significative des deux marqueurs. Dans le même temps aucune différence n’est enregistrée en ce qui concerne l’IL-6 et le facteur de Willebrand (activateur tissulaire du plasmogène). L’étude conclut qu’une consommation régulière de ces deux fruits participe à la diminution de problèmes cardiovasculaires.
5. Sphère immunitaire
Propriétés anti-allergiques (feuille, bourgeons)
Ces propriétés sont observables en particulier dans les rhinites ou conjonctivites saisonnières. Ceci peut être mis en lien avec l’effet cortico-surrénalien du Cassis.
D’autre part, le Cassis participerait à la réduction des biomarqueurs allergiques comme les sulphidoleucotriènes (SLT) et les CD63 (basophiles marqueurs de la dégranulation). L’étude réalisée in vivo et in vitro dans le but de tester un complément alimentaire italien, le Pantescal, contenant, parmi d’autres extraits, du Cassis, conclut que le mécanisme de l’amélioration clinique des patients allergiques s’explique par un effet de stabilisation de la membrane cellulaire.
Propriétés anti-infectieuses (feuilles, bourgeons)
Le Cassis présente une activité antimicrobienne modeste, même s’il est déclaré actif contre certaines bactéries.
In vitro, le jus de baies de Cassis inhibe la prolifération de Salmonella typhimurium et son adhésion sur la muqueuse intestinale. Dans le même temps, on observe une intensification de la prolifération de Lactobacillus rhamnosus. L’étude estime que ses propriétés sont à rapprocher des propriétés antioxydantes des anthocyanines.
Une étude, réalisée sur des résidents d’une maison de santé recevant quotidiennement un verre de jus de Cassis pendant 3 mois, a montré chez ces personnes une diminution des brûlures urinaires, une baisse d’envie pressante d’uriner et une diminution des odeurs urinaires. Dans le même temps, on enregistre une amélioration du taux des globules blancs dans les analyses urinaires et une baisse du risque de récidive d’infection urinaire pendant 3 mois. L’huile essentielle des bourgeons possède à la fois une activité bactéricide (contre Acinetobacter baumanii, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus) et un potentiel d’anti-pathogénicité.
Parmi les flavonoïdes, la sakuranétine serait responsable de l’activité fongicide du Cassis.
Une activité antivirale intéressante est également décrite.
Un extrait brut de feuilles de Ribes nigrum stoppe, in vitro, la progression de l’infection dès que celui-ci est appliqué sur des cellules infectées par l’influenza virus de type A ou B (cellules rénales, chien).
Un extrait de feuilles de Cassis sauvage a également été testé in vivo et in vitro contre le virus de la grippe. Cet extrait, dénommé Ladania 067, s’est révélé prometteur car très efficace (concentration efficace médiane ECso de 49,3 ± 1,1ng/mL) contre le virus humain de la souche d’influenza pandémique A/Regensbourg/D6/09 (H1N1) à la condition d’être ajouté aussitôt après l’infection. L’effet antiviral ne se déclare pas si les cellules infectées sont traitées 2, 4 ou 8 heures après l’infection. Ceci indique que l’extrait, pour être actif, doit agir très tôt dans le cycle de l’infection virale. En revanche, aucune résistance virale ne s’est développée à l’encontre de l’extrait, contrairement à l’amantadine qui a entraîné l’apparition de variants viraux résistants après seulement quelques passages. Dans un modèle d’infection du poumon chez la souris, le même extrait administré par voie intranasale à la dose de 500 µg inhibe la descendance du virus jusqu’à 85 % après 24 heures.
In vitro, à différentes concentrations, un extrait issu des baies du Cassis inhibe la liaison du virus herpès simplex type 1 aux membranes des cellules ainsi que la formation de plaque des virus, grâce à l’inhibition de la synthèse des protéines des cellules infectées au tout début de leur contamination.
Rôle dans la prévention du cancer
Les effets anti-inflammatoires et antioxydants du Cassis représentent un atout certain pour la prévention et/ou le contrôle de ces pathologies. Les baies de Cassis contiennent de grandes concentrations d’anthocyanines (250 mg/100 g), utiles dans l’équilibrage de la balance antioxydant/prooxydant.
Le potentiel antiprolifératif d’un extrait aqueux de Cassis a été étudié in vitro sur cellules HepG2 de cancer du foie chez l’homme. La fraction cyanidine-3-0-rutinoside (composé majoritaire) s’est révélée la plus cytotoxique, indiquant, pour la première fois, que la peau des baies de Cassis contient une fraction riche en anthocyanines capable d’inhiber la prolifération des cellules cancéreuses hépatiques.
Les mêmes auteurs ont étudié, in vivo, les effets chimio-préventifs d’un extrait de peau de baies de Cassis (riche en anthocyanines) sur des rats atteints d’une carcinogenèse hépatique initiée par le diéthylnitrosamine (DENA) suivie d’une promotion au phénobarbital. Les rats ont été supplémentés avec l’extrait durant 4 semaines avant l’initiation, et son absorption poursuivie pendant 22 semaines. On observe une décroissance de l’incidence, du nombre total, de la multiplication et du volume de nodules hépatiques néoplasiques, et cela de manière dose-dépendante. Le résultat est confirmé par l’examen histopathologique du foie. De plus, les analyses immunochimiques montrent que l’extrait inhibe la prolifération et induit l’apoptose des cellules anormales. Un signal pro-apoptique est envoyé par up-regulation du gène SAX et par down-regulation de l’expression de BCL-2 à différents niveaux. Par ailleurs, une étude in vitro indique qu’un extrait de baies de Cassis inhibe d’autant mieux la prolifération de cellules de cancer du sein (et dans une moindre mesure celles de cancer du côlon), que l’extrait est riche en vitamine C.
Enfin, une étude récapitulative du potentiel pharmacologique (in vitro) du Cassis sur les cellules tumorales HepG2 (foie), HT29 (cancer du côlon), MCF-7 (cancer du sein), Hela (cancer du col de l’utérus) et de la prostate montre que ces effets protecteurs sont dus :
- à une diminution de l’incidence, de la multiplication, de la taille et du volume des nodules pour les cellules induisant un cancer du foie (chez le rat) ;
- à la suppression de la prolifération des cellules anormales ;
- à la diminution de la tumeur solide du carcinome d’Ehrlich.
Effet chimio-protecteur (bourgeons)
Cliniquement parlant, le bourgeon de Cassis améliore le rendement métabolique de certains organes, ce qui contribuerait à améliorer leur résistance aux agressions chimiques. On retrouve ici la vision traditionnelle qui associe le Cassis à la gestion de l’eau, du drainage détoxifiant assumant ainsi un rôle de protection vis-à-vis de la dégénérescence des tissus.
6. Autres propriétés
Action sur l’acuité visuelle (baies)
Amélioration de la microcirculation conjonctivale et de la fatigue visuelle : chez l’homme, un essai randomisé a montré l’efficacité d’une association d’anthocyanosides isolés du Cassis, et de Fragon avec amélioration significative de la microcirculation conjonctivale explorée par capillarographie.
L’ingestion d’un extrait de baies de Cassis standardisé à 7 % d’anthocyanes par 21 volontaires soumis à un travail de 2 heures devant un écran d’ordinateur permet à ces sujets une très nette amélioration de la réadaptation visuelle, par rapport aux personnes ayant reçu un placebo.
Amélioration de la vision nocturne : in vitro, le même extrait (7 % d’anthocyanes) est capable d’agir sur la régénération de la rhodopsine (pigment contenu dans les cellules visuelles de la rétine et responsable de la vision crépusculaire), en particulier par l’action conjuguée du cyanidol-3-rutoside et du cyanidol-3-glucoside. Le temps d’adaptation à l’obscurité est diminué grâce à la diminution du temps nécessaire à la régénération de la rhodopsine (qui est normalement de 20 à 30 minutes).
Action sur le champ visuel dans le cas d’un glaucome à angle ouvert : l’ingestion quotidienne d’anthocyanidines de Cassis (50 mg/jour), pendant 2 ans, par des patients (38) atteints d’un glaucome à angle ouvert et traités par médicaments, conduit à une augmentation du flux sanguin oculaire et une amélioration du champ visuel. Cette étude suggère qu’une supplémentation en anthocyanidines de Cassis, en complément du traitement médicamenteux, pourrait être un atout pour les patients.
Sphères digestive et métabolique
Propriétés astringentes et anti-diarrhéiques : en particulier pour la partie externe des baies ou le jus de baies, riches en pectine.
Effets sur la glycémie : deux études cliniques ont permis d’établir chez des sujets sains que les baies de Cassis réduisaient la réponse glycémique post-prandiale au saccharose. Avec l’ajout de baies dans le repas, l’absorption du saccharose est réduite induisant une réponse glycémique post-prandiale atténuée ou retardée.
C. Principales formes galéniques utilisées et posologies
1. Voie interne
Forme galénique principale : Bourgeons MG 1 °D. Le macérat glycériné est préparé par macération de bourgeons de Cassis frais dans un mélange eau-alcool-glycérine dans un rapport 1/20e, suivi d’une dilution au 1/10e, ce qui donne en réalité une dilution au 1/200e pour le macérat 1°D. Ainsi, les posologies indicatives suivantes concernent exclusivement le macérat MG 1°D.
Les « macérats-mère » qui sont également disponibles dans ou hors circuit pharmaceutique sont, quant à eux, plus concentrés car n’ont pas subi la dilution au 1/10e, Il conviendra alors, en cas d’utilisation, de diviser les doses par 10.
Doses indicatives des formes liquides
- Macérat glycériné (bourgeons) 1°D : généralement prescrit le matin, afin de respecter la chronobiologie de la surrénale, à dose variable suivant l’indication thérapeutique :
– soutien de la surrénale 50 à 100 gouttes/jour ;
– en aigu :100 à 200 gouttes/jour, parfois plus ;
– posologie enfant : 1 goutte/kg de poids corporel/jour.
- Teinture mère de feuilles : 50 à 100 gouttes par jour, de préférence avant les repas.
- Soluté intégral de plante fraiche :1 cuillère à café 2 fois/jour à diluer dans un verre d’eau.
- Extrait de plante standardisé : 1 à 2 cuillères à café/jour, à diluer dans un peu d’eau.
- Extrait fluide : 40 à 50 gouttes, 1 à 3 fois/jour.
- Extrait fluide glycériné miellé : 1 cuillère à café dans un grand verre d’eau, 3 fois/jour.
- Tisane (feuille) : 2 à 4 g environ de feuille coupée menue (1 cuillère à café = 1 g) pour respectivement 1/4 ou 1/2 litre d’eau ; en infusion ou en mélangeant à froid avant de porter à ébullition ; couvrir et laisser infuser 5 à 10 minutes. Filtrer et boire 1 tasse plusieurs fois jour, de préférence, entre les repas.
- Tisane (fruits) : 2,5 à 5 g de fruits secs en infusion ou décoction de 15 minutes pour respectivement 1/4 ou 1/2 litre d’eau à boire dans la journée (contre les insuffisances veineuses ou crise hémorroïdaire).
Doses indicatives des formes solides
- Gélules d’extrait sec (feuille) 170 mg, 1 à 3 fois/jour (dose maximale de 1800 mg).
- Gélules d’extrait sec (fruit) : 200 mg, 2 fois/ jour.
- Gélules de poudre micronisée (feuille) : de 0,700 à 1,7 g/jour.
- Microsphères SD (feuille): 100 à 200 mg/jour (1 cuillère doseuse – 200 mg) équivalent de 50 à 100 gouttes de TM,
- Microsphères LE® (feuille) ; 0,20 à 0,40 g (1 à 2 doses), 2 à 3 fois/jour soit un équivalent de 25 à 50 gouttes de TM 2 à 3 fois/jour.
2. Vole externe
- Emploi des feuilles :
– feuilles fraîches pilées ou froissées : en friction ou en cataplasme sur les piqûres d’insectes, furoncles, abcès, plaies, ulcères, teigne ;
– feuilles entières sèches infusées dans du vin blanc pendant 15 minutes puis déposées en cataplasmes sur les plaies, piqûres, abcès…
- Emploi des baies : décoction des baies sèches en gargarisme contre les affections buccales (50 g par litre d’eau).
- Bourgeons (macérat-mère glycériné) : quelques gouttes appliquées directement sur la peau (piqûre d’insecte).
D. Effets secondaires, contre-indications, toxicité
1. Pharmacologiquement
Toxicité : aucune toxicité aiguë ou chronique connue :
- chez la souris, la DL50 = 49 g/kg par voie intrapéritonéale (pour un extrait fluide 1 : 1). La 01100 est estimée à 90 g/kg ;
- un lyophilisat, obtenu par macération de 100 g de feuilles par litre et titré à 15 % d’éthanol, administré à la souris, par voie intra-péritonéale, donne une DL50 – 1,09 g/kg. Par voie orale, des doses supérieures à 3 g/kg n’induisent aucune toxicité.
2. Effets secondaires et contre-indications selon l’approche clinique intégrative
Effets secondaires
- Pharmacologiquement : aucun effet secondaire connu. L’administration d’extraits de feuilles de Cassis chez le rat durant 28 jours ne procure aucun effet secondaire ni ulcération gastrique.
- Cliniquement parfois troubles du sommeil lors de prises tardives (après 18 h).
Contre-indications
- Sphère hormonale : hyperfonction cortico-surrénalienne et hypercorticisme.
- Sphère cardiovasculaire et rénale : attention en cas d’œdème lié à une insuffisance cardiaque ou rénale.
E. Précautions d’emploi
Aucune précaution requise.
Interactions : le médecin sera attentif lors :
- de la prise concomitante de diurétiques
- d’énurésies (enfant ou adulte).
F. Propriétés cliniques issues d’une analyse physiologique intégrative
Tropisme principal : appareil locomoteur ; sphère hormonale : axe corticotrope.
Tropisme secondaire : immunitaire ; vasculaire ; rénal.
1. Au niveau symptomatique
Propriétés par voie interne
- Appareil locomoteur (feuille, fruit, bourgeon) : anti-inflammatoire ; anti-oedémateux ; analgésique, antalgique, anti-myalgique ; anti-dégénératif.
- Sphère cardiovascutaire (feuille, fruit, bourgeon) : hypotenseur et antihypertenseur (feuille) ; vasculoprotecteur, phlébotonique (fruit) ; capillaro-constricteur, anti-hémorragique (propriété Vit P) (fruit) ; vasculotrope et anti-hémorragique rétinien (propriété Vit P) (fruit).
- Antioxydant, immuno-régulateur (fruit).
- Sphère urinaire (feuille, bourgeon) : toutes infections mais surtout glomérulonéphrites.
- Sphère cutanée et respiratoire : anti-allergique ; anti-infectieux ; cicatrisant.
- Sphère digestive (feuille et fruit) : astringent ; anti-diarrhéique ; antiseptique intestinal.
Par voie externe
Effet anti-infectieux, anti-allergique et cicatrisant (feuille).
2. Au niveau du drainage
- Urinaire : diurétique volumétrique, uréo- et uricosurique, azoturique (feuilles).
- Circulatoire : diminue l’agrégabilité érythrocytaire et la viscosité plasmatique.
Rappel : Le bourgeon de la plante contient potentiellement tout ce que va apporter la feuille et le fruit.
3. Au niveau de la régulation neuroendocrinienne
Propriétés neurovégétatives (feuille et fruit)
Sympathomimétique mixte αΣ+ et βΣ+ modéré (par action sur la médullosurrénale).
αΣ+
– à activité hypophyso-cortico-surrénalienne ;
– à activité catalytique calcique ;
– vasoconstricteur veineux ;
– vasoconstricteur capillaire.
βΣ+
– à activité glucocorticoïde ;
– à activité catalytique potassique ;
– vasoconstricteur capillaire rétinien ;
– antihypertenseur.
Propriétés endocriniennes
Axe corticotrope (par action sur la corticosurrénale) :
- stimulant de l’axe corticotrope (hypophyso-cortico-surrénalien) ;
- analogue ACTH/cortisol (glyco-cortico-surrénalostimulant [17-OH]), mais cela nécessite une capacité de réponse de la surrénale ;
- augmente la sécrétion du cortisol par la surrénale ;
- favorise la permissivité de l’axe corticotrope ;
- adaptotonique.
G. Indications en phytothérapie clinique intégrative
En France, selon les cahiers de l’Agence 1998, le Cassis est par voie orale « traditionnellement utilisé pour faciliter les fonctions d’élimination urinaire et digestive, comme adjuvant des régimes amaigrissants, pour favoriser l’élimination rénale de l’eau » ; il est également utilisé par voie orale ou locale « dans le traitement symptomatique des manifestations articulaires douloureuses mineures ».
Les fruits frais ou secs sont traditionnellement utilisés par voie orale ou externe dans l’insuffisance veineuse, tandis que les fruits frais le sont dans le traitement de la fragilité capillaire. Le fruit du Cassis sert à la préparation d’extraits enrichis en anthocyanosides avec des indications thérapeutiques identiques à celles de la myrtille.
Les bourgeons, quant à eux, sont également prescrits dans la phytothérapie contemporaine, et recherchés dans l’industrie agroalimentaire pour l’huile essentielle qu’ils renferment.
En phytothérapie clinique intégrative, le choix de la plante médicinale doit toujours répondre d’un raisonnement endobiogénique intégrant à la fois :
– la fonctionnalité endocrinienne de l’individu considéré dans son ensemble ;
– l’enchaînement dynamique des axes hormonaux dans leur chronologie et leur relativité respectives ;
– les raisons de la désadaptation de la réponse physiologique face aux nécessités métaboliques.
En phytothérapie clinique intégrative, les indications du Cassis sont essentiellement les pathologies dépendant d’un défaut de l’axe corticotrope
- difficulté adaptative (au cours du syndrome général d’adaptation) ;
- défaut de permissivité de l’axe lui-même ;
- anomalie métabolique ;
- maladie à composante circulatoire et rénale (++ chez le sujet âgé).
1. Indications principales
Axe corticotrope
- Tout déséquilibre endobiogénique nécessitant un soutien de l’axe corticotrope en principal ou en associé :
par sur-sollicitation et/ou insuffisance adaptative : asthénie physique et psychique, dépression ; changement de saison ; allergies diverses, asthmes, hyper-histaminémie, urticaire ; en relais ou en soutien d’une corticothérapie afin de maintenir une activité surrénalienne ;
par insuffisance cortico-surrénalienne périphérique : certaines périodes de la vie : post-ménopause, andropause ; certaines acnés ;
par insuffisance corticotrope avec retard du β-sympathique : asthme et surinfection dans l’asthme ;
pour faciliter ou soutenir la réponse adaptative d’un autre axe endocrinien : hypothyroïdies ; hypogonadisme en période adaptive génitale : soutien de la voie de l’aromatisation de la DHEA, ; puberté (si insuffisance de DHEA) ; ménopause et péri-ménopause, andropause.
- Toutes pathologies rhumatismales inflammatoires nécessitant un soutien de l’axe corticotrope : la plupart des arthroses ; PCE, spondylarthrite ankylosante.
- Toutes les pathologies infectieuses nécessitant un soutien de l’axe corticotrope : zona, herpès ; hépatites virales ; maladies infantiles rougeole, varicelle, etc. ; bronchiolites.
- En traitement associé dans certaines pathologies auto-immunes : thyroïdites en dehors du Basedow ; Lupus ; pneumopathies interstitielles auto-immunes ; spondylarthrite ankylosante ; certaines colites inflammatoires (RCH, Crohn).
Sphère métabolique
- Pathologies ostéo-articulaires en poussée inflammatoire.
- Certaines hypertensions artérielles notamment du sujet âgé nécessitant un soutien de l’axe corticotrope (N.B. : αΣ+).
- Certaines lithiases rénales à urate ou oxalate, notamment chez le vieillard.
- Pathologie à réactivité insulinique.
Mais aussi :
- à activité vitaminique P (fruit) : vasculotrope, antihémorragique, vasculotrope rétinien, antihémorragique rétinien ;
- à activité vitaminique C (feuille + fruit) : à activité antiarthritique, à activité glucocorticoïde, anti-infectieux, anti-dégénérative ;
- à activité catalytique (fruit) : à activité vitaminique C, à activité vitaminique P, à activité oligométallique (Ca, K).
2. Indications secondaires
En complément :
- dans toutes les infections, notamment celles secondaires à une insuffisance adaptative saisonnière (automne, fin d’hiver) ;
- dans certaines pathologies d’insuffisance circulatoire artérielle et/ou capillaire : coronarite, insuffisance circulatoire cérébrale, post-AVC, maladie de Norton, maladie de Raynaud, etc. ;
- en adjuvance en oncologie (oncobiologie : chimioprotecteur global à tropisme hématologique).
3. Rappel : contre-indications cliniques
Hyperfonction de l’axe corticotrope et hypercorticismes.
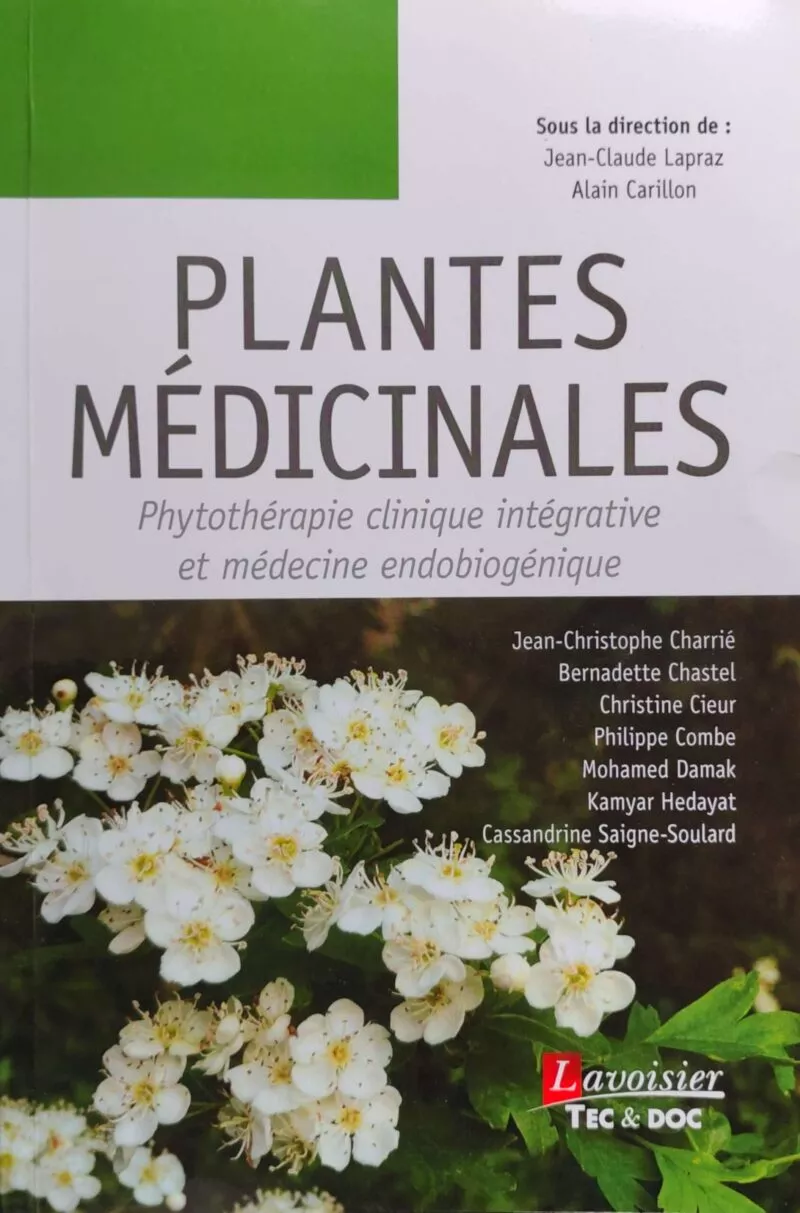
Pour en savoir +
Pour accéder à des informations plus détaillées et aux références bibliographiques qui permettent d’étayer les éléments présentées dans cet article, consultez le livre « Plantes médicinales », édité par Lavoisier TEC&DOC.
Plusieurs formateurs de l’Institut d’endobiogénie ont contribué à sa rédaction.



