- Guide des plantes
Mélisse (Melissa officinalis) : propriétés et bienfaits
La Mélisse : a de multiples propriétés thérapeutiques, agissant principalement comme antispasmodique, sédative, anxiolytique, antivirale (notamment contre l'herpès), digestive, cardioprotectrice et antioxydante, tout en régulant les systèmes neuroendocrinien et immunitaire, avec des usages aussi bien internes qu'externes.

Ce qu’il faut retenir…
Dans le cadre d’une phytothérapie clinique intégrée dans une réflexion endobiogénique, la Mélisse se présente comme une plante prioritairement active :
– au niveau pharmacologique direct : sur les systèmes nerveux central, digestif, cardiovasculaire et immunitaire ;
– au niveau du drainage : hépatobiliaire ;
– au niveau neurovégétatif : comme alphasympathicolytique ;
– au niveau endobiogénique : comme anti-ocytocique, anti-gonadotrope et anti-TSH.
A. Usages traditionnels de la Mélisse
1. Par voie orale
- Histoire et héritage : Utilisée depuis l’Antiquité (Grèce, monde arabe), la Mélisse était prisée pour ses vertus digestives et apaisantes. Des figures comme Hippocrate et Avicenne la recommandaient pour calmer la nervosité et « rendre joyeux ».
- En Europe : Popularisée par les moines Carmes (XVIIe siècle), elle entre dans la composition de l’« eau de Mélisse des Carmes », un remède antispasmodique et sédatif, toujours utilisé comme stimulant et calmant.
- Propriétés thérapeutiques :
- Système nerveux : Soulage migraines, palpitations, insomnie, stress léger et mélancolie.
- Digestion : Antispasmodique (crampes d’estomac), stimulante, carminative (flatulences), et cholérétique (foie).
- Respiratoire : Utilisée en complément pour les bronchites chroniques et l’asthme humide.
- Autres usages : Emménagogue (règles), sudorifique, et pour stimuler l’appétit.
- Cuisine : Jeunes pousses ajoutées aux salades ou légumes pour leurs propriétés aromatiques et digestives.
2. Usage local (externe)
- Antidouleur : Action antalgique et antinévralgique (apaisement des douleurs nerveuses).
- Relaxation : Bains relaxants et calmants.
- Cosmétique : Réduit les inflammations cutanées et les pellicules.
B. Données expérimentales et cliniques issues directement de la pharmacologie
1. Sphère gastro-intestinale
Antispasmodique
C’est la propriété majeure de l’axe « cerveau-intestin ». Alors qu’in vitro les extraits aqueux et éthanoliques ne présentent pas d’activité antispasmodique notable – aussi bien sur les contractions de l’iléon induite par l’acétylcholine ou l’histamine chez le cochon d’Inde que sur l’amplitude et la fréquence des ondes péristaltique du muscle lisse intestinal chez la souris -, les études menées in vivo montrent une activité antispasmodique évidente de l’huile essentielle et des composants isolés de celle-ci : l’huile essentielle de Mélisse et son composant majoritaire, le citral, inhibent les contractions sur l’iléon isolé de rat après traitement par le KCl ou l’acétylcholine, de façon concentration-dépendante et avec une IC50 de 20 ng/mL. D’autres études confirment cet effet sur le jéjunum et l’aorte de lapin et sur le muscle lisse de la trachée de cobaye. En clinique, une étude portant sur 133 enfants présentant une colite souligne l’action supérieure de la Mélisse par rapport à la siméthicone dans l’amélioration des symptômes coliques.
Anti-ulcérogène
Un extrait liquide éthanolique a été testé pour son activité anti-ulcérogène potentielle contre les ulcères induits par l’indométacine chez le rat. Il a démontré une activité anti-ulcérogène dose-dépendante à des doses orales de 2,5-10 mL/kg de poids corporel. La production d’acide a été réduite et la sécrétion de mucine augmentée. Une augmentation de la prostaglandine E2 et une diminution des leucotriènes ont été observées. L’effet anti-ulcérogène a également été confirmé histologiquement. Les résultats ont été interprétés comme provenant de la teneur en flavonoïdes de la plante et de son activité de piégeage des radicaux libres.
2. Sphère neurologique
Sédatif et hypnotique
In vitro, l’huile essentielle de Mélisse montre une forte activité dépressive sur la neurotransmission, de manière dose-dépendante. L’extrait aqueux inhibe fortement t’activité de la GABA-transaminase sur des cerveaux de rat avec une CMI de 0,35 mg/ mL. De toutes les substances déterminées dans cet extrait aqueux, c’est l’acide rosmarinique qui présente la plus forte activité (40 % à une concentration de 100 µg/mL).
In vivo, les propriétés sédatives d’un extrait hydroalcoolique ont été étudiées sur différents modèles animaux. Chez la souris, de faibles doses administrées par voie intra-péritonéale induisent un effet sédatif, et améliorent le sommeil provoqué par une dose infra-hypnotique de pentobarbital. Par voie orale cependant, l’huile essentielle est sédative et narcotique à la dose de 3,16 mg/kg. Dans le test de l’escalier, de petites doses d’extrait hydroalcoolique réduisent l’activité comportementale et le déplacement des souris. Après 3 semaines d’administration orale quotidienne (1 fois/jour) d’un extrait éthanolique de feuilles de Mélisse (50-200 mg/mL), on observe une augmentation des niveaux de GABA et de la prolifération et différenciation des neuroblastes dans le gyrus denté, et une réduction des taux plasmatiques de corticostérone. Lorsque l’on fractionne l’extrait en plusieurs parties à t’aide d’un solvant pour isoler les principes actifs et que l’on teste chez l’animal l’ensemble de ces fractions, on ne retrouve plus les effets biologiques de départ.
Anxiolytique
Les effets anxiolytiques et antidépresseurs d’un extrait éthanolique de Mélisse (30, 100 ou 300 mg/kg) ont été étudiés chez le rat mâle et femelle. La réponse à la réduction de l’anxiété a été dépendante du temps de traitement, et similaire à celle exercée par le diazépam (1 mg/kg) dans le groupe témoin. Il n’y a pas eu d’altération de la locomotion. Une autre étude, mesurant l’action anxiolytique d’un extrait de Métisse (Cyracos) chez la souris, observe également un effet de type anxiolytique de l’extrait dans des conditions de stress modéré et sans altérer les niveaux d’activité des animaux. Parmi les constituants étudiés, c’est encore l’acide rosmarinique qui se révèle actif, ainsi que les acides ursolique et oléanotique, même si l’action synergique de tous les éléments est supérieure à la somme de l’activité de chaque composant. Un extrait aqueux de Mélisse montre chez le rat une action de type antidépresseur en modulant la neurotransmission sérotoninergique par réduction du taux de turnover de la sérotonine.
En clinique, quelques études confirment la pharmacologie : on observe une diminution du stress chez l’homme (600 mg/jour), une amélioration de l’humeur et des performances cognitives chez de jeunes patients sains après absorption d’une boisson à base de Mélisse. Une association de Mélisse et de Valériane a été étudiée chez de jeunes enfants souffrant d’hyperactivité, de difficultés de concentration et de troubles impulsifs et les résultats montrent une diminution significative de75 à 14 % de la fraction d’enfants ayant des symptômes sévères de concentration, de 61 à 13 % pour l’hyperactivité et de 59 à 22 % pour les troubles impulsifs. En revanche, chez le patient atteint d’Alzheimer, une étude en double aveugle ne montre pas d’effet supérieur au donépézil ou au placebo en matière de réduction de l’agitation après 4 semaines de traitement par huile essentielle de Métisse.
Effet sur la cognition
In vivo, chez le rat, un extrait alcoolique de Mélisse, injecté par voie intra-péritonéale, améliore la mémoire spatiale et l’apprentissage par contribution probable du système cholinergique. In vitro, une étude démontre l’action de neuroprotection d’un extrait éthanolique de Métisse sur des cellules soumises à la toxicité des β-amyloïdes, en raison de l’effet antioxydant de l’extrait, et en particulier du fait de la présence des composés phénoliques et des acides triterpéniques. L’huile essentielle de Mélisse a par ailleurs démontré son activité d’inhibition de l’acétylcholinestérase et de la butyrylcholinestérase, ainsi qu’une modulation des récepteurs nicotiniques et muscariniques (avec déplacement de la [3H]-(N)-nicotine et la [3H](N)-scopolamine). Quelques études cliniques confortent l’usage bénéfique de la Mélisse dans le traitement de patients atteints de démence ou d’Alzheimer avec amélioration des fonctions cognitives et réduction de l’agitation.
Propriété analgésique périphérique
Chez la souris, un extrait éthanolique de feuilles de Mélisse, donné oralement à la dose de 3-1000 mg/kg, produit une action anti-nociceptive dose-dépendante dans différents modèles chimiques de nociception. L’extrait alcoolique de feuilles de Mélisse diminue la douleur viscérale induite par le glutamate chez la souris et la réduction de la douleur n’a pas été affectée par l’administration intra-péritonéale de naloxone. À fortes doses, in vitro, la Mélisse est douée de propriétés analgésiques mineures comparables à celles de l’aspirine.
3. Sphère immunitaire
Antiviral
In vitro, toutes les études réalisées avec différents extraits de Mélisse confirment l’activité antivirale de la plante, en particulier sur Herpès simplex virus type 2, Influenzavirus A2, Vaccinia virus, VIH, Rhesus rotavirus. Il a été démontré que c’est la fraction acides-phénols, en particulier l’acide rosmarinique, qui est impliquée dans l’action antivirale. Ces derniers interagissent avec les protéines virales en inhibant la biosynthèse protéique par blocage de la fixation du facteur d’élongation EF-2 sur les ribosomes. Sur le virus Herpès simplex, les extraits de Mélisse inhibent la pénétration du virus dans les cellules aussi bien pour les souches résistantes à l’aciclovir que pour les souches non résistantes.
Quelques études cliniques ont été entreprises, en particulier sur des patients porteurs d’herpès labial. Chez 66 patients ayant de façon chronique une infection herpétique (au moins 4 par an), l’application d’une pommade renfermant un extrait sec standardisé de feuilles de Mélisse se montre plus efficace qu’une pommade placebo et conduit à une réduction de l’intensité des symptômes, une diminution des rechutes et une meilleure prévention dans le risque de propagation de l’infection. De plus, la pommade utilisée a évité le phénomène de résistance du virus. Un autre essai clinique corrobore cette activité en soulignant que l’action est d’autant plus efficiente que l’application du traitement est précoce, soit dans les 72 heures suivant l’apparition des symptômes. L’inhibition des virus VIH a également été constatée au moyen d’extrait aqueux de la feuille.
Antibactérien
Quelques études réalisées in vitro démontrent l’activité antibactérienne de divers extraits de feuilles de Mélisse : action de la décoction sur Pseudomonas aeruginosa, sur Salmonella typhimurium, action des extraits éthanoliques sur S. aureus, L. monocytogenes, action de l’huile essentielle sur des bactéries Gram+ (alors que les bactéries Gram- sont peu sensibles) comparable et même supérieure à celle de l’huile essentielle de lavande. Les CMI requises pour l’effet antibactérien vont de 1 à 5 µL/mL pour l’huile essentielle. Les molécules impliquées dans cette activité sont essentiellement les aldéhydes (citral, citronellal) et le trans-caryophyllène de l’huile essentielle, ainsi que l’acide rosmarinique.
Antifongique
Les mêmes études ci-dessus soulignent également une activité antifongique, en particulier sur Candida albicans, Penicillium funiculosum, Rhizopus stolonifer, avec une inhibition de croissance moyenne.
Antiparasitaire
In vitro, l’action amibicide d’un extrait méthanolique de Mélisse a été testée sur Acanthamoeba castellanii sous leurs formes de trophozoïtes ou de kystes ; à la concentration de 32 mg/mL, 44,3 % des trophozoïtes ont été détruits ainsi que 30 % des kystes. Les monoterpènes et les sesquiterpènes de l’huile essentielle de Mélisse exercent par ailleurs une action destructrice sur Leishmania major et Trypanosoma brucei.
4. Sphère cardiovasculaire
Anti-inflammatoire
L’administration orale chez le rat d’huile essentielle de Mélisse à la dose de 200 ou 400 mg/ kg diminue respectivement l’œdème de la patte induit par carraghénates de 61,76 % et 70,58 %, et de façon similaire à la réduction obtenue avec l’indométacine (10 mg/kg). L’étude indique que l’action anti-inflammatoire résulte de l’inhibition de sécrétion des médiateurs de l’inflammation, le citral étant majoritairement responsable de l’inhibition de la production de TNFα.
En tant que composé isolé, l’acide rosmarinique a prouvé son action anti-inflammatoire in vivo en interférant dansla voie du complément.
Antioxydant
In vitro, les plantes de la famille des Lamiacées démontrent toutes une activité antioxydante en relation avec leur teneur en composés phénoliques. La Métisse a un fort potentiel antioxydant, comparable à celui du thé noir et vert. L’extrait aqueux de Mélisse exerce une inhibition considérable de la peroxydation lipidique, une capture des radicaux libres, et un effet protecteur des cellules vis-à-vis du peroxyde d’hydrogène.
In vivo, les effets de l’huile essentielle de Mélisse ont été observés après une ischémie provoquée dans l’hippocampe, et les résultats indiquent que la Mélisse atténue les dommages oxydatifs consécutifs à la lésion. En clinique, une infusion de feuilles de Mélisse (1,5 g/100 mL), prise 2 fois par jour pendant 30 jours, améliore l’état de stress oxydatif et protège l’ADN des dommages oxydatifs.
Action cardiaque
Des études récentes ont révélé l’action de la Mélisse sur le muscle et la conduction électrique cardiaque. L’étude de l’ECG chez le rat, après administration orale d’un extrait aqueux de Mélisse pendant une semaine à la dose de 50 à 200 mg/mL, a permis de noter un allongement des intervalles QRS, QTc et JT sans modification de la fréquence cardiaque ni de la pression artérielle. Une autre étude souligne chez le rat, après 14 jours consécutifs de gavage avec un extrait hydro-alcoolique de feuilles de Métisse (100 ou 20 mg/mL), une action chronotrope négative, ainsi qu’une protection cardiaque tors d’une induction d’arythmie par le CaCl2, avec réduction de la tachycardie et de la fibrillation ventriculaire associée. Cependant, cette activité anti-arythmique reste faible en comparaison avec t’amiodarone lors d’un test d’ischémie-reperfusion.
Une étude clinique portant sur 55 patients volontaires, ayant consommé un extrait lyophilisé de Mélisse pendant 14 jours, met en évidence la réduction de la fréquence des palpitations, en particulier chez les sujets anxieux.
5. Autres propriétés
Activité anticancéreuse et antitumorale
In vitro, les études confirment l’activité antitumorale de la Métisse sur de nombreux modèles cellulaires humains. Cette activité antiproliférative s’exerce de façon dose-dépendante et est corrélée à la présence du contenu polyphénolique de la plante et à son action antioxydante. L’acide rosmarinique contribue à cet effet cytotoxique sur des cellules humaines de cancer du côlon.
In vivo, chez le rat, l’extrait aqueux de Mélisse inhibe à raison de 40 % le développement de tumeurs mammaires induites, par activation de la caspase-7 entraînant l’apoptose des cellules tumorales.
Activité antithyroïdienne
Depuis les années 1980, quelques études, aussi bien in vitro que chez l’animal, indiquent que l’extrait aqueux de feuilles de Métisse inhibe l’activité de la TSH. Les résultats concluent que la Mélisse agit à la fois sur l’hormone et sur les récepteurs à la TSH, par inhibition de la liaison de la TSH à son récepteur et de la liaison des anticorps à la TSH et par action sur l’adénylcyclase.
Action hypolipémiante
Chez la souris transgénique APOE2 qui développe une hypertriglycéridémie extrême, l’administration orale d’huile essentielle de feuilles de Mélisse pendant 2 semaines conduit à une nette diminution des taux sériques de triglycérides par comparaison au groupe témoin. Les auteurs suggèrent que cet effet est relié à une modification du métabolisme lipidique, par inhibition de la synthèse des acides biliaires et du cholestérol, et à une modification du métabolisme des acides gras. L’étude histologique montre une diminution des signes de dégénérescence due à l’hyperlipidémie et un effet sur l’HMG-CoA réductase (action du citral).
Action hypoglycémiante
Les extraits éthanoliques de feuilles de Mélisse montrent un effet bénéfique dans le traitement de l’insulino-résistance et les dyslipidémies chez la souris obèse recevant une nourriture riche en graisses, modèle identique au syndrome métabolique et au diabète de type 2 chez l’homme. L’administration quotidienne chez la souris de 0,015 mg d’huile essentielle de Mélisse pendant 6 semaines entraîne une réduction de la glycémie, avec une augmentation de la tolérance au glucose et des niveaux d’insuline par rapport au groupe témoin. Ces faibles concentrations d’huile essentielle induisent une augmentation de la capture de glucose, et de son métabolisme au niveau hépatique et dans les tissus adipeux, ainsi que l’inhibition de la glyconéogenèse.
Action hépatoprotectrice
L’extrait aqueux, à la dose de 2 g/kg/jour pendant 4semaines, chez les rats présentant une hyperlipémie permet une diminution des transaminases, des phosphatases alcalines et une réduction du taux de lipoperoxydation liée à l’activité antioxydante.
C. Principales formes galéniques utilisées et posologies
1. Voie interne
Les dosages préconisés traditionnellement correspondent à 1,5-4,5 g en équivalent de drogue sèche, 1 à 3 fois/jour.
Les formes issues de la plante fraiche (TM, SIPF) sont particulièrement intéressantes.
Doses indicatives des formes liquides
- Infusion de feuilles ou de sommités fleuries : cette forme est extrêmement intéressante pour la Mélisse car elle présente une exceptionnelle biodisponibilité en polyphénols et composés aromatiques avec un rendement d’extraction respectivement de 93 % (dont 98 % pour l’acide rosmarinique) et 31% (dont 44% pour le citral). La tisane est réalisée à la dose de 10 g de feuilles par litre d’eau bouillante, en infusion de 15 minutes. Soit en pratique, 1 à 3 cuillères à café de feuilles sèches pour 150 à 250 mL d’eau ; boire 1 tasse 3 fois/jour ou 1 tasse au dîner et au coucher.
- Teinture mère, obtenue à partir des parties aériennes fraîches de la plante (degré alcoolique de 65° V/V) : 50 à 100 gouttes, 2 à 3 fois/jour.
- Extrait fluide : 2 à 4mL, 1 à 3 fois/jour.
- Soluté intégral de plante fraiche : 1 cuillère à café 1 à 2 fois/jour (jusqu’à 10 ml par jour), à diluer dans un grand verre d’eau.
- Extrait de plante standardisé : 1 cuillère à café 1 à 2 fois/jour, à diluer dans l’eau.
- Huile essentielle : généralement incorporée au sein d’un mélange contenant 3 à 6 g d’HE (toutes confondues) pour 125 mL d’excipient adapté ; prendre 30 à 50 gouttes du mélange, dans un peu d’eau, 2 à 3 fois/jour.
- Hydrolat : de 1 cuillère à café à 1 cuillère à soupe, 1 à 3 fois/jour, à diluer dans un peu d’eau. Forme idéale pour la femme enceinte ou en pédiatrie.
- Extrait fluide glycériné miellé :1 à 3 cuillères à café/jour, à diluer dans de l’eau.
Doses indicatives des formes solides
- Gélules d’HE dosées de 25 à 50 mg par gélule avec un excipient adapté, posologie : 1 à 3 gélules/jour.
- Gélules d’extrait sec dosées de 100 mg à 200 mg : 1 à 2 gélules, 2 à 3 fois/jour.
- Gélules de poudre micronisée : en moyenne, dosées de 150 à 300 mg avec une posologie de 1 à 2 gélules, 2 à 3 fois/jour. Notons que l’EMA valide la dose de 0,190 à 0,550 g par gélule, 1 à 3 fois/jour.
- Microsphères SD : 1 à 2 doses/jour. Avec une cuillerée mesure de 0,20 g équivalent à approximativement 100 gouttes de TM.
- Microsphères LE : 1 à 2 doses, 2 à 3 fois/jour. Avec une cuillerée mesure de 0,20 g équivalent à 25 gouttes de TM.
2. Voie externe
- Huile essentielle : par voie topique, l’huile essentielle sera appliquée diluée dans une huile végétale, un gel ou une pommade, en concentration variable de 10 à 30 % suivant l’étendue de la zone d’application, 2 à 4 fois/jour.
- Infusion de Mélisse : 50 g de feuilles par litre d’eau bouillante, en infusion de 15 minutes ; à utiliser en compresses locales ou à ajouter à l’eau du bain.
- Alcoolat de Mélisse : en frictions contre les rhumatismes et les contusions.
D. Effets secondaires, contre-indications et toxicité
1. Pharmacologiquement
Toxicité
- aucune toxicité connue aux doses thérapeutiques maximales préconisées. Deux études comprenant, l’une un traitement avec 300 à 900 mg d’extrait méthanolique par jour et la seconde un traitement avec 600 à 1600 mg de poudre de plante, n’ont montré aucune toxicité ;
- aucune génotoxicité, ni effet mutagène ou clastogène.
2. Effets secondaires et contre-indications selon l’approche clinique intégrative
Effets secondaires
Aucun effet secondaire rapporté.
À dose fortement dépassée (> 2 g), l’HE entraîne un engourdissement avec ralentissement respiratoire et chute de la pression artérielle.
Contre-indications
- Sphère hormonale : hypothyroïdies sévères d’origine centrale.
- Sphère cardiovasculaire : bradycardie sévère.
E. Précautions d’emploi
Autorisée et même indiquée au cours de la grossesse, de l’allaitement et chez le bébé (en tenant compte des propriétés neuroendocriniennes de la Mélisse). Signalons toutefois que par manque de données suffisantes, l’EMEA ne préconise pas l’usage de la Mélisse avant l’âge de 12 ans.
Interactions : aucune n’est répertoriée. Toutefois, il faudra tenir compte :
- de l’effet synergique ou antagoniste des plantes associées ;
- de l’effet hypnotique, majoré pour les malades sous benzodiazépines.
F. Propriétés cliniques issues d’une analyse physiologique intégrative
Tropisme principal : SNC, sphères digestive, cardiovasculaire et neuroendocrinienne.
Tropisme secondaire : métabolique, immunitaire, cutané en externe.
1. Au niveau symptomatique
Propriétés par voie interne
- Sphère digestive : antispasmodique musculotrope de type papavérinique ; carminatif, eupeptique, stomachique ; anti-nauséeux ; anti-ulcérogène, anti-gastritique ; anti-inflammatoire.
- Sphère cardiovasculaire : antispasmodique musculotrope ; anti-arythmique ; bathmotrope négatif.
- Sphère nerveuse/cérébrale : calmant, anxiolytique ; sédatif central, hypnotique, idéal pour toutes les formes d’insomnies accompagnées de phénomènes spasmodiques et d’anxiété ; améliorateur cognitif ; analgésique périphérique mineur.
- Sphère métabolique : hypocholestérolémiant ; hépatoprotecteur ; antioxydant.
- Sphère immunitaire (anti-infectieux et anti-inflammatoire) : antiviral (pour l’herpès, par voie locale) ; bactériostatique ; fongistatique ; antiparasitaire ; anti-inflammatoire ; antioxydant ; anti-tumoral (mineur).
Propriétés par voie externe :
- Antiseptique : antiviral vis-à-vis d’herpès virus I et II.
- Anti-inflammatoire : peau et organes génitaux externes.
- Relaxant.
- Calmant (HE).
2. Au niveau du drainage
- Hépatobiliaire : cholérétique.
3. Au niveau de la régulation neuroendocrinienne
Propriétés neurovégétatives
Sédatif du système nerveux central : sympatholytique αΣ-
Antispasmodique de type papavérinique.
Sédatif central.
Propriétés endocriniennes
Axe gonadotrope : antigonadotrope relatif.
Axe thyréotrope : freinateur TSH.
Post-hypophyse : anti-ocytocique
G. Indications en phytothérapie clinique intégrative
En France, les Cahiers de l’Agence 1998 stipulent que la Mélisse (feuille) peut revendiquer l’indication : « traditionnellement utilisée par voie orale dans le traitement symptomatique de troubles digestifs (ballonnement épigastrique, lenteur de la digestion, éructations, flatulences) et dans le traitement adjuvant de leur composante douloureuse/dans le traitement symptomatique des états neurotoniques (troubles mineurs du sommeil) ».
En phytothérapie clinique intégrative, le choix de la plante médicinale doit toujours répondre d’un raisonnement endobiogénique intégrant à la fois :
- la fonctionnalité endocrinienne de l’individu considéré dans son ensemble ;
- l’enchaînement dynamique des axes hormonaux dans leur chronologie et leur relativité respectives ;
- les raisons de la désadaptation de la réponse physiologique face aux nécessités métaboliques.
En phytothérapie clinique intégrative, les indications de la Mélisse sont les suivantes.
1. Indications principales
- Toutes les pathologies digestive et/ou cardio-vasculaire spasmodiques, notamment : à composante infectieuse et/ou inflammatoire ; chez la femme en hyper-hypophysisme fonctionnel (pré-ménopause) ; ulcères gastroduodénaux, colites, dyspepsies, dysmicrobisme intestinal, états nauséeux, dyskinésie biliaire, etc. ; éréthisme cardiovasculaire, certains troubles du rythme, certaines HTA, etc.
- Troubles du sommeil (notamment associés à des troubles de la digestion).
- Tous les états d’anxiété à composante spasmodique et manifestions tant centrales que périphériques.
- Tous les états dystoniques et spasmophiles.
- Grossesse : spasmodicité utérine du 3e trimestre ; nausées.
2. indications secondaires
En externe :
- herpès labial et génital (HE) ;
- inflammations de la peau et des organes génitaux (bains) ;
- spasmes du petit bassin (bains) ;
- en bains calmants et relaxant pour les troubles psycho-végétatifs ;
- pellicules du cuir chevelu (extrait aqueux) ;
- piqûres d’insectes.
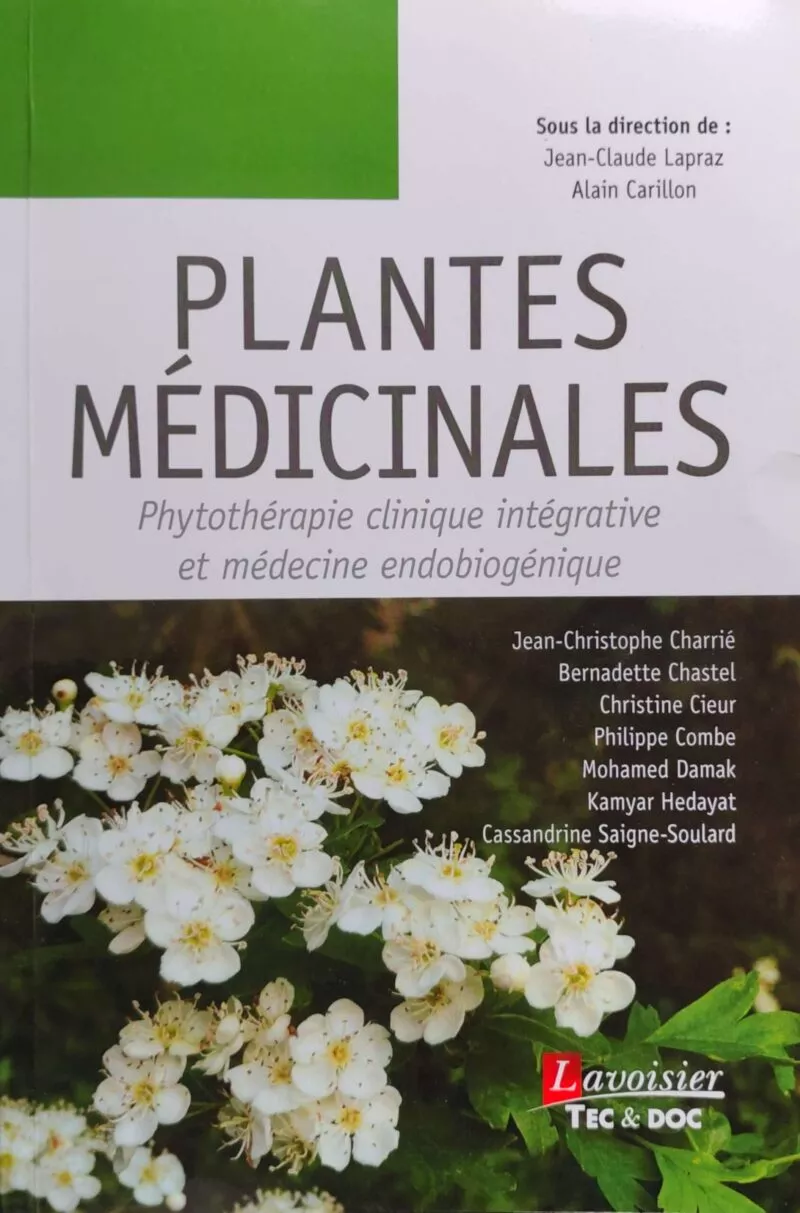
Pour en savoir +
Pour accéder à des informations plus détaillées et aux références bibliographiques qui permettent d’étayer les éléments présentées dans cet article, consultez le livre « Plantes médicinales », édité par Lavoisier TEC&DOC.
Plusieurs formateurs de l’Institut d’endobiogénie ont contribué à sa rédaction.



