- Guide des plantes
Chardon-Marie (Silybum marianum) : propriétés et bienfaits
Le Chardon-Marie : une plante connue pour ses propriétés hépatoprotectrices, antioxydantes, anti-inflammatoires et régénératrices du foie, utilisée traditionnellement et cliniquement pour traiter les affections hépatiques, digestives, métaboliques et même certaines pathologies cardiovasculaires et neurodégénératives.

Ce qu’il faut retenir…
Dans le cadre d’une phytothérapie clinique intégrée dans une réflexion endobiogénique, le Chardon-Marie se présente comme une plante prioritairement active :
– au niveau pharmacologique direct : sur la sphère hépatique et cardiovasculaire ;
– au niveau drainage: hépatique ;
– au niveau neurovégétatif : alpha-sympathomimétique léger ;
– au niveau endocrinien : sur l’axe somatotrope comme hypoglycémiant et améliorant de la fonctionnalité hépatique.
A. Propriétés issues de la tradition
Le Chardon-Marie est utilisé depuis l’Antiquité pour ses propriétés médicinales, notamment pour soigner le foie et la vésicule biliaire. Déjà recommandé par Théophraste et Dioscoride, il servait aussi à traiter les troubles digestifs, stimuler la lactation, et était consommé comme légume (jeunes pousses et racines).
Au Moyen Âge, il était employé pour lutter contre la « bile noire » (mélancolie) et les affections hépatiques. Au début du XXe siècle, ses graines étaient reconnues pour leurs effets toniques (cardiaques, vasculaires) et antihémorragiques.
Aujourd’hui, la médecine traditionnelle l’utilise toujours pour ses vertus :
- digestives (tonique, antidyspeptique, légèrement laxative)
- galactagogues (favorise la lactation)
- hépatoprotectrices (protection et régénération du foie, drainage hépatobiliaire)
- préventives et curatives (hépatites, cirrhoses, calculs biliaires, ictères, intoxications par des toxines naturelles ou synthétiques).
Son usage persiste grâce à son efficacité contre les dommages hépatiques et ses bienfaits sur la digestion et la circulation.
B. Données expérimentales et cliniques issues directement de la pharmacologie
La plupart des études pharmacologiques utilisent des préparations standardisées de silymarine ou de son constituant majoritaire, la silybine.
1. Sphère digestive : fort tropisme hépatique
Propriétés hépatoprotectrices
Le foie est impliqué dans de nombreux processus physiologiques et son rôle fondamental dans le métabolisme l’expose aux dommages causés par la toxicité de certains xénobiotiques.
La silymarine, à fort tropisme hépatique, possède des activités anti-hépatotoxiques et régénératrices liées à divers mécanismes cytoprotecteurs.
Mécanismes impliqués dans l’hépatoprotection
- Stabilisation de la membrane externe de l’hépatocyte : la silymarine empêche la pénétration intracellulaire des substances toxiques (alcool, médicaments, toxines végétales, etc.) par blocage du système de fixation et de transport transmembranaire. Elle modifie la structure membranaire de microsomes de rats en s’incorporant dans la double couche lipidique. L’augmentation des taux d’AMPc par inhibition de la phosphodiestérase pourrait également être impliquée dans la stabilisation de la membrane cellulaire.
- Potentialisation des défenses antioxydantes de la cellule par piégeage des radicaux libres oxygénés résultant du métabolisme de certaines substances toxiques et responsables de lésions membranaires par lipoperoxydation ; maintien du pool de glutathion intracellulaire, responsable de la détoxification hépatique, et de superoxyde dismutase ; diminution du taux de MDA (malone-dialdéhyde). Ces propriétés antioxydantes ont été observées avec la silymarine et la silybine in vitro sur différents modèles cellulaires humains (plaquettes, érythrocytes, fibroblastes) ou animaux (microsomes et mitochondries d’hépatocytes de rats), notamment l’inhibition de la production de radicaux anions superoxydes et d’acide nitrique sur cellules de Kupffer de rat isolées. On observe une inhibition de la production de NO et de l’expression génique de l’enzyme le synthétisant, l’iNOS (oxyde nitrique synthase inductible), par inhibition du facteur nucléaire NF-κB responsable de l’activation de l’iNOS.
- Stimulation de la régénération et de la multiplication cellulaire hépatique : la silybine est capable d’activer le métabolisme des hépatocytes et la synthèse protéique in vitro et in vivo : elle agit comme un stéroïde naturel en se liant au niveau du récepteur aux œstrogènes de la sous-unité régulatrice de l’ARN polymérase l’ADN-dépendante, activant ainsi la synthèse d’ARN ribosomal de 20 %, la formation de ribosomes et la synthèse protéique.
- Activité anti-fibrosique : la silymarine réduit la prolifération des hépatocytes stellaires à rôle pathogénique central dans la fibrogenèse hépatique, et leur conversion en myofibroblastes responsables de l’accumulation du collagène dans le foie. Trois ans d’administration de silymarine retardent le développement d’une fibrose hépatique induite par l’alcool chez le babouin.
- Mécanismes de détoxification hépatique : en partie par action sur les voies métaboliques de phase I (cytochromes CYP3A4 et CYP2C9) et II (augmentation de la glucuronoconjugaison).
Désordres hépatiques induits par l’alcool
La silymarine ou la silybine suppriment la lipoperoxydation et la déplétion en glutathion induites par l’alcool sur des hépatocytes de rats in vitro.
Plusieurs études cliniques versus placebo, incluant chacune entre 50 et ro patients (3 500 au total), rapportent le bénéfice d’un traitement par silymarine (280 à 560 mg/jour) et son innocuité dans le traitement de divers troubles hépatiques liés à l’alcool dont hépatites chroniques et cirrhoses régression des lésions histologiques après un an ; baisse de la mortalité après quatre ans d’étude, avec diminution de la bilirubine, des enzymes hépatiques (ASAT, ALAT, PAL…), du procollagène III (donc de l’activité fibrosique).
Hépatites virales aiguës et chroniques
Une étude randomisée en double aveugle incluant 57 patients porteurs d’une hépatite aiguë A ou B, et traités quotidiennement par 420 mg de silymarine pendant 3 semaines, montre dans le groupe traité une normalisation des paramètres biochimiques (bilirubine, transaminases), des durées d’hospitalisation réduites, un développement plus rapide de l’immunité ainsi qu’une réduction des complications associées à l’infection.
Dans le cas d’hépatites chroniques, un traitement par 420 mg de silymarine par jour pendant 3 à 12 mois améliore les paramètres histologiques, sans influencer les marqueurs biologiques ou fonctionnels.
La silymarine ou certains composés isolés inhibent la réplication d’une souche de VHC de génotype 2a sur des cultures cellulaires d’hépatomes infectés.
Dommages hépatiques induits par des toxiques environnementaux
L’administration de silymarine chez l’animal (chien, rongeurs) par diverses voies (intragastrique, intrapéritonéale, intraveineuse) protège le foie contre les dommages oxydatifs causés par le tétrachlorure de carbone (CCL4) ou certains métaux (manganèse, arsenic), par action antioxydants, freinatrice du métabolisme, stabilisatrice membranaire, et chélatrice des métaux, La silymarine (140 mg 3 fois/jour pendant 1 mois) améliore les fonctions hépatiques et normalise les marqueurs biologiques (transaminases [ASAT et ALAT], phosphatase alcaline, plaquettes) chez des sujets exposés de façon chronique à des vapeurs de toluène, xylène ou sulfure d’hydrogène.
Hépatotoxicité induite par des médicaments
Grâce à ses propriétés hépatoprotectrices, stabilisatrices de membrane, antioxydantes et antiradicalaires, le Chardon-Made protège le foie des agressions liées à certains traitements. La silymarine et la silybine diminuent ou suppriment les dommages hépatiques causés par différentes molécules (paracétamol ou acétaminophène, amitriptyline, nortriptyline, érythromycine…) sur hépatocytes de rat in vitro.
La restauration des fonctions hépatiques et la prévention des altérations histopathologiques par la silymarine sont observées in vivo après administration intrapéritonéale chez le rongeur exposé à divers toxiques (paracétamol, toxines de l’amanite phalloïde, éthanol, galactosamine, halothane, hydrocarbures aromatiques polycycliques, métaux). Dans une étude en double aveugle versus placebo portant sur 60 patients traités au long cours par psychotropes (butyrophénones, phénothiazines), l’administration orale de 800 mg/jour de silymarine pendant 3 mois améliore la fonction hépatique et prévient les dommages liés à la lipoperoxydation. La silybinine à 100 mg/kg/ jour per os pendant 45 jours protège également contre l’hépatotoxicité induite par la zidovudine chez des patients VIH+.
Associé à une chimiothérapie anticancéreuse, le Chardon-Marie se révèle un soutien intéressant dans une stratégie d’accompagnement thérapeutique car il réduit la toxicité hépatique et potentialise l’action du cytotoxique sur les cellules tumorales (synergie). Le traitement est mieux supporté et les interruptions moins fréquentes, comme constaté après quelques semaines d’administration de silymarine chez des patients atteints de leucémie promyélocytaire traités par méthotrexate et 6-mercatopurine, ou chez des enfants souffrant de leucémie lymphoblastique.
Troubles liés à l’ingestion de champignons toxiques
Les extraits de Chardon-Marie sont très efficaces pour traiter les intoxications à l’amanite phalloïde, réduisant les taux de mortalité jusqu’à 80 %. Rappelons que les toxines du champignon inhibent l’activité de l’ARN polymérase dans les hépatocytes en entraînent la mort des cellules du foie en 12 à 24 heures.
Une étude rétrospective portant sur 250 cas d’intoxication à Amanita phalloides, montre que l’administration intraveineuse de 20 à 50 mg/kg/jour de silybine pendant 3 à 4 jours, jusqu’à 48 heures après l’ingestion du champignon, permet de réduire drastiquement la mortalité. Même 3 jours après ingestion d’amanites phalloïdes, échec d’une thérapie standard et détérioration de l’état des patients, une administration de silybine pendant une semaine a sauvé les patients intoxiqués, avec normalisation, 2 mois plus tard, des enzymes hépatiques et des caractéristiques histologiques.
Stéato-hépatite non alcoolique
Souvent liée à certains états comme le diabète, l’hyperlipidémie, la résistance à l’insuline, l’hypertension ou causée par des facteurs génétiques ou des substances chimiques (alcool, corticostéroïdes, tétracycline et tétrachlorure de carbone), la stéato-hépatite non alcoolique (SHNA) peut régresser grâce à un traitement par silymarine. Administrée à 500 ou 1000 mg/kg per os chez L’homme pendant quelques mois, elle réduit l’accumulation des lipides dans le foie et la fibrose, diminue les taux de marqueurs enzymatiques (ASAT, ALAT, ASAVALAT<1, γGT) et inflammatoires (TNF), stabilise la membrane hépatocytaire, améliore la clairance hépatique, augmente la sensibilité à l’insuline.
Propriétés cholagogues
Un effet cholagogue est observé avec des extraits alcooliques (teintures) de la plante.
Administré par voie intragastrique chez le rat, un extrait acétonique du fruit augmente le volume et la concentration de la bite excrétée.
Propriétés anti-ulcéreuses
La silymarine améliore l’état redox et le pool de glutathion total dans les tissus de l’estomac et de l’intestin. Chez le rat, effet protecteur contre les agressions de la muqueuse gastrique.
L’administration orale de 25 à 100 mg/kg de silymarine chez le rat réduit le nombre et l’importance des ulcères gastriques induits par le stress du froid, par une sténose pylorique ou encore conséquence de l’ischémie-reperfusion, vraisemblablement par un mécanisme anti-inflammatoire lié à l’inhibition de la synthèse des leucotriènes. Pas d’effet noté sur les ulcères d’origine alcoolique.
2. Sphère immunitaire
Propriétés anti-inflammatoires et anti-allergiques
L’activité anti-inflammatoire de la silymarine et de ses principaux composants a été mise en évidence in vitro sur divers modèles (cellules de Kupffer de rat isolées, leucocytes humains, macrophages, hépatome, cancer de la prostate) : inhibition de l’activité de la lipooxygénase, de la prostaglandine synthétase, de la synthèse de NO, des leucotriènes B4, de la production de phospholipases A2 et de cytokines inflammatoires, avec suppression de l’activité transcriptionnelle du facteur nucléaire NFB, à rôle clef dans les réponses inflammatoires et immunitaires.
In vivo, l’administration intragastrique (251000 mg/kg) de silymarine réduit de façon dose-dépendante l’œdème de la patte induit par carraghénates chez le rat et, appliquée localement, réduit l’inflammation de l’oreille induite par xylène chez la souris, avec une efficacité comparable à celle de l’indométhacine. Elle réduit par ailleurs l’accumulation des leucocytes dans les exsudats inflammatoires induits par injection intrapéritonéale de carraghénates chez la souris, indépendamment de son activité antioxydante. On constate également une diminution de médiateurs de l’inflammation tels que TNF-alpha, IL-6 et NO. Chez le rat, la silymarine atténue l’inflammation des voies respiratoires induite par Les fumées de cigarettes ou par un allergène grâce à un effet en partie médié par la voie des MAP kinases et une régulation négative de l’activité NFB ; la silymarine atténue l’épaississement de l’épithélium bronchique, inhibe l’activation des macrophages et neutrophiles, prévient l’augmentation du MDA et la baisse de la SOD. L’effet inhibiteur sur la libération d’histamine médiée par les neutrophiles a été démontré pour la silymarine sur cellules mastocytaires péritonéales de rat, et pour la silybine sur leucocytes basophiles humains.
Propriétés immuno-modulatrices
La silymarine inhibe la prolifération des lymphocytes T et la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires, stoppe le cycle cellulaire en phase G1 et supprime la voie de signalisation du mTOR (d’où activation de l’apoptose) dans les lymphocytes T humains activés in vitro, d’où son intérêt potentiel dans les pathologies nécessitant une immunosuppression (greffes, pathologies auto-immunes).
Elle stimule la réponse immunitaire cellulaire dans la bêta-thalassémie majeure, vraisemblablement par action directe sur les mononucléaires producteurs de cytokines.
Propriétés anti-cancéreuses
La silymarine et ses composés isolés montrent in vitro et in vivo une action large sur la prévention et la progression de divers cancers. En plus de leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, leur action est médiée par des mécanismes interférant avec les processus de signalisation, prolifération, apoptose, transition épithéliale à mésenchymale, invasion, métastase ou angiogenèse et, peut-être en partie, par modulation du système immunitaire.
Effet préventif protecteur
L’effet préventif protecteur de la silymarine vis-à-vis de l’induction tumorale a été mis en évidence dans le cancer de la peau provoqué par des radiations UV ou chimiquement induit. L’application locale de silybine montre un effet préventif sur la formation de tumeurs cutanées induites chimiquement chez la souris, grâce à la stimulation des mécanismes cytoprotecteurs endogènes, suppression du stress oxydatif et dérégulation de l’activation de médiateurs pro-inflammatoires et de la carcinogenèse. On observe également un effet préventif vis-à-vis d’une tumeur de la prostate chimiquement induite.
L’effet antiprolifératif de la silymarine observé in vitro sur de nombreux types cellulaires humains (prostate, sein, ovaire, poumon, peau, côlon, foie, rein…) se traduit par une perte de la viabilité cellulaire, une inhibition de la croissance des cellules tumorales par inhibition de voies de signalisation (Notch, Wnt/LRP6…) impliquées dans les processus d’autophagie et d’apoptose, la prévention de l’apparition de métastases.
Administrées in vivo par voie orale chez l’animal sur différents modèles de cancers (sein, colorectal, mélanome, prostate…), la silymarine ou la silybine reproduisent ces effets avec une réduction du volume des tumeurs, une diminution de l’expression de biomarqueurs de prolifération ou d’angiogenèse tumorale, parfois une prolongation de la survie.
La silymarine interfère avec l’expression de régulateurs du cycle cellulaire et de protéines impliquées dans l’autophagie ou l’apoptose et intervient donc dans la modulation de l’équilibre entre survie et mort cellulaire. Au niveau moléculaire, différents mécanismes pro-apoptotiques ont été mis en évidence :
- mort cellulaire par autophagie via un dysfonctionnement mitochondrial ROS-dépendant (réduction du potentiel de membrane) et libération de cytochrome C ; déplétion en ATP liée à la stimulation de l’expression d’une protéine pro-apoptotique (cellules de cancer du sein MCF7) ;
- suppression de l’activation des facteurs de transcription NF-κB, AP-1 et STAT3 (silybine et dérivé 2,3-déhydrosilybine sur cellules tumorales basocellulaires murines ou mélanomes) par inhibition de l’activité kinase de (MEK)-1/2 et RSK-2 et blocage des voies de signalisation médiées par ces kinases ;
- augmentation du taux de protéines pro-apoptotiques (Sax), activation des caspases 9 et 3 (pro-apoptotiques) et diminution des taux de protéines anti-apoptotiques (Bc1.-2, Bcl-xL) in vitro dans des cellules de cancer de l’ovaire, de mélanome humain, ou du pharynx ;
- sur cellules Hep-2 de cancer laryngé, la silybine induit l’apoptose via une réaction de stress oxydatif (production de radicaux libres oxygénés dans les cellules) et par régulation négative de l’expression de survivine.
Potentialisation de la cytotoxicité de certains traitements anticancéreux
La silymarine et des composés isolés augmentent l’efficacité de certains traitements anticancéreux en potentialisant leur cytotoxicité tout en réduisant simultanément, parfois, leur toxicité sur les tissus sains. Des études réalisés in vitro sur différents types cellulaires montrent une synergie de la silymarine avec divers anticancéreux (témozolide, étoposide, irinotécan dans le gliome, doxorubicine dans le cancer du sein).
On constate également un effet synergique additif au niveau de la réponse de cellules cancéreuses de vessie en associant la silybine à une thérapie photodynamique.
Par ailleurs, la silybine peut se révéler active sur des cellules cancéreuses résistantes à certains traitements in vivo, comme à l’erlotinib dans le cancer du poumon non à petites cellules. Dans le cadre d’une approche holistique, en complément d’une prise en chargeanticancéreuse, l’utilisation du Chardon-Marie est reconnue parmi les plantes les plus bénéfiques, notamment selon la liste du Clinical practice committee of the society of integrative oncology.
Propriétés antivirales
Des propriétés antivirales de la silymarine et de certains composés isolés comme la silybine, l’isosilybine A et la taxifoline ont été mises en évidence in vitro pour différents virus comme le virus influenza A, le VHC ou le VIH.
La silymarine et la silybine inhibent la réplication du VHC in vitro sur cultures d’hépatocytes en agissant sur les niveaux d’expression de TNFα et NF-κβ.
Concernant le VIII, la silymarine appliquée pendant la phase d’adsorption du virus bloque l’infection des lymphocytes T 101 et la silybinine atténue les fonctions cellulaires impliquées dans l’activation, la prolifération des lymphocytes T et la réplication du VIH-1.
La silymarine interfère avec le mécanisme d’endocytose, retarde la pénétration du virus dans la cellule et empêche sa prise en charge par la transferrine.
3. Sphère métabolique
Amélioration du métabolisme glucidique
Sur 62 plantes médicinales testées dans le diabète sucré (85 études dont 18 chez l’humain), le Chardon-Marie figure parmi les plantes les plus efficaces dans le contrôle glycémique.
Chez 56 patients souffrant de diabète de type 2, l’administration d’un extrait normalisé de Chardon-Marie (200 mg 3 fois/jour, durant 3 mois) améliore Le contrôle de la glycémie (réduction de la glycémie à jeun et du taux d’hémoglobine glyquée), et diminue les taux sanguins de cholestérol et de triglycérides [69].
Une supplémentation de 140 mg 3 fois/jour de silymarine pendant 45 jours chez des diabétiques de type 2 augmente par ailleurs la capacité antioxydante totale (augmentation de l’activité enzymatique de la superoxyde dismutase et de la glutathion peroxydase) et diminue certains marqueurs de stress oxydatif comme le taux de hs-CRP.
La silymarine ou l’isosilybine A(3) diminuent la résistance à l’insuline, en partie par action agoniste du récepteur PPAR (régulateur clef du métabolisme du glucose et des lipides). Chez le rat, on observe avec la silymarine une modulation de la résistance à l’insuline par augmentation de l’expression de PTEN (phosphatase and tensin homolog), régulatrice d’importantes fonctions cellulaires.
L’effet protecteur sur le rein a été démontré chez le rat diabétique souffrant de néphropathies : baisse des paramètres biochimiques (taux de glycémie, Hb glyquée, volume urinaire, uricémie, albuminurie) et amélioration histologique après 2 mois de traitement par 60 à 120 mg/kg de silymarine.
La silybine améliore également les rétinopathies ; diabétiques.
Amélioration du métabolisme lipidique
Les effets de la silymarine sur le métabolisme du cholestérol ont été démontrés in vitro et in vivo. Chez des rats soumis à un régime alimentaire enrichi en cholestérol, l’ajout de silymarine entraine une diminution de la concentration de cholestérol dans le foie, des taux sériques de LDL et VLDL et une augmentation du taux de HDL. Chez le poisson zèbre, la silybinine inhibe l’accumulation des lipides par inhibition de l’adipogenèse précoce.
Propriétés anti-ostéoporotiques
La silymarine administrée chez La rate ovariectomisée prévient la perte osseuse en interagissant directement avec le récepteur oestrogénique ERβ ou en augmentant les facteurs favorisant la formation osseuse comme calcium, phosphore, ostéocalcine et PTH.
La silymarine stimule la formation de l’os par régulation de l’expression de gènes favorisant la construction osseuse et prévenant la perte de calcium. Chez la souris, une supplémentation améliore la guérison d’une fracture tibiale par des effets oestrogéniques anti-ostéoporotiques clairement observés au niveau de la structure osseuse.
Chez le rat, 2 mois d’administration de silymarine per os à une dose de 10 mg/kg prévient la perte osseuse induite par le déficit en œstrogènes post-ménopausique.
Réduction de la surcharge hépatique en fer
L’administration orale de 100 mg/kg/jour de silybinine (mélangé avec du béta-cyclodextrine), à des rats soumis à une diète prolongée excédante en fer, a montré une protection substantielle contre la toxicité hépatique induite par le fer, réduisant l’accumulation de MDA dans les hépatocytes et dans la mitochondrie, et améliorant l’efficacité de la fonction du foie, en contrecarrant la baisse de production de l’ATP et la dissipation de l’énergie mitochondriale.
Enfin, la drogue prévient le risque de surcharge en fer lié au traitement par déféroxamine.
4. Autres propriétés
Troubles neurodégénératifs
Par sa capacité à inhiber le stress oxydatif au niveau cérébral et à moduler des voies telles que l’agrégation du peptide β-amyloïde, les mécanismes inflammatoires, la machinerie cellulaire apoptotique, médiation par récepteur oestrogénique, la silymarine possède un potentiel en tant qu’agent neuroprotecteur.
Maladie d’Alzheimer : sur un modèle de maladie d’Alzheimer chez le rat, recevant 70 à 140 mg/kg/jour de silymarine pendant 1 mois, on constate une amélioration des fonctions cognitives, une régression des plaques amyloïdes au niveau du cerveau et une suppression de l’expression du précurseur protéique de l’amyloïde (APP), confirmant l’effet anti-amyloïdogène de la silybine observé in vitro. La silybine pourrait agir comme un inhibiteur de l’acétylcholine estérase (ACE) et de l’agrégation du peptide β-amyloïde.
Maladie de Parkinson : la silymarine (100 mg/kg/jour), administrée par voie intra-péritonéale pendant 5 jours sur un modèle de maladie de Parkinson chez la souris, prévient de façon dose-dépendante la dégénérescence neuronale (diminution du nombre de cellules apoptotiques, préservation des neurones dopaminergiques) et l’élévation des taux de molécules inflammatoires comme TNF, IL-1β et iNOS. Les effets neuroprotecteurs et l’amélioration des symptômes (atténuation du déficit moteur et de la perte des neurones dopaminergiques) observés avec la silybine sur ce modèle sont vraisemblablement médiés par la stabilisation du potentiel de membrane mitochondriale.
Vieillissement : grâce à son potentiel anti-inflammatoire et antioxydant, le Chardon-Marie se révèle actif pour lutter contre le vieillissement. Il atténue les dommages oxydatifs et les dysfonctionnements mitochondriaux chez la souris vieillissante. La silymarine augmente la durée de vie moyenne, améliore la capacité de locomotion chez les sujets âgés, la réponse aux stimuli, la tolérance au stress sur un modèle animal de C. elegans.
Sphère cutanée
Cicatrisation : la silymarine stimule l’épithélialisation et réduit l’inflammation de plaies d’excision chez le rat. La silybine accélère le processus de cicatrisation, en augmentant l’expression du gène STM1 (stromelysine 1) et des constituants de la matrice extracellulaire tels que glycosaminoglycanes ou collagène.
Sphère cardiovasculaire
Effets vasculaires : la silybinine a montré in vitro des propriétés antagonistes du récepteur de l’angiotensine humaine AT1 (peptide vasoconstricteur). La teneur en tyramine et en flavonoïdes confère cependant à la plante des activités de tonique vasculaire. D’autre part, aucune étude récente n’a été menée concernant l’effet antihypertenseur du Chardon-Marie.
Ischémie-reperfusion : dans divers modèles animaux, la silymarine se révèle capable de protéger cœur, cerveau, foie ou rein contre les dommages induits par l’ischémie-reperfusion, du fait d’un mécanisme de protection « préconditionnement », qui réduit les dommages histologiques et fonctionnels. Un rôle protecteur similaire a été reconnu pour la 2,3-déhydrosilybine mais en tant que protecteur cardiaque « post-conditionnement ».
C. Principales formes galéniques utilisées et posologies
Seule la voie interne est exploitée avec le Chardon-Marie. Les dosages dépendront de l’activité recherchée. Par exemple, pour l’action anti-hépatotoxique, une dose équivalente à 420 mg de silymarine serait nécessaire. Toutefois, certaines pratiques traditionnelles tiennent compte de la synergie du totum, ce qui permet des doses inférieures en équivalent silymarine.
1. Formes liquides et doses indicatives
Extrait fluide : 50 à 150 gouttes, 1 à 3 fois/ jour, avant les repas.
Extrait de plante standardisé : 2 à 3 cuillères à café/jour, dans de l’eau.
Teinture mère : 20 à 50 gouttes, 3 fois/jour, avant les repas. Remarquons que la TM était réalisée, à l’origine, à partir du fruit séché, ce qui peut éventuellement limiter son intérêt par rapport à l’extrait fluide.
Extrait fluide glycériné miellé : 1 cuillère à café dans un grand verre d’eau, 3 fois/jour.
Tisane : principalement réalisée avec la partie aérienne (et non pas le fruit), celle-ci sera principalement indiquée dans les troubles digestifs légers ou en traitement complémentaire des troubles biliaires à la posologie de 1/2 cuillère à café de feuilles sèches infusées 10 minutes dans une tasse d’eau bouillante, 2 à 3 tasses/jour.
Si l’on tient à utiliser les fruits, il faudra les écraser au préalable, avant l’infusion ou la décoction.
Remarque : les composés actifs du Chardon-Marie étant peu hydrosolubles, infusions et décoctions en contiennent beaucoup moins que teintures ou extraits normalisés.
2. Formes solides et doses indicatives
Gélules d’extrait sec (ES) dosées de 100 à 200 mg : 2 à 5 gélules/jour, avant les repas. Les ES sont généralement concentrés au 1:5 à 6 avec un maximum de 20 % de silymarine.
Gélules de poudre micronisée (PM), de préférence cryobroyée, dosées de 300 à 400 mg : jusqu’à 6 gélules/jour, avant les repas.
Microsphères SD :1 à 2 doses/jour (1 dose de SD= 200 mg, en correspondance de 100 gouttes de TM).
Spécialités :
–le Légalon, contenant 70 mg de silymarine exprimée en silybinine, est proposé dans les troubles fonctionnels digestifs observés au cours des pathologies hépatiques (posologie : 2 comprimés, 2 à 3 fois/jour avant les repas) ;
–autres associations existantes : avec des plantes complémentaires, sous formes de gélules de mélanges de poudres totales, ou avec la phosphatidylcholine qui potentialise l’absorption de la silybine et permet d’en réduire la posologie ;
– enfin, pour augmenter la biodisponibilité de molécules peu hydrosolubles comme la silymarine ou la silybine, des nanotechnologies, permettant une libération prolongée des principes actifs, sont à l’étude.
D. Effets secondaires, contre-indications, toxicité
1. Pharmacologiquement
Toxicité : aucune toxicité aiguë, subaiguë ou chronique connue (même après administration de 20 g/kg de silymarine per os chez la souris). Le Chardon-Marie est considéré comme non toxique aux doses généralement préconisées. Pour rappel, la silymarine est prioritairement excrétée par la bile sous forme de sulfo- et glucuroconjugués (20 à 40 % en 24 heures) et par le rein (3 à 7 %) sans aucune accumulation.
2. Effets secondaires et contre-indications selon l’approche clinique intégrative
Effets secondaires
- Rares troubles gastro-intestinaux légers : nausées, diarrhées légères et passagères.
- Possible réaction d’hypersensibilité chez les sujets allergiques aux Astéracées, œdème, prurit.
Contre-indications
- La plante est contre-indiquée chez les sujets allergiques aux Astéracées.
- On ne doit pas l’utiliser en phase aiguë de migration d’un calcul biliaire.
E. Précautions d’emploi
Précautions d’emploi
Par manque de données, le Chardon-Marie est déconseillé par les instances officielles (OMS) :
- chez la femme enceinte ou allaitante, et ceci malgré son indication traditionnelle pour favoriser l’allaitement !
- chez l’enfant sans surveillance médicale. Il faudra également tenir compte des propriétés cholagogues de la plante et donc du risque de migration de lithiase vésiculaire.
Interactions médicamenteuses
Bien que certaines études in vitro suggèrent que le Chardon-Marie pourrait moduler l’activité d’enzymes spécifiques du cytochrome P450 (2C9 et 344/5) impliquées dans l’élimination des médicaments par l’organisme, les études cliniques in vivo chez l’homme n’ont révélé aucune interférence notoire ou conséquence clinique.
D’après le site Eureka santé du Vidal, certaines interactions particulières ont été décrites entre la silymarine et des médicaments antiallergiques sédatifs (Phénergan, Primalan, Quitadril, Théralène), le métronidazole (un antiinfectieux, par exemple dans Llagyl, Birodogyl ou Rodogyl), des médicaments antipsychotiques (par exempte Haldol ou Dipipérone) ou la yohimbine (Yocoral, Yohimbine Houdé).
F. Propriétés cliniques issues d’une analyse physiologique intégrative
Tropisme principal : sphère digestive avec spécificité hépatique et sphère immunitaire.
Tropisme secondaire : métabolique et cardiaque.
1. Au niveau symptomatique
- Sphère digestive – tropisme hépatique marqué : hépatoprotecteur ; détoxiquant hépatique (actif sur les phases Iet II) ; anti-fibrotique ; anti-radicalaire et antioxydant ; anti-inflammatoire ; anti-ulcéreux ; anti-dyspepsique ; légèrement cholagogue.
- Sphère immunitaire : anti-inflammatoire ; anti-œdémateux ; antiviral (hépatite C) ; anti-carcinogénique, antiprolifératif ; chimio-préventif.
- Sphère cardiaque : anti-hypotenseur ; chronotrope+ fort ; inotrope+ ; tonique artério-veino-lymphatique ; hémostatique.
- Sphère métabolique : hypoglycémiant ; hypocholestérolémiant ; diminue la surcharge ferrique du foie ; galactogène.
2. Au niveau du drainage
- Hépatobiliaire : cholagogue ; décongestionnant splanchnique et portal.
3. Au niveau de la régulation neuroendocrinienne
- Propriétés neurovégétatives : sympathicomimétique αΣ+ léger.
- Propriétés endocriniennes : axe somatotrope :
- sur le pancréas endocrine : hypoglycémiant ;
- sur le foie, amélioration de sa fonctionnalité : hépato-régénérateur.
G. Indications en phytothérapie clinique intégrative
Le Chardon-Marie est une plante reconnue par les instances internationales, avec de multiples études au niveau humain. Elle est validée par l’OMS, L’ESCOP, la Commission E, la Pharmacopée française (Cahiers de l’Agence) et le British Compendium.
La Commission E a approuvé dès 1989 l’usage de l’extrait de silymarine, normalisé à 70-80% pour traiter les intoxications hépatiques, et comme adjuvant en cas d’hépatite et de cirrhose du foie. En 2002, l’OMS reconnaissait sensiblement les mêmes usages. Plus récemment (2009), l’ESCOP a reconnu les effets anti-carcinogéniques du Chardon-Marie dans une stratégie d’accompagnement thérapeutique.
Les Cahiers de l’Agence (1998) reconnaissent l’usage du Chardon-Marie pour le traitement symptomatique des troubles fonctionnels digestifs attribués à une origine hépatique.
La Commission européenne et l’OMS reconnaissent l’usage des fruits de Chardon-Marie pour le traitement de divers troubles dyspepsiques d’origine hépatique et biliaire, et celui du Légalon dans le traitement des intoxications hépatiques et comme adjuvant dans l’hépatite et la cirrhose.
En phytothérapie clinique intégrative, le choix de la plante médicinale, même pour une action ô un niveau strictement symptomatique et de drainage, comme pour l’utilisation du Chardon-Marie, doit toujours répondre d’un raisonnement endobiogénique intégrant à la fois :
- la fonctionnalité endocrinienne de l’individu considéré dans son ensemble ;
- l’enchainement dynamique des axes hormonaux dans leur chronologie et leur relativité respectives ;
- les raisons de la désadaptation de la réponse physiologique face aux nécessités métaboliques.
En phytothérapie clinique intégrative, les indications du Chardon-Marie sont essentiellement les suivantes.
1. Indications principales
Sphère digestive
- Toutes les affections hépatobiliaires à composante inflammatoire, infectieuse ou fibrosante : hépatites virales, médicamenteuses, toxique–. ; états pré-cirrhotique et cirrhotiques ; stéatose hépatique ; cholangite sclérosante ; etc.
- Toutes les affections de la sphère digestive à composante congestive : « foie cardiaque » ; congestion portale et splanchnique ; certains ulcères gastroduodénaux, surtout si reflux biliaire ; dysplasies épithéliales par reflux œsophagien.
Sphère cardiaque
- Toutes les affections cardiovasculaires à composante congestive et/ou à surcharge du cœur droit : congestion du système porte ; hypertension pulmonaire (HTAP) ; varices œsophagiennes ; etc.
2. Indications secondaires, en adjuvant
- Toutes les affections vasculaires à composante congestive : certaines hémorroïdes ; certaines varices des ML
- Toutes les affections métaboliques impliquant une participation hépatique : dyslipidémie à participation hépatique ; état prédiabète à participation hépatique eV ou pancréatique ; hypertensions à participation hépatique ; obésité à participation hépatique et/ou pancréatique.
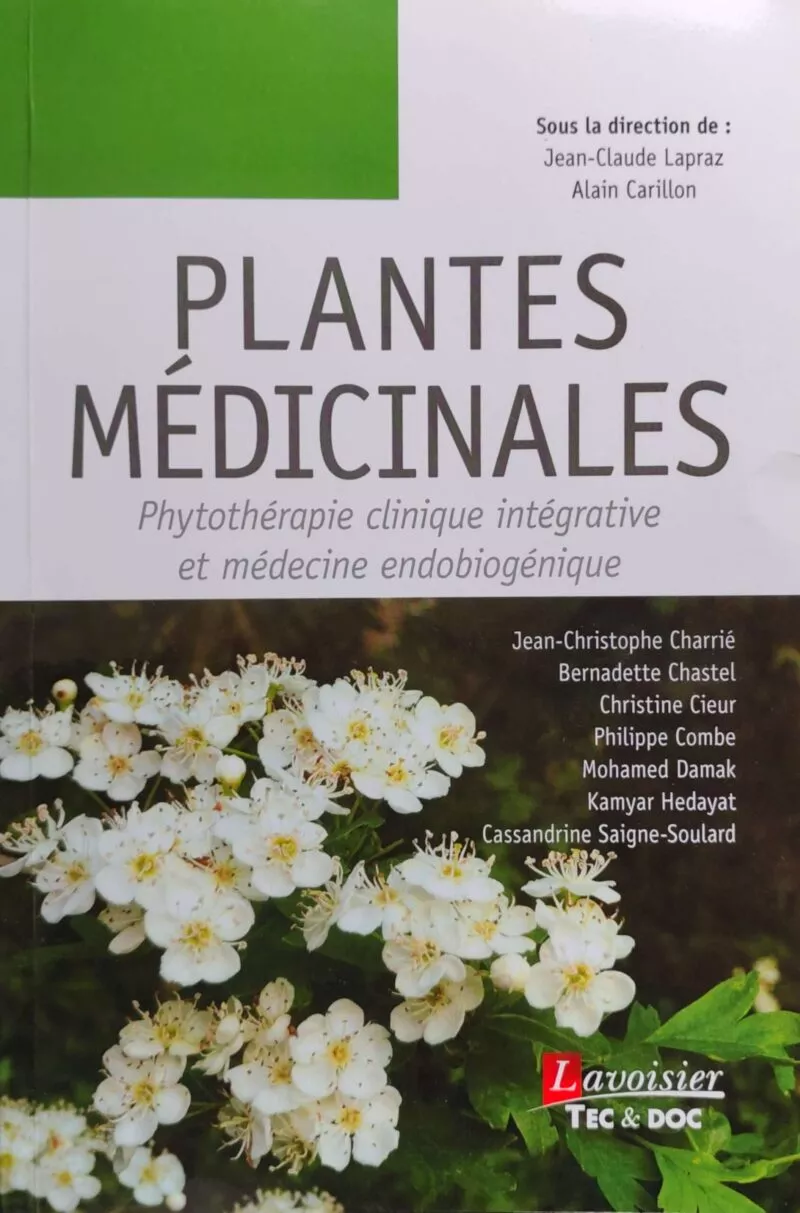
Pour en savoir +
Pour accéder à des informations plus détaillées et aux références bibliographiques qui permettent d’étayer les éléments présentées dans cet article, consultez le livre « Plantes médicinales », édité par Lavoisier TEC&DOC.
Plusieurs formateurs de l’Institut d’endobiogénie ont contribué à sa rédaction.



