- Guide des plantes
Aubépine (Crataegus laevigata) : propriétés et bienfaits
L’Aubépine : une plante phare de la phytothérapie, réputée pour ses bienfaits sur le cœur, la régulation du système nerveux et le soutien de l’équilibre général de l’organisme.

Ce qu’il faut retenir…
Dans le cadre d’une phytothérapie clinique intégrée dans une réflexion endobiogénique, l’Aubépine se présente comme une plante prioritairement active :
au niveau pharmacologique direct : sur la sphère cardiaque ;
au niveau neurovégétatif : en tant que sympathicolytique puissant ;
au niveau endocrinien : en tant que régulateur indirect dans le sens de la freination de l’axe corticotrope et donc du démarrage de la réactivité adaptative de l’enchaînement fonctionnel des axes.
A. Usages traditionnels de l’Aubépine
- Alimentation : ses fruits étaient consommés dès la Préhistoire (« baies à farine » pour la fabrication de pain).
- Antiquité & Moyen Âge : mentionnée par Dioscoride comme fébrifuge et astringente ; au Moyen Âge, les fleurs étaient conseillées contre la goutte et la pleurésie, et un sirop de fruits était réputé « contre la vieillesse ».
- Médecine chinoise : connue depuis 650 av. J.-C. pour ses effets cardiovasculaires.
- Reconnaissance moderne (XXe s.) : les travaux de médecins européens et américains révèlent ses propriétés majeures : tonique cardiaque, antispasmodique, sédative. Utilisée dans l’insuffisance cardiaque légère, les arythmies, l’hypertension et les troubles nerveux – d’où son surnom de « valériane du cœur ».
- Usages complémentaires : diurétique (contre l’obésité, en Allemagne), astringente en gargarismes (baies).
B. Données expérimentales et cliniques issues directement de la pharmacologie
1. Tropisme principal sphère cardiaque
Action tonicardiaque
L’action inotrope de l’Aubépine et de ses constituants ont été démontrés in vitro et in vivo. On attribue généralement ces effets aux flavonoïdes et aux procyanidines : un extrait hydroalcoolique de sommité fleurie, les fractions flavonoïques et procyanidiques, et les constituants isolés ont tous les mêmes propriétés inotropes positives et prolongent la période réfractaire de la cellule myocardique et du cœur isolé de cobaye.
Sur le cœur isolé de cobaye perfusé à pression constante avec 3 µg d’un extrait standardisé d’Aubépine, on observe une augmentation de la contractilité cardiaque de 9,5 % À la concentration de 120 µg, un extrait standardisé de sommité fleurie entraîne une augmentation de 153 % de la force de contraction cardiaque. Deux fractions proanthocyanidiques et deux fractions flavonoïdes d’un extrait aqueux d’Aubépine induisent un effet inotrope positif et la dilatation des coronaires.
Plusieurs mécanismes semblent impliqués dans cet effet inotrope l’inhibition de l’adénosine-triphosphatase de la pompe Na/K, ce qui induit indirectement une augmentation du calcium intracellulaire ; l’effet catécholamine-like sur l’adénylcyclase conduisant à une augmentation du taux d’AMPc et, par activation de la protéine kinase A, aboutit à une augmentation de la contractilité myocardique ; l’inhibition de la phosphodiestérase.
Des études cliniques chez l’homme confirment l’augmentation de la force de contraction cardiaque comparativement aux groupes témoins.
Action chronotrope négative
L’action chronotrope négative ainsi que l’effet anti-arythmique ont été étudiés in vitro sur des cultures de cardiomyocytes de souris : comparativement à des drogues cardiovasculaires conventionnelles (épinéphrine, propranolol), le mode d’action de l’Aubépine ne semble pas impliquer un blocage des récepteurs β-adrénergiques aux doses qui induisent l’effet chronotrope négatif. L’activité chronotrope négative est observée aussi bien pour des extraits de sommités fleuries que ceux de baies d’Aubépine.
In vivo, chez le rat, on observe, après administration per os unique de 12,5 mg/kg (macérat glycériné), une légère action bradycardisante avec une diminution de la fréquence cardiaque allant de 5 à 10 %.
Vasodilatation coronarienne, augmentation de la perfusion coronarienne et myocardique
Plusieurs études chez l’animal montrent, aussi bien sur organe isolé que sur l’animal entier per os, que l’administration d’un extrait de sommités fleuries d’Aubépine, enrichi ou non en fraction flavonoïque, entraîne une augmentation du débit coronaire, une vasodilatation des coronaires et une diminution des résistances périphériques.
Action anti-arythmique
Cette activité s’accompagne d’une augmentation de la repolarisation du potentiel d’action cardiaque et l’hyperpolarisation du muscle lisse suggère que les extraits d’Aubépine se conduisent comme des agonistes des canaux potassiques. On constate également un allongement de la période réfractaire.
Inhibition de l’hypertrophie cardiaque
In vitro, un extrait sec de sommités fleuries inhibe l’activité enzymatique de la calcineurine, enzyme qui contribue à la croissance du cardiomyocyte. Des tests in vivo chez l’animal permettent de constater que l’Aubépine prévient l’hypertrophie cardiaque et l’hyperplasie de l’intima.
Pharmacologie clinique cardiaque
Les études cliniques réalisées sur l’utilisation de la sommité fleurie d’Aubépine montrent à la fois une amélioration des performances cardiaques dans l’insuffisance cardiaque, de la perfusion circulatoire myocardique, une activité anti-arythmique, en particulier chez les patients en insuffisance cardiaque de stade II, ainsi qu’une amélioration de la tolérance à l’effort chez ces mêmes patients (diminution de la dyspnée et de la fatigue évaluée à 50 %).
2. Sphère vasculaire
Activité antiplaquettaire
In vivo, avec un extrait aqueux d’Aubépine, on a pu observer à des doses administrées de 100, 200, 500 mg/kg un allongement du temps de saignement, une diminution de l’agrégation plaquettaire, une réduction du taux sanguin de thromboxane B2. À la dose de 1000 mg/kg, on n’observe plus de modification pour le temps de saignement et à la dose de 2000 mg/kg, le taux de thromboxane B2 augmente.
Activité endothéliale
In vivo, Bubik et al. ont montré l’action d’un extrait d’Aubépine sur la perméabilité de l’endothélium vasculaire par régulation de l’entrée de calcium ionisé et activation de l’AMPc.
Hypotenseur
L’action anti-hypertensive a été démontrée sur de nombreux modèles animaux, accompagnée d’une diminution de la résistance vasculaire périphérique, et ce, aussi bien pour des extraits totaux standardisés d’Aubépine que pour des fractions d’hyperoside.
L’administration intraveineuse d’un extrait fluide de sommités fleuries (équivalent à 6 mg de procyanidine/kg de poids corporel) à des chiens normotensifs anesthésiés montre une diminution de l’élévation de pression artérielle induite par la norépinéphrine.
De l’hyperoside, isolé à partir d’un extrait desommité fleurie d’Aubépine, administré par voie intraveineuse chez le chien anesthésié, induit également une diminution de la pression artérielle. Chez le rat normotensif anesthésié, l’injection intraveineuse d’un extrait aqueux d’Aubépine c. l’administration intragastrique d’un extrait entraîne une diminution de la pression systolique et diastolique.
Cette action hypotensive provient à la fois d’une diminution des résistances vasculaires périphériques, de l’action antispasmodique (la catéchine, la vitexine, le kampférol ont une structure semblable à la papavérine et la théophylline) des dérivés flavonoïdes et procyanidiques et d’une action de type IEC pour certains auteurs.
Les études cliniques chez l’homme montrent également une activité hypotensive chez l’adulte légèrement hypertendu.
Vasodilatation périphérique
Elle est reliée à l’action d’hyperpolarisation membranaire et à l’inhibition de l’afflux passif de calcium ionisé au niveau de la musculature lisse vasculaire.
Antioxydant
In vitro des études montrent que la sommité fleurie d’Aubépine piège les radicaux libres et est antioxydante : un extrait standardisé et une fraction d’oligomères procyanidiques inhibent la peroxydation lipidique et l’activité de l’élastase neutrophile humaine. D’autre part, les flavonoïdes sont également connus pour leur importante activité antioxydante.
Anti-inflammatoire
L’Aubépine possède aussi des propriétés anti-inflammatoires en prévenant la synthèse et la sécrétion de précurseurs inflammatogènes tels que l’histamine, les protéases sériques, les prostaglandines, les leucotriènes.
3. Sphère neurologique
Action sédative
Un effet sédatif léger à modéré a été démontré pour l’Aubépine, chez l’homme comme chez l’animal, et la fraction OPC semble en être en partie responsable. Ces effets sédatifs ont été observés après administration intra-gastrique d’extraits de sommités fleuries : ces extraits accroissent la durée de sédation induite par l’hexobarbital et diminuent la mobilité spontanée et le comportement d’exploration chez la souris (pour une administration de 800 mg/kg de poids corporel).
Action neuroprotectrice
En 2004, Zhang et al. ont montré l’activité neuroprotectrice de la fraction flavonoïque de l’Aubépine par augmentation du niveau antioxydant cérébral et par protection du cerveau vis-à-vis de l’ischémie.
4. Sphère métabolique
Hypolipémiant
Une étude de Kanyonga (2011) montre, chez des rats supplémentés par unextrait d’Aubépine à la dose de 100 mg/kg pendant 12 semaines, une diminution des taux sanguins de cholestérol, triglycérides, glucose et du nombre des leucocytes ainsi que des plaquettes respectivement de 15,5, 22, 16,5, 35 et 32 %. Aucune modification des niveaux d’enzymes hépatiques n’a été observée chez les animaux traités. Parallèlement, on note une diminution significative du poids des rats traités comparativement au groupe témoin.
5. Autres propriétés
Activité antispasmodique digestive
Un extrait aqueux de fleurs d’Aubépine inhibe les contractions induites par le chlorure de baryum sur l’intestin isolé de lapin. In vitro, un extrait de sommité fleurie enrichi en flavonoïdes prévient les contractions induites par l’histamine et la nicotine sur l’intestin de lapin et inhibe partiellement les contractions induites par l’acétylcholine ou la sérotonine.
Une injection intraveineuse d’un extrait de sommité fleurie enrichi en flavonoïdes réduit les contractions des muscles lisses intestinaux chez le chat.
Action diurétique
Un extrait d’Aubépine enrichi en flavonoïdes montre une action diurétique chez le chien à la dose de 50 mg/kg de poids corporel.
C. Principales formes galéniques utilisées et posologies
1. Voie interne
Toutes les formes galéniques disponibles sont intéressantes. Notons cependant les retours thérapeutiques excellents de celles issues de la plante fraiche, et en particulier la SIPF (suspension intégrale de plantes fraîches).
Doses indicatives
Des formes liquides
Teinture mère : 30 à 50 gouttes, 2 à 3 fois/ jour, de préférence avant les repas.
Extrait fluide : 10 à 20 gouttes, 1 à 3 fois/jour.
Soluté intégral de plante fraiche : 1 cuillère à café matin et soir, à diluer dans de l’eau au moment du repas.
Extrait de plante standardisé : 1 cuillère à café, 1 à 2 fois/jour.
Jeunes pousses macérat glycériné 1D : 30 à 50 gouttes, 2 à 3 fois/jour.
Extrait fluide glycériné miellé : 1 à 3 cuillères à café/jour.
Infusion : 1 cuillère à café pour 150 ml.d’eau (une tasse), 3 à 4 fois/jour, sachant que 1 cuillère café pèse environ 1,8 g.
Des formes solides
Gélules d’extrait sec : dosées à 100 à 300 mg, 1 gélule 1 à 3 fois/jour.
Gélules de poudre micronisée : dosées de 100 à 300 mg, 1 gélule 3 fois/jour.
Comprimé d’extrait : dosé à 100 mg.
Microsphères :
– SD®: 1 dosette 1 à 2 fois/jour (équivalence : la dosette de 0,20 g équivaut à environ 100 gouttes de TM),
– LE® : 1 dosette 1 à 3 fois/jour (équivalence : la dosette de 0,20 g équivaut à environ 25 gouttes de TM).
2. Voie externe
- Cataplasme : avec les feuilles fraîches coupées menues ou écrasées avec un peu d’eau.
- Cataplasme : avec une décoction de 30 à 50 g/litre d’eau, 15 min d’ébullition, application 30 min.
- Gel neutre avec un extrait HAG (25 à 50 %) usage limité et peu fréquent.
D. Effets secondaires, contre- indications, toxicité
1. Pharmacologiquement
Effet secondaire
On ne connaît pas d’effet secondaire aux doses thérapeutiques. À des doses non adaptées, on a pu observer : dyspnée, maux de tête, nausées, fatigue, et paradoxalement des palpitations.
Toxicité
Aucune toxicité aiguë ou chronique n’est connue ; dans toutes les études cliniques, l’Aubépine se montre particulièrement sûre d’utilisation de par sa non-accumulation dans l’organisme :
- toxicité aiguë : chez le rat et la souris, on observe sédation, dyspnée et tremblements après une administration de3 g/kg (per os ou intrapéritonéal) ;
- toxicité chronique : aucune chez le rat et le chien après administration d’extrait sec (300 mg/kg) et de poudre micronisée (600 mg/kg).
2. Effets secondaires et contre-indications selon l’approche clinique intégrative
Contre-indications cliniques :
- bradycardies ;
- hypotension ;
- à très haute dose pourrait être bradycardisant, dépresseur du système nerveux centrale et entraîner un ralentissement respiratoire.
E. Précautions d’emploi
L’Aubépine peut potentialiser les dépresseurs du SNC.
Interaction : aucune interaction avec la digoxine n’a été relevée.
F. Propriétés cliniques issues d’une analyse physiologique intégrative
Tropisme principal :
- l’Aubépine est essentiellement active sur la sphère cardiovasculaire ;
- l’Aubépine exerce aussi son activité sur le système neurovégétatif.
Tropisme secondaire : digestif.
1. Au niveau symptomatique
Propriétés par voie interne
- Sphère cardiaque : bathmotrope négatif ; chronotrope négatif fort ; dromotrope négatif ; inotrope positif (tonicardiaque) ; coronaro-dilatateur.
- Sphère vasculaire : diminue les résistances périphériques ; hypotenseur et antihypertenseur ; vasodilatateur.
- Sphère nerveuse centrale : sédatif.
- Sphère digestive : spasmolytique neurotrope ; modérément hypocholestérolémiant et hypolipémiant ; stimulant de la sécrétion salivaire et biliaire.
2. Au niveau du drainage
- Légèrement diurétique.
- Augmente le flux salivaire et biliaire.
3. Au niveau de la régulation neuroendocrinienne
Sphère neurovégétative :
- alpha-sympatholytique puissant αΣ—;
- effet bêtabloquant β-
Sphère endocrinienne : pas d’action directe reconnue à ce jour.
G. Indications en phytothérapie clinique intégrative
En France, les Cahiers de l’Agence 1998 stipulent que la sommité fleurie d’Aubépine est «traditionnellement utilisée dans les troubles de l’éréthisme cardiaque de l’adulte (cœur sain), dans le traitement symptomatique des états neurotoniques des adultes et des enfants, notamment en cas de troubles mineurs du sommeil ».
La commission E préconise comme indication de l’Aubépine « la diminution de l’activité cardiaque dans l’insuffisance cardiaque de stade II ».
En phytothérapie clinique intégrative, le choix de la plante médicinale doit toujours répondre d’un raisonnement endobiogénique intégrant à la fois :
– la fonctionnalité endocrinienne de l’individu considéré dans son ensemble ;
– l’enchaînement dynamique des axes hormonaux dans leur chronologie et leur relativité respectives ;
– les raisons de la désadaptation de la réponse physiologique face aux nécessités métaboliques.
En phytothérapie clinique intégrative, les indications de l’Aubépine sont les suivantes :
1. Indications principales : sphère cardiovasculaire
- HTA.
- Tachycardie.
- Certains troubles du rythme, de la simple palpitation au flutter auriculaire.
- Éréthisme cardiaque.
- Angor, notamment chez le sujet anxieux et neurotonique, et/ou hypertendu avec troubles lipidiques.
- En complément dans les suites d’infarctus des mêmes sujets.
2. Indications secondaires
- Spasmes digestifs, certaines colites spasmodiques notamment des sujets neurotoniques.
- Hypertonicité sphinctérienne : cardia, pylore, Oddi.
- Insomnie, cauchemars.
- Irritabilité, nervosité, comportement dit « sanguin ».
- Réactivité neurovégétative (vasomotrice) des bouffées de chaleur.
- Spasmes utérins.
- Spasmes oculaires.
- Spasmes vésicales.
3. Rappel : contre-indications cliniques
- Bradycardies.
- Hypotension.
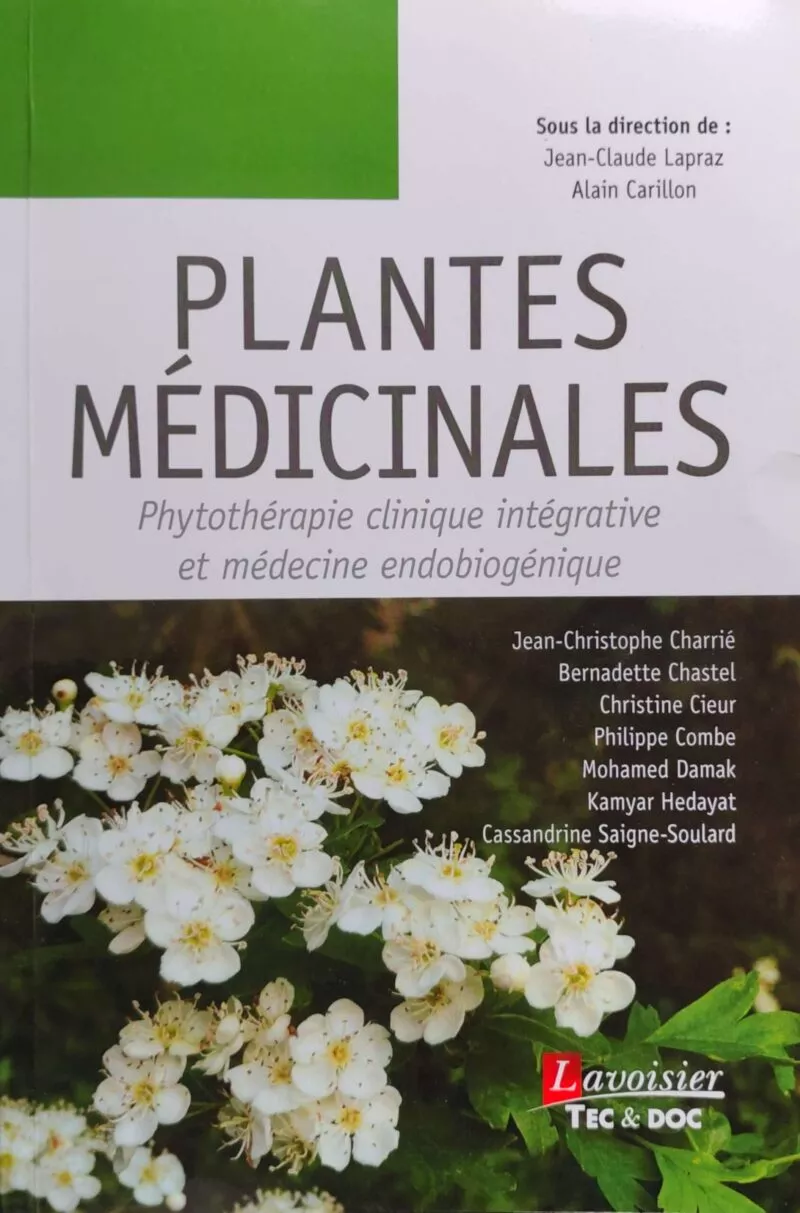
Pour en savoir +
Pour accéder à des informations plus détaillées et aux références bibliographiques qui permettent d’étayer les éléments présentées dans cet article, consultez le livre « Plantes médicinales », édité par Lavoisier TEC&DOC.
Plusieurs formateurs de l’Institut d’endobiogénie ont contribué à sa rédaction.



