- Guide des plantes
Thym (Thymus vulgaris) : propriétés et bienfaits
Le Thym : une plante médicinale majeure, connue pour ses propriétés anti-infectieuses, antioxydantes et régulatrices. C'est un allié précieux pour soutenir l’immunité, la sphère respiratoire et digestive, ainsi que l’équilibre général de l’organisme.

Ce qu’il faut retenir…
Dans le cadre d’une phytothérapie clinique intégrée dans une réflexion endobiogénique, le Thym se présente comme une plante prioritairement active :
– au niveau pharmacologique direct : sur les sphères immunitaire, digestive et cardiaque ;
– au niveau drainage : hépatobiliaire, pulmonaire et rénal ;
– au niveau neurovégétatif : puissant vagolytique ;
– au niveau endocrinien : sur l’axe corticotrope, en secondaire sur l’axe gonadotrope.
A. Usage traditionnel du thym
Employé depuis l’Antiquité comme aromate, embaumement et remède, le thym est cité par de nombreux médecins anciens (Hippocrate, Dioscoride, Galien, Pline).
- Vertus anciennes : digestif, expectorant, vermifuge, stimulant urinaire, gynécologique et pulmonaire. Utilisé contre la goutte, les coliques, les douleurs articulaires, la lèpre, les paralysies et même les troubles visuels. Sainte Hildegarde et les moines bénédictins ont largement contribué à sa diffusion au Moyen Âge.
- Usages populaires : stimulant digestif, antitussif et emménagogue (favorise les règles).
- Époque moderne : dès le XVIIe siècle, ses propriétés sont décrites comme incisives, apéritives et fortifiantes (digestion, appétit, asthme, venin). Au XIXe siècle, on souligne ses effets sur la circulation, le tonus et le moral. Il est recommandé contre la coqueluche, les maladies infectieuses respiratoires, intestinales et urinaires.
- Huile essentielle : identifiée au XVIIIe siècle (thymol), elle démontre une action antiseptique puissante sur de nombreux germes (charbon, typhoïde, diphtérie, tuberculose).
- Usages locaux : bains fortifiants (soldats romains, enfants, personnes affaiblies), compresses, lotions, inhalations, fumigations. Utilisé contre les douleurs rhumatismales, les contusions, les infections et les maux dentaires (Louis XIV).
B. Données expérimentales et cliniques issues directement de la pharmacologie
1. Sphère immunitaire
Propriétés anti-infectieuses
Le Thym est une plante anti-infectieuse majeure, que ce soit sous forme d’extraits ou d’huile essentielle. Pour celle-ci, tous les chémotypes sont actifs, mais l’activité bactéricide est plus marquée pour tes types à thymol ou carvacrol. Rappelons que le coefficient phénolique qui exprime l’activité antimicrobienne, comparativement au phénol de référence (phénol= 1), s’élève pour l’huile essentielle de Thym à 13,2 et à 20 pour le thymol.
Activité antibactérienne
vitro, de très nombreuses études ont permis d’évaluer la puissance antibactérienne du Thym. Pour exemples :
– un extrait aqueux de Thym inhibe de manière dose-dépendante la croissance d’Helicobacter pylori. Elle atteint 100 % à la dose de 3,5 mg/mL. Dans une autre étude, un extrait aqueux de Thym entrave l’adhésion de Streptococcus mutons sur des cellules épithéliales buccales humaines, également dose-dépendant ;
– un extrait fluide (67 % d’alcool, contenant 0,072 % de thymol et 0,005 % de carvacrol) est actif contre les bactéries à tropisme pulmonaire Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae et Diplococcus pneumoniae. D’autre part, un extrait acétonique (0,5 mg/ mL) inhibe la croissance de Mycobacterium tuberculosis, que la souche soit sensible ou antibiorésistante. Beaucoup plus récemment, deux extraits aqueux de Thymus vulgaris (méthanolique et éthanolique) ont été testés actifs (par comparaison avec la nitrofurantoïne) contre Staphylococcus aureus et epidermidis, Bacillus subtilis, Geobacillus stearothermophilis, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris et mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, Bordetella bronchiseptica, mais inactifs vis-à-vis d’Escherichia coli ;
— mais c’est surtout l’huile essentielle qui donne les résultats les plus performants. Elle s’avère fortement antibactérienne sur bon nombre de Gram+ et Gram-. Tout d’abord, comparée à d’autres HE (Giroflier, Origan, Poivre noir, Géranium, Muscade), l’HE de Thym a présenté le plus large spectre d’action et la plus forte activité inhibitrice dans une autre étude comparant cinquante HE entre elles. Par exemple, la CMI mesurée était de 0,03 % V/V contre Staphylococcus aureus et E. coli.
Beaucoup d’autres études corroborent ces résultats avec extension sur d’autres germes comme Bacillus megatherium, Legionella pneumo-philo, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, Enterococcus faecalis.
L’huile essentielle de Thym est également active sur Staphylococcus aureus méthicilline-résistant (CMI de 18,50 µg/mL) ainsi que sur d’autres bactéries multi-résistantes provenant de patients hospitalisés. Même les inhalations de l’huile essentielle (3-12 mg/L d’air) sont hautement effectives contre les germes pathogènes des voies respiratoires.
L’activité antimicrobienne de l’HE de Thymus vulgaris est principalement corrélée à la présence des composés phénoliques (thymol, carvacrol) et secondairement aux monoterpénols (linalol, α-terpinéol, thuyanol) et monoterpènes (γ-terpinène et p-cymène). Mais d’autres données sont à considérer, En effet, le p-cymène (troisième composant majeur) n’est pas efficace Lorsqu’il est employé seul, ce qui suggère un effet synergique entre les différents composants. De plus, un grand nombre d’études démontrent que l’activité de l’huile essentielle manifeste une activité anti microbienne bien supérieure que celle enregistrée par ses composants majoritaires isolés ou mélangés. Ceci démontre clairement, d’une part, l’effet synergique des composés mineurs sur l’action thérapeutique et, d’autre part, l’importance de « l’effet totum » de l’ensemble des composés en relation avec l’activité biologique de l’huile essentielle.
Le principal mode d’action antibactérien proposé repose sur l’effet direct des phénols (thymol, carvacrol) par déstructuration membranaire des germes. Cependant, en plus de ces propriétés bactéricides, l’HE de Thym possède un remarquable potentiel d’inhibition de la formation de biofilm par les bactéries en empêchant, de plus, leur adhésion.
Activité antifongique
In vitro, l’huile essentielle de Thym exerce une activité antifongique remarquable à l’encontre de plusieurs espèces incluant Candida albicans, Aspergillus sp., Penicillium sp. ainsi que des dermatophytes (Trichophyton, Microsporum et Epidermophyton sp.).
Là encore, cette activité est la plupart du temps attribuée aux composés phénoliques, thymol et carvacrol. Le thymol interfère sur la formation et la viabilité des hyphes (filaments dont le réseau constitue le mycélium) en induisant une altération de l’enveloppe de C. albicans.
Sur Aspergillus flavus et piger, essentielle de Thym inhibe la croissance du mycélium et à concentration ≤ 500 ppm inhibe complètement de manière dose-dépendante la croissance fongique et la production de mycotoxine par Aspergillus favus, A. parasiticus, A. ochraceus et Fusarium moniliforme. Une autre étude a mis en évidence que l’huile essentielle testée à une concentration inférieure à sa concentration minimale inhibitrice (CMI) stimule de façon significative l’activité tueuse des granulocytes humains vis-à-vis du Candida albicans de manière comparable au témoin positif, le fluconazole (CMI 8 µg/mL). En revanche, sans la présence des polynucléaires, une croissance progressive de la levure est observée.
In vivo, une solution diluée à 1 % d’huile essentielle de Thym a été testée Localement contre Trichophyton mentagrophytes, T. rubrum et T. tonsurons chez le rat Wistar. La guérison intervient au bout de 37 jours d’observation. De plus, dans un autre test, les auteurs indiquent que le potentiel antifongique de l’HE est supérieur à celui du bifonazole.
D’autre part, le contact des vapeurs de l’huile essentielle de Thym permet d’agir sur le pied d’athlète induit chez le cobaye avec Trichophyton mentagrophytes. L’huile essentielle élimine les conidies (spores), inhibe leur germination et la formation des hyphes à une concentration de 1-4 µg/mL d’air.
Activité antivirale
In vitro, plusieurs études rendent compte de l’effet hautement virucide dose-dépendant du Thym, en particulier vis-à-vis d’Herpes simplex de type et 2 (HSV-1, HSV-2) (tests sur cellules RC-37). Un extrait aqueux développe même son activité inhibitrice sur une souche aciclovir-résistante de HSV-1 [HSV-1 (ACV-res)]. Afin d’identifier le mode d’action, l’extrait a été ajouté aux cellules ou aux virus à différents stades de l’infection. En pré-incubation avant l’infection, l’extrait permet une neutralisation efficace de HSV-1, HSV-2 et HSV-1 (ACVres) : réduction de plus de 90 % pour HSV-1 et HSV-2 et de plus de 85 % pour la souche ACV-res. Les résultats indiquent que l’extrait affecte le virus avant l’adsorption mais qu’il n’a aucun effet sur la réplication intracellulaire du virus. Les auteurs concluent que le Thym sera utile en application topique contre les infections récurrentes à herpès. L’évaluation de l’huile essentielle de Thymus vulgaris conduit à des résultats similaires. La CI50 est de 0,007 % contre HSV-2. Aucun effet inhibiteur n’est observé lorsque l’HE est ajoutée avant l’infection ou après la période d’adsorption. L’huile essentielle affecte le virus avant la phase d’adsorption, probablement par interaction avec l’enveloppe virale. D’autre part, là encore, L’huile essentielle est déclarée plus efficace et moins cytotoxique comparativement aux composants isolés de celle-ci.
Autres effets
Anti-parasitaire : in vitro, L’huile essentielle de Thym en solution 1 : 2000 provoque l’éradication des vers intestinaux (oxyures). Le thymol est en effet connu depuis longtemps pour son activité anthelminthique à la dose de 1 à 3 g, pris pendant 3 jours consécutifs.
L’huile essentielle est effective contre Trypanosoma cruzi, l’activité étant imputée au thymol. De plus, in vitro, l’huile essentielle inhibe le développement des formes sanguines de Trypanosoma brucei. Enfin, un extrait alcoolique (90 % d’éthanol) et l’huile essentielle de Thym montrent une activité amiboïde contre Entamoeba histolytica pour des CMI respectives de 4 mg/mL et 0,7 mg/mL.
Répellent : thymol et carvacrol sont des répulsifs vis-à-vis des insectes à la dose de 0,05 %, en traitement topique.
Propriétés antioxydantes
In vitro
Les propriétés antioxydantes du Thym ont été mises en évidence dans de nombreuses études lors de tests très variés (méthode FRAP ou ferric ion reducing antioxidant parameter, méthode utilisant le radical libre DPPH, diphényl-picrylhydrazyle, etc.) et décrites aussi bien pour des extraits hydro-alcooliques de feuilles de Thym que pour l’huile essentielle.
L’activité des extraits est corrélée à plusieurs composants, en particulier rosmarinique, mais aussi aux flavonoïdes (ériodictyol, taxifoline et lutéoline) et composés biphényliques tandis que celle de l’huile essentielle dépend des phénols (thymol et carvacrol).
Par exemple, l’huile essentielle de Thym inhibe de manière dose-dépendante (250 à 1000 ppm) l’auto-oxydation de l’huile végétale d’Onagre avec une efficacité supérieure à celle de l’a-tocophérol et de l’ascorbyl-palmitate. L’extrait aqueux de Thym piège le radical DPPH plus fortement que les feuilles d’Olivier ou de Sauge mais il est cependant moins performant que le thé vert. Parallèlement, dans un modèle d’hépatotoxicité induit par CCI4, l’huile essentielle de Thymus zygis montre une activité antioxydante notable couplée à un piégeage marqué de radicaux libres. Ainsi, la concentration en malone-dialdéhyde, témoin de la lipoperoxydation, est nettement réduite.
In vivo
Chez le rat, l’administration au long cours d’huile essentielle de Thym s’oppose à la perte de pouvoir antioxydant lié au vieillissement. Ainsi, l’huile essentielle ou le thymol (42,5 mg/kg/jour administré durant 1 mois) retarde les modifications des acides gras totaux liées au vieillissement. En particulier, les taux d’acides gras polyinsaturés sont maintenus dans les fractions phospholipidiques des tissus du foie, cerveau, reins et cœur. On observe en outre, une amélioration respective de l’activité de la superoxyde dismutase (SOD) au niveau hépatique et cardiaque et de celle de la glutathion peroxydase au niveau du foie, reins et cerveau. Enfin, le thymol employé seul n’est pas plus actif que l’huile essentielle dans sa globalité.
D’autre part, l’huile essentielle de Thym développe un potentiel antioxydant protecteur vis-à-vis des Lipoprotéines de basse densité ; cet effet est également assigné aux composés phénoliques, thymol et carvacrol.
Propriétés anti-inflammatoires
In vitro
Plusieurs modèles attestent de l’activité anti-inflammatoire du Thym.
La formation des médiateurs pro-inflammatoires (PGE2) au sein d’une lignée cellulaire de monocyte/macrophage MM6 est supprimée par un extrait fluide de Thym (67 % d’éthanol et contenant 0,072 % de thymol et 0,005 % de carvacrol) avec une CI50 de 0,1 µg/mL, comparativement à 100 µg/mL pour l’acide acétylsalicylique et 0,004 µg/mL pour l’indométacine.
Thymol et carvacrol (à la dose de 37 µM) inhibent la cyclooxygénase et la biosynthèse des prostaglandines (test sur glandes séminales de mouton) respectivement de 87,5 % et 94 %.
Le thymol inhibe de manière dose-dépendante la libération de l’élastase des polynucléaires neutrophiles et les auteurs en concluent sa participation dans le contrôle du processus inflammatoire généré au cours des infections.
Des études beaucoup plus récentes confirment ces résultats. Des extraits de Thym (5-25µg/ mL), obtenus par CO2 supercritique, ont été testés sur des modèles inflammatoires utilisant des macrophages humains ; on observe une réduction significative à la fois de la production et de l’expression génique des médiateurs pro-inflammatoires (TNFα, IL-1β et IL-6) et une augmentation parallèle du versant anti-inflammatoire par le biais des IL-10.
L’acide rosmarinique, en tant que composé isolé, manifeste également, mais à forte dose, un effet anti-inflammatoire via l’inhibition de la voie classique du complément qui a été confirmée in vivo.
In vivo
Chez le rat, l’administration orale d’un extrait fluide de Thym (67 % d’éthanol et contenant 0,072 % de thymol et 0,005 % de carvacrol) à la dose de 162 mg/kg réduit significativement l’œdème de la patte induit par carraghénates, avec un effet comparable à celui de la phénylbutazone lors des 3 premières heures du test.
Chez la souris albinos Balb/c, l’apport de 5000 ppm d’HE de Thym dans l’alimentation entraine une diminution des signes inflammatoires selon les modèles utilisés : réduction de la colite induite par TNBS (acide trinitrobenzène sulfonique) objectivée à la fois au niveau macroscopique et microscopique, diminution de l’œdème induit de la patte ainsi que celui de l’oreille.
Propriétés antiprolifératives
In vitro, un extrait de Thym inhibe la prolifération de lymphocytes stimulés par mitogène. Le thymol en serait responsable. Un extrait aqueux montre également (jusqu’à 50 µg/mL) des effets immuno-inhibiteurs sur la prolifération des cellules T.
Ces propriétés sont évidemment en lien avec l’activité anti-inflammatoire décrite précédemment. Par exemple, thymol et carvacrol contribuent à la réduction des réponses inflammatoires grâce à la modulation de l’expression des protéines STAT-3 (signal transducer and activator of transcription 3) impliquées dans la transformation et la croissance cellulaire ainsi qu’une diminution de l’expression de certaines NFAT (nuclear factory activated T-cells), facteurs de transcription impliqués dans la réponse immunitaire, en particulier NFAT-1 et NFAT-2, pro-invasifs. D’autre part, le thymol inhibe la réponse inflammatoire induite par LPS (lipopolysaccharide) dans les cellules épithéliales mammaires de souris ; il inhibe nettement le TNFα et l’IL-6, supprime l’expression de la cyclooxygénase-2 (COX-2) et celle de l’oxyde nitrique synthase inductible (iNOS) et interfère sur l’activation des voies de signalisation NF-κB et MAPK (mitogen activated protein kinase qui, rappelons-le, joue un rôle important dans la régulation de la prolifération, de la survie, de la différenciation, de la migration cellulaire ainsi que de l’angiogenèse). Le carvacrol (à partir d’une concentration de 0,05 mmol/L), en tant que composé isolé, induit l’apoptose dans les cellules HepG2 (cellules humaines de carcinome hépatique) par action directe sur la voie de signalisation mitochondriale.
Enfin, l’acide rosmarinique, dès 200 µM de concentration, développe un fort potentiel anti-angiogénique qui serait en relation avec ses activités antioxydantes, en particulier dues à l’inhibition des espèces réactives de l’oxygène, associée à celle de l’expression du VEGF (facteur de croissance de l’endothélium vasculaire).
2. Activité spasmolytique
Les propriétés spasmolytiques du Thym ont été largement démontrées in vitro. Un extrait fluide (67 %d’éthanol, contenant 0,072 % de thymol et 0,005 % de carvacrol), l’huile essentielle ainsi que le thymol et le carvacrol s’opposent de manière dose-dépendante aux spasmes de l’iléon et de la trachée isolés de cobaye ou de rat, après induction par différents réactifs (BaCl2, carbacol, noradrénaline, acétylcholine, histamine, prostaglandines PGF2α,endothéline).
Cette activité est généralement attribuée aux phénols (thymol, carvacrol) mais leur concentration dans les préparations aqueuses est insuffisante pour justifier à elle seule de cet effet. Les auteurs ont montré que les flavonoïdes et en particulier la lutéoline et les polyméthoxyflavones en sont également responsables. Ainsi, un extrait aqueux de Thym (préparé à partir de 50 g de plante dans 300 mL d’eau, avec une concentration finale de 10 %), testé sur la trachée isolée de cobaye, manifeste un effet spasmolytique comparable à celui de la théophylline.
Concernant tes mécanismes d’action, les flavones sont considérées comme des antagonistes non spécifiques vis-à-vis des agonistes spécifiques (acétylcholine, histamine, noradrénaline) et des agonistes aspécifiques (chlorure de baryum). Une interaction sur les mouvements du calcium est aussi suggérée. De plus, contrairement aux flavones qui ne stimulent pas les récepteurs β-adrénergiques, le thymol agit, in vitro, en agoniste sur les récepteurs α1-, α2- et β-adrénergiques.
3. Autres propriétés
Sphère digestive Stimulant digestif
En raison de sa saveur aromatique, le Thym stimule les cellules sensorielles réceptrices olfactives et gustatives et déclenche en retour une stimulation réflexe physiologique des sécrétions salivaires, gastriques et biliaires. Ceci garantit un effet eupeptique grâce à une meilleure dégradation des aliments ainsi qu’une stimulation de l’appétit.
Activité hépatoprotectrice
Cet effet est directement corrélé aux propriétés antioxydantes évoquées ci-dessus. Plusieurs expérimentations ont été effectuées in vivo :
– chez la souris, l’apport de Thym dans l’alimentation (jusqu’à 2 %) ou de thymol et carvacrol (200 mg/kg) réalisé durant 1 à 7 jours induit une stimulation de l’activité des enzymes hépatiques de phase 1 et 2, pouvant atteindre90 %. Un extrait aqueux (30 g de Thym macéré dans 60 mL d’eau) administré à raison de 500 mg/kg/PC pendant 14 jours est capable de modérer l’augmentation des transaminases due à l’abus d’alcool ;
– chez le rat, un extrait aqueux de Thym (500 mg/ kg/PC) a été évalué sur la toxicité hépatique et rénale du paracétamol ; les auteurs ont observé une nette amélioration aussi bien du profil enzymatique hépatique qu’histologique sur les deux organes.
Sphère pulmonaire
Élimination pulmonaire des composés volatils
Après administration orale de comprimés ou capsules contenant un extrait de Thym (70 % éthanol, 6-10 : 1) chez des individus en bonne santé, les premières traces de thymol sont détectées dans l’air expiré après respectivement 30 et 60 minutes. Après 140 minutes, le thymol n’était plus détectable. Cette élimination pulmonaire permet à l’huile essentielle d’agir à la fois localement et d’une manière systémique, ce qui est particulièrement intéressant avec le Thym qui possède un fort tropisme pulmonaire.
Propriétés expectorantes
Ces propriétés sont en tien avec l’activité spasmolytique décrite ci-dessus.
Les études rapportant l’activité sécrétomotrice du Thym datent des années 1930. Extraits de Thym et thymol développent des propriétés sécréta-motrices et mucolytiques. Une stimulation du mouvement ciliaire de la muqueuse pharyngée est observée chez la grenouille traitée avec des solutions diluées d’huile essentielle, de thymol ou de carvacrol. Chez le chat, une administration sous-cutanée d’un extrait fluide de Thym stimule le mouvement ciliaire en induisant une hypersécrétion des voies respiratoires supérieures. Far ailleurs, une étude clinique réalisée en double aveugle chez des personnes se plaignant de toux productive a permis d’établir qu’un sirop à base de Thym était aussi efficace qu’une préparation à base de bromhexine. Dans une autre étude clinique multicentrique, 154 enfants âgés de 2 mois à 14 ans atteints de bronchite étaient traités avec un sirop de Thym (contenant 97,6 mg d’extrait fluide par ml) pendant 7-14 jours, tandis que 45 patients ne recevaient aucune médication. Dans le groupe traité par le Thym, une amélioration des symptômes a été rapportée chez 93,5 % des enfants.
Propriétés décongestionnantes
Une étude clinique réalisée en double aveugle contre placebo sur 64 patients souffrant de rhino-sinusite chronique et subissant une chirurgie endonasale par voie endoscopique a montré, dans le groupe traité avec un spray nasal au Thym et miel (durant 2 mois), une incidence positive sur l’épistaxis, la formation de synéchies avec réduction de l’inflammation et une guérison plus rapide. Et tout cela pour un prix modique !
Activité stimulante
Sur le plan général
L’effet stimulant du Thym a été objectivé par le test de la nage forcée réalisé sur la souris. L’inhalation d’huile essentielle de Thym permet de réduire de 22,87 % l’immobilité de l’animal. Les résultats sont similaires à ceux obtenus avec la caféine administrée par voie intra-péritonéale.
Sur le plan cardiovasculaire
Les études ne sont pas toutes concordantes. Il est clair que suivant la nature et la dose des extraits testés d’une part, et de la voie d’administration employée d’autre part, les résultats peuvent être contradictoires. Par exemple, in vivo, chez le rat, le thymol employé seul (1-10 mg/kg/PC) induit une inhibition calcique avec diminution de la tension artérielle. Des résultats similaires sont obtenus, in vitro, sur cardiomyocytes canins ou humains.
Par ailleurs, une augmentation du rythme cardiaque et des contractions est observée chez le lapin avec l’huile essentielle.
Enfin, une décoction de Thym, administrée oralement (100 mg/kg) durant 8 semaines à des rats rendus hypertendus permet de retrouver une valeur tensionnelle proche de la valeur initiale accompagné d’un effet préventif des dommages rénaux.
Sphère cérébrale
Activité analgésique
Un extrait sec méthanolique à 28 % administré par voie intra-péritonéale manifeste un effet analgésique dose-dépendant (100-1000 mg/kg). Ceci serait peut-être à rapprocher de la capacité du thymol à interférer comme modulateur allostérique sur les récepteurs GABA(A).
Inhibition de l’acétylcholinestérase
Les huiles essentielles de Thymus vulgaris et zygis exercent une inhibition de l’acétylcholinestérase avec une CI50 = 1,1 µg/mL. Carvacrol, thymol et linalol sont, par ordre décroissant, les composés les plus actifs.
Liaison aux récepteurs à œstrogènes et progestérone
In vitro, un extrait hydro-alcoolique de Thym (50 % d’éthanol) exhibe une faible capacité de liaison aux récepteurs à la fois aux œstrogènes (équivalent à 2 µg d’œstradiol pour 2 g de Thym) et à la progestérone (équivalent à 4 µg de progestérone pour 2 g de Thym). Ces résultats préliminaires appellent d’autres investigations, mais apportent du crédit à l’usage traditionnel du Thym comme influant le cycle menstruel.
C. Principales formes galéniques utilisées et posologies
1. Voie interne
Doses indicatives des formes liquides
- Huile essentielle : elle constitue la forme galénique principale. Les doses recommandées en phytothérapie clinique intégrative sont généralement inférieures à celles préconisées ailleurs. L’HE de Thym sera incorporée au sein d’une solution buvable de manière à obtenir une dose journalière (toutes huiles essentielles confondues) comprise entre 25 et 100 mg/ jour et jusqu’à 300 mg/jour, en aigu. Ainsi, l’importance du chémotype devient moins préoccupante, même si, en ce qui concerne les prescriptions pédiatriques, on pourra préférer tes huiles essentielles chémotypées à linalol ou à thuyanol, moins agressives. Sur le plan pharmacocinétique, une étude faite sur 12 volontaires montre que les métabolites du thymol (sulfate et glucuronide) sont présents dans l’urine mais que seule la forme sulfate est détectée dans le plasma. Le pic plasmatique est obtenu après 2 heures ± 0,8 heure, la demi-vie d’élimination étant de 10,2 heures et la quantité des deux métabolites excrétée en 24 heures dans tes urines s’élevant à 16 % de la dose.
- Teinture mère réalisée à partir de la plante fraiche : 30 à 50 gouttes de 1 à 3 fois/jour, de préférence avant les repas.
- Extrait fluide : 40 à 80 gouttes, 1 à 3 fois/jour.
- Extrait fluide glycériné miellé : 1 cuillère à café dans un grand verre d’eau, 3 fois/jour.
- Tisane : le Thym est une plante puissante qui donne très vite une infusion amère, d’autant qu’une fois séché il a la particularité de très bien se conserver (suivant les conditions) sans perte sensible de l’huile essentielle ; ainsi, 15 mois après récolte, cette perte n’atteint que 0,075 mL/100 g. Dose indicative : 1/2 cuillerée à café de drogue par tasse, soit environ 150 mL d’eau bouillante en infusion de 10 minutes ; boire 2 à 4 tasses/jour.
Doses indicatives des formes solides
- Gélules d’extrait sec dosées de 100 à 200 mg : 2 à 3 gélules/jour. Il faudra s’assurer que l’extraction s’est faite à froid, de manière à garantir la présence des composés aromatiques volatils.
- Gélules de poudre de plante dosées de 200 à 300 mg : 2 à 3 gélules/jour.
- Gélules d’huile essentielle : 25 à 100 mg/ jour et jusqu’à 300 mg/jour dans tes pathologies aiguës.
- Suppositoires : dosage et posologie variables suivant le patient (adulte ou enfant). Pour l’enfant, le choix d’une huile essentielle chémotypée linalol ou thuyanol peut s’avérer très utile compte tenu de la dermocausticité de l’huile essentielle de Thym CT thymol.
2. Voie externe
- Huile essentielle :
- voie topique : l’huile essentielle sera toujours diluée (huile végétale, gel, pommade) avec une concentration maximale variable suivant le chémotype choisi : 5 % pour Thymus vulgaris CT thymol qui manifeste une certaine dermocausticité, et jusqu’à 10 % pour les autres chémotypes (linalol, thuyanol). De plus, pour une application sur les muqueuses, on se limitera à une concentration de 1 % ;
- bain : 20 à 30 gouttes d’huiles essentielles (toutes confondues) diluées au préalable dans une base pour bain avant dispersion dans l’eau de la baignoire. Durée du bain : 10 à 20 minutes ;
- inhalation : pour les mêmes raisons, l’inhalation sera faite de préférence avec les HE de Thym à monoterpénols (CT linalol ou CT thuya-flot).
- Huile végétale de Thym : obtenue par macération dans une huile douce (Arachide, par exemple), elle peut être utilisée pure ou comme solution de transport.
- Eau florale de Thym : sous-produit de la distillation de l’HE de Thym, elle est utilisée pour les soins des peaux grasses.
• Infusion de Thym :
- pour compresses ou bain de bouche, gargarismes : 10 g de plante pour 250 mL d’eau bouillante en infusion de 10 à 15 minutes ;
- pour poire vaginale ou lotion, pour traiter les muqueuses génitale ou anale devant une infection bactérienne ou fongique : 10 g de plante pour 250 mL d’eau bouillante en infusion de 10 à 15 minutes. Laissez refroidir avant usage, à utiliser dans les 24 heures ;
- bain : 200 à 500 g de plante à faire infuser dans 4 titres d’eau bouillante avant d’être ajoutés à l’eau du bain. Durée du bain :10 à 20 minutes.
D. Effets secondaires, contre-indications, toxicité
1. Pharmacologiquement
Toxicité
Toxicité aiguë
Dans les conditions normales d’utilisation en phytothérapie clinique, le Thym ne présente aucune toxicité. Par voie orale ou cutané, le risque toxique de l’huile essentielle est qualifié de faible à modéré. Rappelons toutefois qu’aucune toxicité ni aiguë, ni chronique n’est rapportée pour l’huile essentielle lorsque celle-ci est utilisée aux doses maximales thérapeutiques. Par voie orale, cette HE bénéficie, par la Food and Agriculture Organisation (FAO) aux États-Unis, du statut GRAS (generally recognized as safe).
La toxicité potentielle de l’HE est essentiellement due à la présence des phénols (thymol et carvacrol). Mais il faut bien distinguer la toxicité de l’huile essentielle dans sa globalité de celte de ces composés pris isolément.
Suivant les auteurs, la DL50 de l’huile essentielle de Thymus vulgaris CT thymol est comprise entre 2,84 g/kg/PC et 4,7 g/kg/PC, per os, chez le rat et est supérieure à 5 g/kg/PC par voie cutanée. Comparativement, la DL50 du thymol varie de 0,9 g/kg à 1,8 g/kg suivant l’espèce de rongeur considérée. Celle du carvacrol oscille entre 0,1 g/ kg à 0,8 g/kg.
Ingérés à la dose de 2 g, l’huile essentielle ou le thymol sont susceptibles de provoquer une gastralgie accompagnée de nausées. Au-delà, surviennent migraine, étourdissements, convulsions, arrêt respiratoire ou cardiaque.
Toxicité subaiguë
Chez la souris, l’absorption durant 3 mois de fortes doses d’extraits des parties aériennes de Thym – équivalentes à 0,900 g de drogue par animal – induit une stéatose hépatique et entraîne la mort de 30 % des animaux mâles contre 10 % des animaux femelles.
Une étude plus ancienne a montré qu’il n’y a pas d’effets toxiques observés chez le rat après avoir ajouté 1 % de thymol dans son alimentation durant 19 semaines. D’autre part, des rats soumis, sur une même période de 19 semaines, à l’administration de thymol dans leur alimentation, tolèrent celui-ci à ta dose de 10 000 ppm (équivalent à environ 667 mg/ kg/PC), sans montrer d’effets nocifs.
Génotoxicité
L’huile essentielle de Thymus vulgaris est classée parmi celles à génotoxicité négative. Thymol et carvacrol présents à des concentrations biologiquement pertinentes sont également dénués d’activité clastogène.
2. Effets secondaires et contre-indications selon l’approche clinique intégrative
Effets secondaires
De rares cas d’hypersensibilité à ta plante ont été rapportés et des sensibilités croisées avec d’autres Lamiacées ne sont pas à exclure.
L’huile essentielle de Thymus vulgaris CT thymol appliquée sur ta peau à une concentration supérieure à 8 % peut irriter la peau, et en particulier les muqueuses. Pour celles-ci, la recommandation impose de ne pas dépasser 1 %.
Possibilité de déclencher une crise d’asthme après inhalation de l’HE de Thym CT thymol.
Contre-indications
Aucune contre-indication connue. Toutefois, la prudence s’impose, en particulier pour l’huile essentielle, pendant la grossesse, l’allaitement et chez les jeunes enfants.
Contre-indications cliniques :
- hypertension artérielle ;
- glaucome ;
- toutes les pathologies et déséquilibres endobiogéniques pouvant être aggravés par une vagolyse ;
- relatives : adénome prostatique et toutes les pathologies hyposécrétantes.
E. Précautions d’emploi
On utilisera avec prudence l’huile essentielle pendant la grossesse, l’allaitement et chez les jeunes enfants.
Interactions : aucune n’est connue. Cependant, il faudra tenir compte des effets synergiques ou antagonistes des plantes associées : ces interactions sont essentiellement d’ordre neurovégétatif. Toutefois, utiliser le Thym avec une autre plante à effet vagomimétique, par exemple, ne serait pas une erreur fondamentale si le prescripteur le fait en connaissance et pour utiliser les autres propriétés de ces deux plantes dans un but synergique en acceptant une action neutre ou modérée de l’effet neurovégétatif.
F. Propriétés cliniques issues d’une analyse physiologique intégrative
Tropisme principal : endocrinien et neurovégétatif (axe corticotrope et vagolytique) ; immunitaire ; gastro-intestinal.
Tropisme secondaire : cardiovasculaire ; pulmonaire ; rénal ; cutanéo-muqueux.
1. Au niveau symptomatique
Propriétés par voie interne
Sphère immunitaire : le Thym est un anti-infectieux à tropisme général (ORL, pulmonaire, gastro-intestinal, génito-urinaire, cutanéo-muqueux) :
- antibactérien ;
- antiviral (anti-herpétique) ;
- antifongique ;
- antiparasitaire (anthelminthique) ;
- immunostimulant ;
- antioxydant ;
- anti-inflammatoire ;
- fébrifuge.
Sphère digestive :
- eupeptique : augmentation des sécrétions salivaires et gastriques par action réflexe locale (amertume), mais diminution par la vagolyse induite (enfonction de l’état endobiogénique) ;
- carminatif ;
- anti-gastritique ;
- spasmolytique neurotrope digestif ;
hépatoprotecteur.
Sphère pulmonaire : spasmolytique.
Stimulant général, tonicardiaque : chrono-trope+, inotrope+.
Sphère ostéo-articulaire : modérément antirhumatismal, utile dans tes rhumatismes fébriles.
Par voie externe
- Astringent, cicatrisant.
- Analgésique, anti-inflammatoire.
- Antiseptique.
2. Au niveau du drainage
Sphère hépatobiliaire cholérétique.
Sphère pulmonaire :
- mucolytique ;
- expectorant.
Sphère rénale : diurétique volumétrique.
Sphère génitale : emménagogue, moins puissant que l’Estragon.
3. Au niveau de la régulation neuroendocrinienne
Propriétés neurovégétatives : parasympatholytique PΣ- puissant.
Propriétés endocriniennes :
- axe corticotrope : stimulant de la corticosurrénale ;
- axe gonadotrope : anti-gonadotrope relatif :
- acide caféique et rosmarinique -> acide lithospermique,
- liaison récepteurs œstrogène et progestérone.
G. Indications en phytothérapie clinique intégrative
En France, la Note explicative de l’Agence du médicament (1998) admet en revendication d’emploi pour lafeuille et la sommité fleurie du Thym les indications thérapeutiques suivantes, par voie orale : traditionnellement utilisé :
- 1° dans le traitement symptomatique de troubles digestifs tels que : ballonnement épigastrique, lenteur à la digestion, éructations, flatulence ;
- 2° dans le traitement symptomatique de la toux.
En usage local, quatre indications sont retenues : traitement des petites plaies après lavage abondant (à l’eau et au savon) et élimination des souillures ; en cas de nez bouché, de rhume ; comme antalgique dans les affections de la cavité buccale et/ou du pharynx ; en bain de bouche pour l’hygiène buccale.
En Allemagne, la monographie établie par la Commission E du BfArM précise que le Thym (feuilles et fleurs) est utilisé dans les symptômes de la bronchite et de la coqueluche, et en cas d’inflammation des voies respiratoires supérieures.
En phytothérapie clinique intégrative, le choix de la plante médicinale doit toujours répondre d’un raisonnement endobiogénique intégrant à la fois :
– la fonctionnalité endocrinienne de l’individu considéré dans son ensemble ;
– l’enchaînement dynamique des axes hormonaux dans leur chronologie et leur relativité respectives ;
– les raisons de la désadaptation de la réponse physiologique face aux nécessités métaboliques.
Rappelons qu’en phytothérapie clinique l’usage de l’HE de Thym par voie interne, compte tenu des dosages utilisés, ne nécessite nullement de s’intéresser au chémotype de la plante. En effet, un choix établi en fonction du seul chémotype pour une infection particulière n’est pas justifié car pour obtenir l’effet recherché par le chémotype, il faudrait utiliser des doses nettement supérieures aux doses toxiques, En phytothérapie clinique intégrative, les indications du Thym sont essentiellement les suivantes.
1. Indications principales
- Toutes les pathologies infectieuses bactériennes, virales, mycosiques ou parasitaires des sphères ORL et broncho-pulmonaires, digestives, génito-urinaires, et particulièrement :
- chez l’enfant et le sujet âgé (en l’absence d’HTA) ;
- hypersécrétantes ;
- congestives ;
- nécessitant une vagolyse.
- Toutes les pathologies non infectieuses nécessitant en général une freination des phénomènes sécrétoires et congestifs.
- Toutes les pathologies de ces sphères où la prédominance vagale est à l’origine de troubles de la motricité avec ou sans réactivité alpha-sympathique secondaire.
2. indications secondaires
En externe :
- inhalations : rhumes, sinusites, bronchites, asthme ;
- plaies, dermites inflammatoires ;
- mycoses des ongles ;
- aphtes, inflammations bucco-pharyngées, stomatites, plaque dentaire ;
- douleurs rhumatismales et névralgies ; arthrite, arthrose, contractures musculaires ;
- chute des cheveux ;
- bains stimulants.
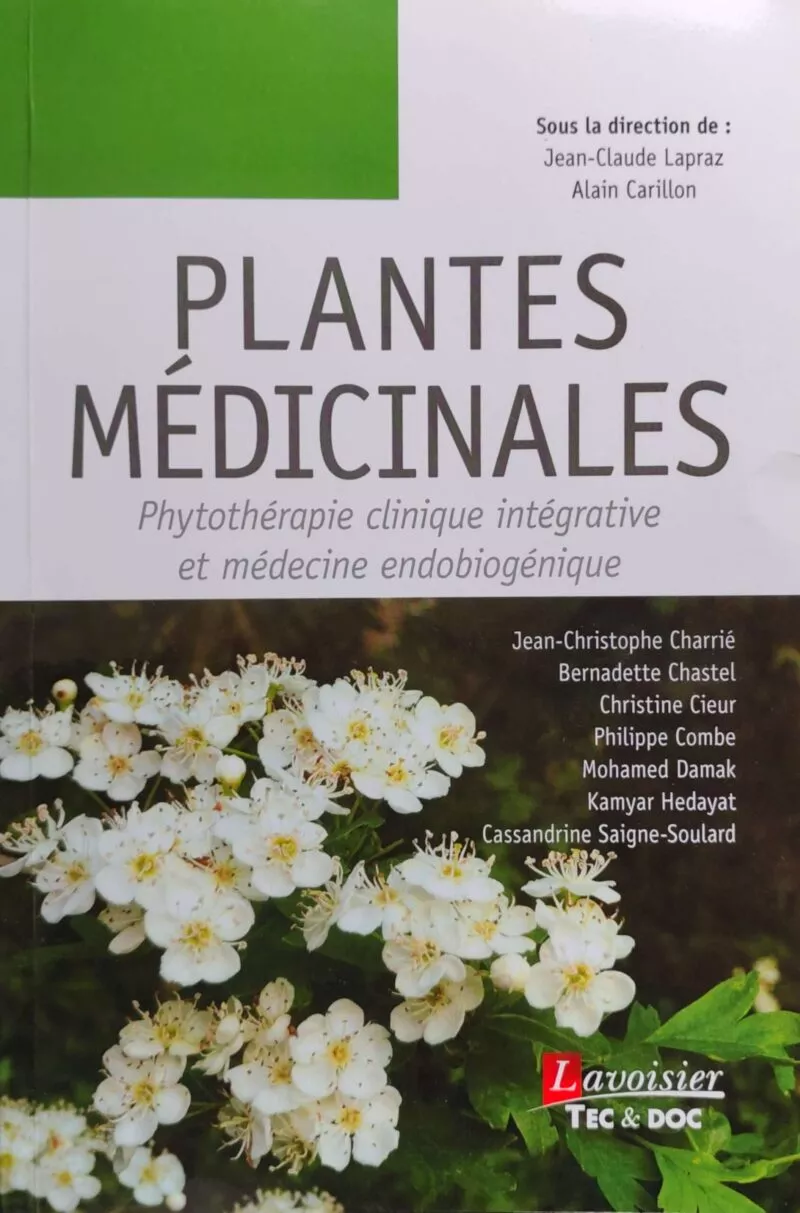
Pour en savoir +
Pour accéder à des informations plus détaillées et aux références bibliographiques qui permettent d’étayer les éléments présentées dans cet article, consultez le livre « Plantes médicinales », édité par Lavoisier TEC&DOC.
Plusieurs formateurs de l’Institut d’endobiogénie ont contribué à sa rédaction.



