- Guide des plantes
Lavande (Lavandula angustifolia) : propriétés et bienfaits
La Lavande : une plante aux multiples bienfaits, reconnue pour ses propriétés apaisantes, antiseptiques, anti-inflammatoires et son action bénéfique sur les sphères neurologique, cardiovasculaire, digestive et cutanée.

Ce qu’il faut retenir…
Dans le cadre d’une phytothérapie clinique intégrée dans une réflexion endobiogénique, la lavande se présente comme une plante prioritairement active :
– au niveau pharmacologique direct : sur les sphères bronchopulmonaire, cardiovasculaire, neurologique, digestive et génito-urinaire ;
– au niveau du drainage : hépatobiliaire, rénal et pulmonaire ;
– au niveau neurovégétatif : pΣ-, αΣ- – -, βΣ-
– au niveau endocrinien : principalement comme freinateur de l’axe corticotrope.
A. Usages traditionnels de la lavande
Plante emblématique de la Méditerranée, la lavande n’a pas toujours été seulement appréciée pour son parfum délicat. Depuis l’Antiquité jusqu’à la médecine populaire moderne, elle a été largement employée pour ses nombreuses vertus thérapeutiques. Tour à tour calmante, digestive, antiseptique ou protectrice, elle occupe une place de choix dans les pharmacopées traditionnelles et les remèdes domestiques.
1. Médecine ancienne et médiévale
Déjà utilisée en Égypte, en Grèce et à Rome contre l’infertilité, les infections, l’anxiété, la fièvre, les troubles digestifs et rénaux.
Au Moyen Âge, présente dans les jardins monastiques et réputée repousser les « forces maléfiques ».
La lavande a été employée lors des épidémies de peste.
2. Propriétés médicinales reconnues
Digestives : stomachique, carminative, diurétique, cholérétique, antispasmodique.
Nerveuses : calmante, sédative, utilisée contre migraines, vertiges, palpitations, épilepsie, neurasthénie.
Respiratoires et infectieuses : antiseptique, sudorifique, diurétique, efficace contre toux, asthme, grippe, fièvres éruptives.
Recommandée en tisanes pour soutenir l’organisme face aux maladies infectieuses.
3. Usages externes
Essence et décoction : antalgiques, décongestives (foulures, entorses, rhumatismes, goutte, contusions).
Bains de lavande : sédatifs et fortifiants, surtout pour enfants et rhumatisants.
Cicatrisante et vulnéraire : pour plaies, ulcères, dermatoses ; utilisée aussi contre la teigne.
Antiseptique : en gargarismes (angines), inhalations (rhinites, bronchites), injections (leucorrhées, blennorragies).
Vertus attribuées contre certains venins (surtout avec la lavande aspic).
Protection contre les poux et insectes (sachets de lavande dans les armoires).
B. Données expérimentales et cliniques issues de la pharmacologie
La plupart des études pharmacologiques ont été faites avec l’huile essentielle de Lavande.
1. Sphère neurologique
Activité anesthésique : localement, l’activité anesthésique a été étudiée in vitro sur une préparation de diaphragme de rat, et confirmée in vivo sur le test conjonctival du lapin avec réduction de la réponse aux différents stimuli. Cette activité est liée à la présence de linalol et d’acétate de linalyle.
Activité analgésique : plusieurs études cliniques ont mis en évidence l’action analgésique de l’huile essentielle de Lavande, après inhalation. Des femmes ayant subi une césarienne ont vu une réduction significative des douleurs pendant les premiers jours après l’intervention. Dans un groupe de 96 étudiantes souffrant de dysménorrhées, l’inhalation d’huile essentielle de Lavande expérimentée sur 4 cycles a permis de réduire l’intensité des douleurs en comparaison avec un groupe témoin.
Chez l’enfant (48 enfants âgés de 6 à 12 ans) en post-amygdalectomie, l’inhalation d’huile essentielle de lavande a montré une diminution des doses d’anti-inflammatoires administrés les 3 premiers jours après l’intervention.
Sasannejad et al. ont monté que l’inhalation, en phase aiguë, d’huile essentielle de Lavande réduit la sévérité des maux de tête.
Action anti-convulsivante : chez la souris, l’administration intra-péritonéale de linalol (2,5 g/kg) permet une protection contre les convulsions induites par l’électrochoc ou le pentylènetétrazole, le linalol se comportant comme un antagoniste compétitif de la transmission glutamatergique. Une autre étude utilisant un extrait hydroalcoolique de Lavande (de 100 à 800 mg/kg), en comparaison avec le diazépam (0,15 mg/kg) et une solution saline (5 mg/kg), démontre l’activité anti-convulsivante de l’extrait administré par voie intra-péritonéale chez la souris, 30 min avant injection de nicotine : la durée et l’intensité des convulsions sont significativement diminuées.
Dépresseur du système nerveux central : l’inhalation d’huile essentielle de Lavande par des souris réduit l’hyperactivité induite par la caféine. L’administration intra-gastrique de 1,6 g/kg d’huile essentielle diluée permet d’abaisser chez l’animal le niveau de conflit de façon comparable à l’action du diazépam.
Activité anxiolytique et sédative : de nombreuses études cliniques ont été menées pour étudier l’action anxiolytique de l’huile essentielle de Lavande. Chez des patients en dialyse chronique, l’inhalation d’huile essentielle a permis de réduire le taux d’anxiété (score d’Hamilton) comparé à celui obtenu avec d’autres substances sans odeur.
Dans le syndrome général d’anxiété, une étude clinique menée en comparaison avec le lorazépam a permis de montrer la similarité d’action de l’huile essentielle de Lavande sans présenter les effets fortement sédatifs du lorazépam. Une étude sur le Sitoxan, spécialité à base d’huile essentielle de Lavande, met aussi en évidence de façon significative une activité anxiolytique dose-dépendante comparable à celle du lorazépam ; cette spécialité amplifie également la durée du sommeil induit par le pentobarbital mais, contrairement au diazépam, n’affecte pas l’activité locomotrice et la performance musculaire. En revanche, si la Lavande se montre plus ou moins anxiolytique, elle ne présente pas le risque d’accoutumance caractéristique des benzodiazépines.
Dans une autre étude clinique, sur 245 personnes âgées recevant de la Lavande fine en inhalation, 72 % d’entre elles voient la qualité de leur sommeil améliorée, comparé à 11 % dans le groupe contrôle. Per os, 200 à 400 mg/kg de Lavande sont nécessaires pour un effet sédatif, 800 à 1000 mg/kg pour un effet hypnotique.
Le linalol induit une augmentation du temps de sommeil à la dose de 200 mg/kg en 90 min, tandis que pour le diazépam, 100 min sont nécessaires pour la même dose.
Chez le rat, l’inhalation d’huile essentielle de Lavande et de linalol permet de diminuer les taux d’ACTH et de catécholamines sanguines.
Des études récentes effectuées sur la souris suggèrent une participation du système sérotoninergique dans l’effet anxiolytique de l’huile essentielle de Lavande.
2. Sphère cardiovasculaire
Anti-inflammatoire : chez la souris, l’application externe ou intradermique d’HE de Lavande à des doses diluées provoque l’inhibition de la réponse au test de l’œdème de l’oreille (action plus attribuée au linalol qu’à l’ester correspondant), et l’inhalation de 0,3 ml d’HE inhibe la libération du thromboxane B2.
Toujours chez la souris, la Lavande inhibe la dégranulation des mastocytes suite à une réaction allergique de type immédiat. Sur les lignées cellulaires THP1 stimulées par les lipopolysaccharides bactériens et utilisées comme modèle inflammatoire, l’huile essentielle de Lavande se montre cytoprotectrice par inhibition de l’effet inflammatoire des lipopolysaccharides.
Activité antiagrégante plaquettaire : chez des souris présentant un thrombo-embolisme pulmonaire, Ballabeni et al. ont observé que l’huile essentielle de Lavandin administrée sur, 5 jours à la dose de 100 mg/kg/jour inhibe l’agrégation plaquettaire induite par tous les agonistes utilisés, montrent une efficacité supérieure à celle de l’aspirine. Le lavandin inhibe complètement la réaction du caillot provoqué par la thrombine chez le rat et réduit les événements thrombotiques sans entraîner de complication hémorragiques. L’expérimentation ne détermine pas les principes actifs responsables de cette action et suggère une synergie d’action liée au totum de la plante. Soulignons cependant la présence de coumarines aussi bien dans l’huile essentielle que dans la plante.
Activité antioxydante : une étude de Hancianu montre l’activité antioxydante de la Lavande chez le rat traité par Scopolamine, antagoniste du récepteur cholinergique muscarinique permettant d’induire une démence et de créer des dommages oxydatifs : chez ces rats traités par la Lavande, il s’ensuit une augmentation de l’activité des enzymes antioxydantes (superoxyde dismutase, glutathion peroxydase, catalase), une augmentation du contenu en glutathion réduit, une diminution du niveau de malondialdéhyde (marqueur de la peroxydation lipidique), une inhibition du clivage de l’ADN.
Le propriétés antioxydantes confèrent à la Lavande une action neuroprotectrice. Ces effets ont été confirmés par plusieurs études, en particulier chez la souris au cours d’expériences d’ischémie/ reperfusion.
Ces résultats sont corrélés à la présence d’acide rosmarinique connu pour ses puissantes propriétés antioxydantes. La Lavande officinale est aussi efficace que l’acide ascorbique pour piéger les radicaux libres, ce qui permet de protéger l’α-tocophérol de l’oxydation.
Activité antispasmodique : chez le lapin, l’acétate de linalyle est responsable de la relaxation du muscle lisse vasculaire par déphosphorylation de la chaîne de myosine et augmentation intracellulaire d’AMPc.
L’acétate de linalyle surtout mais aussi le cinéol, l’eugénol, présentent des propriétés antispasmodiques.
Hypotenseur : l’activité hypotensive résulte en partie de la relaxation vasculaire précédemment citée. Le système neurovégétatif est également impliqué. Au cours d’un essai clinique portant sur 22 participants pondant 3 semaines, il est observé que l’huile essentielle de Lavande inhalée entraine une diminution de la pression systolique et une action sympatholytique.
3. Activité anti-infectieuse
Antibactérienne : in vitro, l’huile essentielle pure de Lavande se montre inhibitrice sur la croissance de Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus aereus, Streptococcus pneumoniae et différentes souches de Mycobacterium. On observe également une action inhibitrice sur Helicobacter pylori, avec un extrait aqueux ou méthanolé de fleurs de Lavande.
On a mis en évidence pour l’huile essentielle de Lavande la faculté de diminuer la multirésistance de souches d’Escherichia coli à divers antibiotiques. Cette activité résulte d’une altération de la perméabilité membranaire des bactéries.
La fonction alcool confère des propriétés antibactériennes aux huiles essentielles contenant ces molécules (moins puissantes que la fonction phénol) : linalol, eugénol, etc. L’acide rosmarinique participe également à cette action antibactérienne.
Antifongique : à une concentration de 0,5 %, le linalol détruit toutes les cellules de Candida albicans en 30 secondes et l’acétate de linalyle tue 93 % des cellules en 30 min.
L’huile essentielle de Lavande exerce une forte activité antifongique sur les dermatophytes Trichophyton mentagrophytes et T. rubrum, contre divers Aspergillus et les mycéliums de Tinea pedis responsables du pied d’athlète.
Le linalol est fongistatique à une concentration de 0,7 µg dans l’air et fongicide à la concentration de 150 µg.
Cette activité est liée à ta présence de linalol, d’ α-pinène, de β-pinène, de 1,8-cinéole.
Antiparasitaire : in vitro, de faibles concentrations d’huile essentielle de Lavandula angustifolia (<1 %) peuvent éliminer complètement des cultures de Trichomonas vaginalis, Giardia duodenalis et Hexamita inflata. A la concentration de 0,1 %, l’action de la Lavande officinale est supérieure à celle du lavandin sur les souches de Giardia duodenalis et Hexamita inflata.
La mortalité de mouches domestiques exposées à l’huile essentielle de Lavande (à une concentration de 10 %) est de 100 % en 30 à 60 min.
Acaricide : après inoculation d’huile essentielle de Lavande à des tiques femelles, à des concentrations allant de 0,5 à 8 %, on observe une forte mortalité des acariens à partir de concentrations supérieures à 4 % et une mortalité de 100 % à partir de 6 %. L’action de la Lavande s’exerce également sur le poids des œufs de tiques et leur taux de mortalité, de façon dose-dépendante.
4. Autres propriétés
Activité diurétique : chez le rat, une administration orale d’infusion de Lavande officinale montre une activité diurétique volumétrique. Comparée à l’action du Diamox, on n’observe qu’une excrétion modérée de sodium avec l’infusion de Lavande.
Activité anti-ulcéreuse : chez la souris, l’administration intra-gastrique d’un extrait alcoolique de fleurs de Lavande, à la dose de 400 mg/kg, réduit de manière significative les ulcérations gastriques provoquées par l’éthanol.
Utérotonique : in vitro, sur l’utérus isolé de cochon d’Inde gravide, l’absorption d’une infusion de fleurs de Lavande a pour effet de stimuler des contractions.
Action anticancéreuse : de récentes expérimentations attribuent au linalol des propriétés anticancéreuses contre les carcinomes du col de l’utérus, de l’estomac, de la peau, du poumon ou des os. Il en est de même pour le 1,8-cinéole. Ces molécules permettent aussi d’utiliser de plus faibles doses de chimiothérapie.
C. Principales formes galéniques utilisées et posologies
1. Voie interne
a) Principales formes galéniques
Infusion, teinture mère, extrait fluide, huile essentielle.
Poudre micronisée, extrait sec (nébulisat), microsphères.
b) Doses indicatives des formes liquides
Teinture mère : 30 à 50 gouttes, 2 à 3 fois/jour.
Extrait fluide : 20 à 50 gouttes, 2 à 3 fois/jour.
Huile essentielle : dispersée en solution à raison de 4 g d’HE pour 125 mL à raison de 30 à 50 gouttes de la préparation ainsi diluée, 2 à 3 fois/jour pour l’adulte (dose maximale conseillée en phytothérapie clinique) et seulement 1 goutte/kg du mélange, 2 à 3 fois/jour (enfant).
Infusion : 1 à 2 cuillères à café/tasse, 2 à 3 fois/jour.
Extrait fluide glycériné miellé : 1 cuillères à café, 2 à 3 fois par jour (adulte).
c) Doses indicatives des formes solides
Gélules d’extrait sec : gélules à 100 à 200 mg, 2 à 3 fois/jour.
Gélules de poudre micronisée : gélules à 200 à 300 mg, 2 à 3 fois/jour.
Gélules d’huile essentielle : sans dépasser, 300 mg/jour, toutes huiles essentielles confondues.
Microsphères LE : 1 à 2 mesures (200 mg valent à 25 gouttes de TM), 1 à 2 fois/jour.
2. Voie externe
Bains : avec une infusion (15 min) de 20 à 50 g de fleurs pour un bain, ou avec de l’huile essentielle mélangée à un dispersant (pas plus de 20 gouttes d’huile essentielle pour un grand bain adulte).
Huile essentielle : en dilution de 3 à 10 % dans un excipient adapté (huile végétale, pommade, alcoolat) en massage ou friction sur les zones à traiter ;
pure sur les brûlures, les piqûres d’insectes, el comme antivenimeux (en usage très ponctuel).
D. Effets secondaires, contre-indications et toxicité
1. Pharmacologiquement
Toxicité : il n’existe pas de toxicité chronique. Comme toutes les huiles essentielles, celle de Lavande peut devenir toxique par absorption d’une trop grande quantité (voie orale ou cutanée), on observe alors hypersalivation, tremblements musculaires, ataxie, dépression et hypothermie. La DL50 per os en aiguë est supérieure à 5 g/kg.
On peut donc l’utiliser chez l’enfant sans grande restriction.
2. Effets secondaires et contre-indications selon l’approche clinique intégrative
Effets secondaires : on peut parfois observer une allergie ou irritation cutanée par contact avec l’huile essentielle de lavande, mais il faut toujours vérifier la qualité de l’huile essentielle qui se doit d’être pure, totale et naturelle.
Contre-indications : aux doses thérapeutiques, la lavande ne présente aucune contre-indication, si ce n’est l’allergie connue à la plante.
E. Précautions d’emploi
Il y a très peu de précautions à prendre avec cette plante si ce n’est celles du bon sens comme avec toutes les huiles essentielles : éviter l’application sur les muqueuses et dans l’œil, ne jamais avaler pure. On l’utilisera avec précaution chez l’hypotendu. Par principe, on portera une attention particulière chez la femme enceinte, essentiellement en évitant l’usage de doses trop fortes pendant la grossesse.
Interactions : la Lavande peut majorer les effets dépresseurs du système nerveux central et ceux des anticoagulants.
F. Propriétés cliniques issues d’une analyse physiologique intégrative
Tropisme principal : neurologique, cardiovasculaire, digestif et anti-infectieux. Freinateur du système nerveux végétatif.
Tropisme secondaire : cutané en externe.
1. Au niveau symptomatique
Sphère digestive : cholérétique ; anti-infectieux biliaire et intestinal ; antispasmodique.
Sphère cardiovasculaire : hypotenseur ; artério-dilatateur ; veinotonique ; anticoagulant, anti-vitamine K ; anti-inflammatoire ; antioxydant.
Sphère neurologique : antalgique de contact, antimyalgique, antinévralgique ; antispasmodique neurotrope ; sédatif léger ; anxiolytique ; potentialise les effets des dépresseurs du SNC ; antimigraineux.
Sphère respiratoire : antitussif ; anti-allergique ; anti-inflammatoire ; anti-infectieux ORL et pulmonaire (antibactérien Gram+ ; anti-staphylococcique, anti-streptococcique).
Sphère uro-génitale : antispasmodique et anti-infectieux urinaire ; décongestionnant pelvien par stimulation veineuse ; utérotonique et anti-infectieux génital ; diurétique.
Sphère cutanée : antibactérien (streptocoque, staphylocoque) ; antiparasitaire (scabicide) ; cicatrisant de contact (vulnéraire) ; antalgique de contact.
2. Au niveau du drainage
Draineur hépatobiliaire : cholagogue, cholérétique (par action neurovégétative).
Draineur rénal : diurétique volumétrique.
Décongestionnant pelvien par stimulation veineuse.
Décongestionnant pulmonaire : expectorant bronchique.
3. Au niveau de la régulation neuroendocrinienne
a) Propriétés neurovégétatives
- Alpha-sympatholytique très important : αΣ—
- Bêta-sympatholytique modéré : βΣ-
- Parasympatholytique modéré à faible : pΣ-
b) Propriétés endocriniennes
- Axe corticotrope :
- freinateur cortico-surrénalien ;
- freinateur indirect du CRF et de l’ACTH.
- Axe thyréotrope : freinateur indirect de la TRH.
G. Indications en phytothérapie clinique intégrative
Les cahiers de l’Agence 1998, en France, admettent pour la fleur et la sommité fleurie une seule indication per os : « traditionnellement utilisée dans le traitement symptomatique des états neurotoniques des adultes et des enfants (troubles mineurs du sommeil) » et pour la voie cutanée « traditionnellement utilisée dans le traitement des petites plaies après lavage abondant et élimination des souillures ; en cas d’érythème solaire, de brûlures superficielles et d’érythèmes fessiers ; en cas de nez bouché et de rhume ; en bain de bouche pour l’hygiène buccale».
En phytothérapie clinique intégrative, le choix de la plante médicinale doit toujours répondre d’un raisonnement endobiogénique intégrant à la fois :
– la fonctionnalité endocrinienne de l’individu considéré dans son ensemble ;
– l’enchaînement dynamique des axes hormonaux dans leur chronologie et leur relativité respectives ;
– les raisons de la désadaptation de la réponse physiologique face aux nécessités métaboliques.
En phytothérapie clinique intégrative, les indications de la Lavande sont les suivantes :
1. Indications principales
Dans tous les états sympathicotoniques : HTA ; tachycardie, certaines arythmies (extrasystoles) ; états neurotoniques palpitation, nervosisme, anxiété ; spasmophilie ; migraines ; asthme ; troubles vasomoteurs des extrémités (vasoconstricteur), syndrome de Raynaud ; troubles du sommeil, de l’endormissement ; tous les états spasmodiques sphinctériens ou vasculaires et/ou musculaires lisses : hépatobiliaires, digestifs, voies urinaires, respiratoires, etc. ; certains ulcères, gastrites, colites, constipation ; etc.
Dans tous les états congestifs : quelles que soient leurs localisations. En complément dans les dysménorrhées, congestives par exemple.
Dans toutes les pathologies infectieuses à composante congestive et/ou spasmodique et/ou et hypo-sécrétantes ou à sécrétions épaisses, en particulier chez le sujet sympathicotonique : ORL et pulmonaires : angines rouges, sinusite bloquées, otites, certaines bronchites ; digestives ; uro-génitales : cystites, vaginites, prostatites ;
grippe et syndrome infectieux du sujet hypertendu ; etc.
Dans toutes les pathologies cutanées à composante érythémateuse et prurigineuse : eczéma ; certains psoriasis ; certaines acnés ; etc.
2. Indications secondaires
a) Par voie externe :
- Névralgies, migraines, par exemple :
HE Lavandula angustifolia
HE Mentha piperita aa 1,5 g
Huile de Millepertuis qsp 60 mL
en application locale sur les tempes ;
- Spasmes, contraction musculaires ;
- Inflammation articulaires : entorses, lumbago, sciatique, par exemple :
HE Lavandula angustifolia
HE Gaultheria procumbens aa 1,5 g
TM Arnica montana 10 g
Huile d’amandes douces qsp 60 mL
en application sur l’articulation lésée ;
- Plaies : brulures, escarres (comme cicatrisant et antalgique)
- Piqûres d’insectes.
b) Par voie interne
- Pathologies spasmodiques :
- bronchiques : toux quinteuse, asthme,intestinales, gastriques, biliaires,cardiovasculaires ; migraine, palpitation,
- génitales ;
- sédation du système nerveux central.
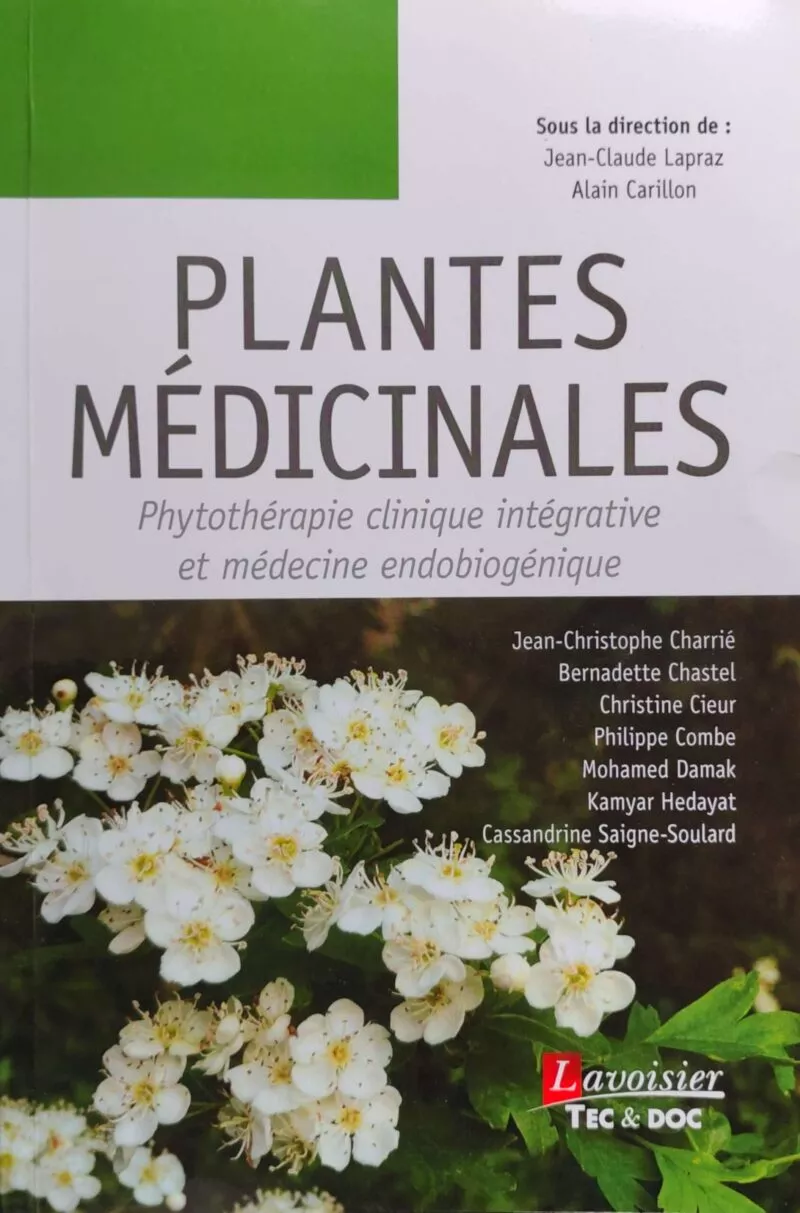
Pour en savoir +
Pour accéder à des informations plus détaillées et aux références bibliographiques qui permettent d’étayer les éléments présentées dans cet article, consultez le livre « Plantes médicinales », édité par Lavoisier TEC&DOC. Plusieurs formateurs de l’Institut d’endobiogénie ont contribué à sa rédaction.



